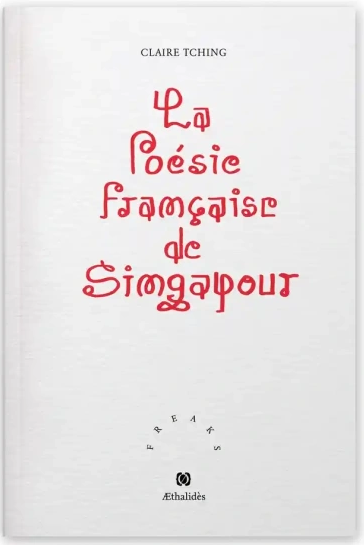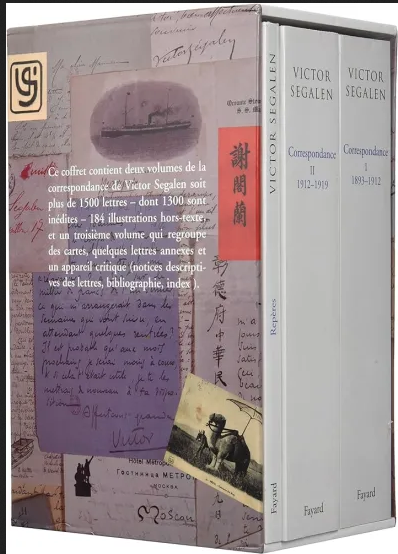En mésapprendre un peu sur la Poésie française de Singapour
En onze notices mêlant le subtilement détourné et le foncièrement inventé, une superbe fausse anthologie pour approcher par tours et détours rusés, souvent hilarants, ce que peut bien être la poésie, hier comme aujourd’hui.
L’histoire de la poésie française de Singapour est indûment méconnue, pour ne pas dire ignorée. Le présent ouvrage se donne pour ambition de réparer cette injustice.
Le premier poème auquel je propose de faire remonter cette histoire est un document paradoxal, qui à bien des égards sort du champ d’étude de cette anthologie raisonnée. Premièrement, parce qu’il date d’une époque (1755) où Singapour n’était pas encore fondée, ensuite parce qu’il n’a été écrit à Singapour que de manière imaginaire ; enfin, parce qu’il ne s’agit pas d’abord, à proprement parler, d’un poème. (…)
En 1755, à une époque où Singapour n’existait tout simplement pas pour l’Occident (la colonie britannique qui est à l’origine de la cité-État contemporaine n’a été fondée par Thomas Stanford Raffles qu’en 1824), Jacques-Nicolas Bellin et son assistant Yvon Lavière ont réalisé une carte de la péninsule malaise où, pour la première fois, apparaît une représentation de Singapour, que Bellin appelle « Pulo, ou Isle Panjang », « Panjang » signifiant « long » en malais. La carte concerne la Malaisie dans son ensemble, tout comme les notes de travail de Bellin, dont une maigre proportion seulement est relative à Singapour. Depuis au moins le XIVe siècle, l’île était appelée Singapura par les Indonésiens (ce qui signifie, en sanscrit, « ville du Lion », même si on n’y a jamais croisé aucun lion), et Bellin note bien l’existence d’un « détroit de Sincapour ».
C’est de notoriété publique, Bellin était un cartographe en chambre ; pour mener à bien ses recherches depuis Paris sans voyager, il disposait de relevés de géomètres ou de faisant-fonction, capitaines de navire, voire tout simplement marchands ou matelots. Ceux-ci lui procuraient la multitude d’informations de natures différentes dont il avait besoin, et Belin s’ingéniait, dans un second temps, à les synthétiser dans une représentation unique, et objective, de l’espace. La méthode qu’il utilisait pour y parvenir est étonnante, si l’on pense que le XVIIIe siècle s’est dépeint lui-même comme le siècle des Lumières, mais relativement bien renseignée (on en trouve les premières mentions dès la Correspondance littéraire, philosophique et critique de Grimm et de Diderot). Le cartographe transformait l’ensemble des informations qu’il possédait en courtes notes synthétiques, puis mettait son assistant (ici Y. Lavière) dans un état d’hypnose pour le guider – voyage purement imaginaire – dans le lieu dont il fallait dresser la carte. Il lui distillait alors au compte-gouttes les informations qu’il avait en sa possession, et notait ce que lui répondait son assistant, dont il utilisait l’imagination comme un catalyseur, suppléant à l’absence d’expérience subjective. Aucun des cartographes contemporains que j’ai pu interroger n’a soutenu que cette méthode, qui n’est plus enseignée, avait le moindre intérêt, et tous penchaient plutôt pour une aimable fantaisie de Bellin. Le célèbre cartographe a reproduit cette manière de faire avec tous ses assistants. Parmi eux, Yvon Lavière ne semble pas particulièrement doué d’un grand sens de la géographie. Les réponses qu’il donne aux informations de Bellin sont vagues, et obscures. D’autres assistants de Bellin, placés dans des circonstances analogues, ont produit des textes possédant des vertus géographiques au contraire remarquables (on peut penser aux « comptes rendus » accompagnant les cartes de Terre-Neuve et du Brésil, dont Martial Roger fait mention dans son étude récente sur l’Histoire des représentations cartographiques du Nouveau Continent en Europe (…).
Bien sûr, nous sommes ici dans la tératologie littéraire. Sans doute Lavière et Bellin auraient-ils d’ailleurs franchement ri si on leur avait dit que de tels documents, pour eux exercices et notes de travail, seraient un jour considérés comme « poétiques ». Ils l’auraient d’autant moins compris qu’ils les produisirent à une époque où ni le vers libre ni le poème en prose n’avaient été inventés. Mais de même que (sans qu’un statut n’affecte l’authenticité de l’autre) les masques de l’art premier eurent une utilité rituelle avant de se retrouver derrière les vitres de nos musées, de même certains textes n’apparaissent que rétrospectivement comme poétiques, une fois déconnectés de leurs usages pratiques – en sont-ils moins authentiquement poèmes ?
User d’une anthologie de poésie fictive (en dehors de Victor Segalen, de Guillevic et de Michel Butor, qui n’apparaissent ici que par de jouissifs et acrobatiques raccrocs, les poètesses et poètes qui hantent ce recueil n’existent pas – ou bien ne correspondent résolument pas à ce qui est dit ici d’elles et d’eux) en pied-de-biche, pour questionner subtilement (l’approche plus frontale ne surviendra que dans les dernières de ces 90 pages) ce que peut et veut la poésie, hier comme aujourd’hui : c’est le stimulant projet confié à Claire Tching, elle-même hétéronyme de bits et de papier, par un poète français contemporain connu mais ici (un peu) dissimulé. Publié en janvier 2024 chez Æthalidès, « La poésie française de Singapour » relève bien, comme il est mentionné d’emblée à propos du cartographe narratif Jacques-Nicolas Bellin, de la tératologie littéraire.
Lorsque Roberto Bolaño écrit son anthologie fictive, « La littérature nazie en Amérique », en 1996, il se plonge résolument dans certains miroirs et labyrinthes borgésiens (au premier chef sans doute ceux du « Tlön, Uqbar, Orbis Tertius » de 1940) pour mieux s’en détourner, et inscrire la critique littéraire réelle (par le biais de celle alors simulée) dans un indéniable jeu politique qui ne peut avoir rien, jamais, de désincarné, malgré tous les efforts entrepris par les récits dominants pour le nier. Sur un plan parallèle, mais déjà en apparence plus proche du travail recensé ici, Ivar Ch’vavar et ses camarades, dans leur monumental « Cadavre grand m’a raconté : anthologie de la poésie des fous et des crétins dans le Nord de la France », ne cherchaient pas en priorité à gloser sur les emblématiques corons, loin s’en faut, mais à insérer un coin robuste (et hilarant) dans notre appréhension du monde par clichés juxtaposés ou emboîtés.
Celui qui s’abrite ici derrière Claire Tching ne procède pas fondamentalement différemment : derrière la caractérisation des entreprises poétiques, volontaristes ou accidentelles, de l’Amicale jésuite du Pantoum, de Chemmolhi Karpanai Pattiram, de Lu Zaicheng, d’Aimé Nguyen ou de Claire Arago, il s’agit bien de poser des balises, de laisser fluctuer les territoires mouvants de la poésie, de ce qu’elle raconte (on songera peut-être aux récents articles « Pourquoi écrit-on des récits en poésie ? » de Sophie Martin et « Quand le poème raconte » de Laurent Albarracin, dans la revue Catastrophes, précisément), de ce qu’elle traduit (sur ce point, le chapitre consacré à Lu Zaicheng est particulièrement redoutable) et de ce qu’elle abrite ; dans le cas spécifique de Singapour – qui dépasse là son rôle initial de prétexte quasiment comique ou de soldat de fortune de la géographie littéraire -, le travail conduit en quelques pages incisives (voyez le chapitre consacré à Victor Segalen notamment, mais tous les autres ou presque sont concernés) une puissante approche latérale de l’entreprise coloniale jusque dans ses survivances contemporaines.
Le français n’est pas l’une des quatre langues officielles de Singapour. Mais l’ancienne colonie anglaise, située à l’extrême pointe de la péninsule malaise et peuplée à 75 % d’habitants d’origine chinoise, est aussi une terre d’immigration historique pour les Tamouls d’Inde et du Sri Lanka ; et à cause du comptoir de Pondichéry comme des Missions catholiques disséminées en Malaisie par lesquelles ils transitaient, on trouve des francophones parmi eux. C’était le cas de Chemmolhi Karpanai Pattiram, qui est l’autrice du poème suivant (…).
Quoi qu’il en soit, ce poème mystérieux n’est pas sans porter un parfum d’envoûtante beauté. Il la doit peut-être au fait que le français n’était pas la langue maternelle de Chemmolhi Karpanai Pattiram : n’a-t-on pas l’impression que son poème est traduit du tamoul, plutôt que directement écrit en français ? C’est que la poésie n’est pas tant une affaire de maîtrise (de la langue et des techniques d’écriture) que d’énergie. On dirait qu’une sorte d’urgence (qui n’est pas impeccablement dressée, soumise aux formes policées des usages d’une langue) cherche à trouver, coûte que coûte, une place au milieu des mots, quitte à les écraser et les bousculer par endroits en même temps qu’elle s’y traduit. La syntaxe difficile, le lexique obscur de ce poème parviennent alors peut-être, mieux que si l’autrice avait été chez elle dans l’expression française, à partager cette urgence. N’y devine-t-on pas, en tout cas, les tourments de cette âme fragile, déchirée par l’exil ?
Il faudra évidemment lire soigneusement, vers la fin du volume, la lettre adressée par Pierre Vinclair à son amie Claire Tching, à propos des deux lièvres exotiste et universaliste levés à propos de Guillevic (on aura saisi à un moment qu’il y a anguille sous roche et que – ce n’est pas un véritable secret sur la Toile – l’autrice du présent ouvrage a davantage qu’un peu à voir avec l’un des brûlants animateurs du beau magazine poétique Catastrophes) : en quelques paragraphes bien sentis, on trouvera bien une vive réaffirmation de l’impossible neutralité, de l’équilibre toujours à poursuivre sans doute mais le plus souvent largement illusoire, et de la vocation indéniablement politique, au sens le plus fort et le plus authentique du terme, de la poésie – car poussant plus que tout l’outil du langage dans ses retranchements, dans ses constats d’échec (on en reparlera bien sûr à propos du récent ouvrage de Claro) et dans ses percées imaginatives.
Les éditions Æthalydès continuent décidément à nous impressionner, en sachant extraire pour nous des merveilles intempestives telles que « Le tango des ombres » de Jean-François Seignol, la « Lettre au recours chimique » de Christophe Esnault, ou encore les « Seins noirs » de Charles Watson. Il faut par ailleurs lire sur Sitaudis (ici) ce que Pierre Huglo nous dit de « La poésie française de Singapour ».
Écrire des cartes postales qui n’ont pas de rapport avec le paysage, c’est original. Guillevic se méfie sans doute ici d’une tentation à laquelle il serait si facile de céder : écrire un poème exotique. Embrasser l’illusion du voyageur qui, essayant de rendre compte de l’altérité d’un pays qu’il découvre, transforme les « indigènes » en caricatures d’eux-mêmes, et sur l’inconnu rabat le plus rebattu. Faire le touriste naïf, inconscient des travaux des sciences sociales. Tomber dans le piège des autochtones surjouant une particularité culturelle rentable. Faire siens les clichés racistes, et stimuler par la moiteur suintant de quelques lignes tropicales le désir ennuyé des lecteurs métropolitains.
On peut imaginer que c’est une telle critique de l’exotisme (s’adossant à un universalisme humaniste : les hommes sont égaux partout dans le monde – ou, plus chic, structuraliste : toutes les cultures partageraient les mêmes éléments fondamentaux) qui sous-tend le fier refus de Guillevic d’envoyer des « cartes postales » ayant quelque rapport avec le contexte dans lequel il les a écrites.
Oui, dit le poète breton, les tropiques, c’est comme Paris. Les gens de Kuala Lumpur ne sont pas des sauvages buvant du lait du coco sous des palmiers, mais des modernes, emplis d’eux-mêmes, pleins comme des œufs d’eux-mêmes. Identité. Et même les abeilles, comme de bons Parisiens, font leur Œdipe.
Mon père, quoique né malaisien (en 1964, Singapour faisait partie de la Fédération des États de Malaisie), n’aime pas le lait de coco ; sa sœur, ma tante, vit à Kuala Lumpur, qui est depuis longtemps une ville prospère, tirant la croissance économique de toute la péninsule ; et les Anglais sont présents dans la région depuis plusieurs siècles. Pour autant, je ne dirais pas – mais alors pas du tout – qu’on y parle (par exemple chez ma tante) aussi bien qu’à Paris des problèmes que les gens ont avec eux-mêmes. Je ne saurais pas bien dire pourquoi, si c’est le confucianisme ou le souvenir des années de misère qui rend les Malaisiens taiseux, mais il me semble vraiment impossible de souscrire à une telle affirmation. Plus encore : elle ne me semble pouvoir être émise que par un touriste. Comme si, symétrique à l’exotisme qu’il dénonce, Guillevic faisait preuve d’un universalisme aussi superficiel et dangereux.
Hugues Charybde, le 5/06/ 2024
Claire TCHING , Pierre VINCLAIR - La poésie française de Singapour - éditions ÆTHALIDÈS
L’acheter chez Charybde, ici