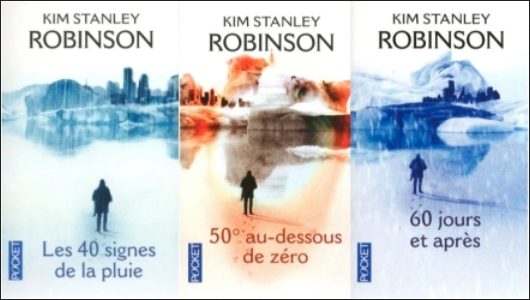Le réchauffement climatique entre science et politique de Kim Stanley Robinson
Publiée en trois tomes entre 2004 et 2007, traduite en français par Dominique Haas aux Presses de la Cité entre 2006 et 2008, cette trilogie de Kim Stanley Robinson, généralement appelée « Science in the Capital » en américain, est plus couramment désignée comme la « trilogie climatique » en français.
Soyons clairs : au plan littéraire et romanesque, cette trilogie copieuse (presque 2 000 pages au total) est peut-être le travail le moins réussi de toute l’œuvre de Kim Stanley Robinson. La magie d’assemblage qui opère si souverainement dans la trilogie martienne, dans « SOS Antarctica » ou dans l’immense « Chronique des années noires » ne parvient pas ici à fusionner réellement les fils narratifs et les thématiques, préoccupations écologiques, scientifiques et politiques d’une part, chemins personnels, mystiques et humains d’autre part. Il n’en reste pas moins qu’un gros roman même imparfait de Kim Stanley Robinson demeure largement plus intéressant qu’une vaste majorité de la production contemporaine, par sa capacité intacte et redoutable à voir juste et loin, et à faire saisir la subtilité politique, parfois désespérante et toujours stimulante, du devenir de l’humanité.
Reprenant une partie des personnages « secondaires » de « SOS Antarctica » (1997), autour du sénateur californien dit « du monde » pour ses incessants déplacements à l’étranger et sa connaissance détaillée de personnes et de réalités « non-états-uniennes », Phil Chase, Kim Stanley Robinson organise une vaste fresque de la tentative conduite par des scientifiques d’abord dispersés, puis rassemblés, trouvant progressivement échos et soutiens politiques à Washington (d’où les sous-titres américains de la trilogie, « Science in the Capital », voire « Science in the Capitol » chez certains…), dans les arcanes infiniment complexes du système décisionnel « checks and balances » des États-Unis d’Amérique, en tentant de circonvenir une majorité républicaine de plus en plus « anti-scientifique » et de plus en plus inféodée à certains grands lobbys, celui de l’énergie fossile tout particulièrement.
Conseiller environnemental du sénateur, chargée d’études à la National Science Fondation, scientifique de San Diego provisoirement détaché à cette même NSF, directeur de cabinet, chercheur prodige, mais aussi moines tibétains exilés sur une île précaire dans le delta du Gange, manipulateurs occultes de machines de vote et serviteurs secrets d’officines ramifiées, toutes et tous ont un rôle à jouer dans cette bataille contre la catastrophe environnementale qui, faute d’avoir été entamée beaucoup plus tôt, est désormais devenue critique, et peut-être même déjà perdue.
Sans le déluge d’effets spectaculaires auxquels nous ont désormais habitués les films hollywoodiens s’étant, avec plus ou moins de bonheur, emparés du sujet, mais avec une passionnante rigueur dans la construction des programmes à conduire et des décisions à prendre, Kim Stanley Robinson parvient à nous captiver, même si sa mosaïque humaine conserve ici un aspect rapiécé auquel il ne nous avait pas habitués.
Les 40 signes de la pluie
Les États-Unis vivent le règne mortifère d’un président républicain américain volontiers matamore, sans réelle personnalité, et largement inféodé à certains lobbys traditionnels religieux et économiques, alors que la circulation thermohaline, sous l’effet de la fonte accrue de la calotte glaciaire arctique et d’un début de dislocation de la banquise antarctique, est menacée au point de voir notamment le Gulf Stream ralentir (comme dans le film « Le jour d’après » de Roland Emmerich, sorti la même année que le roman de Kim Stanley Robinson, avec un recours plus net aux effets spectaculaires d’accélération de phénomènes, assez peu scientifique, ce dont l’auteur ici essaie de soigneusement se garder). Les véritables protagonistes, toutefois, s’affirment rapidement être des « scientifiques ordinaires », dont l’auteur excelle à dépeindre les travaux, les espoirs, les désespoirs, les contradictions et les doutes, comme avant lui un Gregory Benford (« Un paysage du temps », 1980).
Lorsqu’une pluie prolongée provoque une cataclysmique inondation de Washington, l’événement agit comme un catalyseur des bonnes volontés d’une part, de la détermination politique d’un Phil Chase d’autre part, et d’une cristallisation de l’opinion publique américaine, assez naturellement, au fond, plus concernée par ce qui la touche directement que par de lointains effets de désertification ou d’inondation de zones côtières dans le delta du Gange. Le programme d’urgence concocté plus ou moins subrepticement par la NSF devient alors, peut-être, enfin, un enjeu prioritaire.
Aucun membre de la communauté scientifique ne pouvait se permettre d’être trop pointilleux sur le chapitre du conflit d’intérêts. Sans cela, on ne trouverait jamais personne pour évaluer quoi que ce soit, l’hyperspécialisation rendant les champs de recherche tellement exigus qu’au sein d’un projet quelconque tout le monde semblait connaître tout le monde. En conséquence, tant qu’il n’y avait pas de liens financiers ou institutionnels avec un individu donné, on considérait comme possible de procéder à l’évaluation de son travail dans les différents systèmes de revue par les pairs.
Mais Frank voulait s’en assurer. Yann Pierzinski était un jeune biomathématicien très talentueux – l’un de ces étudiants en doctorat qui vous donnaient vite la quasi-certitude qu’il était promis à une belle carrière, et qu’on n’avait pas fini d’entendre parler de lui. Et voilà, c’était arrivé, et son sujet présentait un intérêt particulier pour Frank.
– D’accord, dit-il à Anna. Je vais le mettre dans la moulinette.
Quand Anna fut sortie, il rouvrit le dossier « Analyse mathématique et algorithmique des codons palindromiques en tant que prédicteurs de l’expression génique des protéines. » Une demande de subvention pour un projet de recherche sur un algorithme censé prévoir pour quelles protéines codait un gène donné.
Très intéressant. C’était une tentative de résolution d’un mystère fondamental dans le domaine de la biologie, un pas en terrain inconnu. Dont l’exploration avait jusqu’alors résisté à toutes les biotechnologies, même les plus solides. Les trois milliards de paires de base du génome humain encodaient sur leur chemin des centaines de milliers de gènes ; et la plupart de ces gènes contenaient des instructions pour l’assemblage d’au moins une protéine, les briques qui constituaient les matériaux de construction élémentaires de la chimie organique et de la vie même. Mais quels gènes codaient pour quelles protéines, comment ils le faisaient, et pourquoi certains gènes exprimaient plus d’une protéine, ou des protéines différentes selon les circonstances – tous ces problèmes étaient très mal compris, quand ils ne constituaient pas des énigmes rigoureusement irrésolues. Cette ignorance faisait de l’essentiel de la biotechnologie une procédure interminable et très coûteuse d’essais et d’erreurs. Une clé permettant de déchiffrer n’importe quelle partie du mystère pouvait être très précieuse.
50° au-dessous de zéro
Personne n’aime Washington. Même ceux qui l’adorent ne l’aiment pas. Climat atroce, circulation impossible : une ville américaine ordinaire, de taille moyenne, perpétuellement embouteillée, où les gros bâtiments fédéraux blancs n’arrangent rien. Au contraire, ils attirent tous les politiciens, les touristes, les lobbyistes, les diplomates, les réfugiés et tous ces gens venus du monde entier, souvent pour des raisons suspectes, qui ne font qu’encombrer les rues, monopoliser la scène et parler interminablement de leurs non-villes sur une colline en ignorant la vraie ville qui les entoure. Tous les mets et boissons servis par un million de restaurants formidables ne sauraient faire oublier cette hypocrisie de mauvais goût. Non, décidément, personne ne peut aimer ce salmigondis de bastion du gouvernement mondial, de crypte inviolable de la Banque mondiale, de forteresse et de quartier général des gendarmes du monde – Rome à l’ère du pain et des jeux.
Et donc, inévitablement, lorsque la capitale fut envahie par une inondation qui la dévasta et l’abandonna, crachotante et boueuse, dans la moiteur d’un mois de mai livide, les réactions officielles furent diverses et variées, mais l’idée générale aurait pu se résumer en un sous-titre : HA HA HA. C’est que beaucoup de gens, d’un bout à l’autre de la planète, voyaient plus ou moins dans ce déluge une espèce de justice divine. La capitale du monde en avait pris pour son grade : difficile de ne pas jubiler.
Évidemment, les partis habituels prononcèrent les discours habituels. Zone sinistrée, secours d’urgence, risque d’épidémies, restauration immédiate, orgueil de la nation, etc. Washington étant la capitale du monde, le Président clama haut et fort qu’il était du devoir patriotique de chacun de soutenir la reconstruction, opposant une réaction courageuse et loyale à ce qu’il appelait « un acte de terrorisme climatique ». « Nous sommes désormais en guerre contre la nature, ajouta-t-il. Nous travaillerons d’arrache-pied jusqu’à ce que cette ville soit encore plus elle-même qu’avant. »
C’est dans ce contexte d’après-crise, qui évoque en une sombre ironie involontaire la gestion de Katrina à La Nouvelle-Orléans, catastrophe intervenue un mois avant la parution de ce deuxième tome de la trilogie, qu’un des protagonistes du premier volume prend peu à peu une ampleur plutôt baroque, voire rocambolesque : Frank Vanderwal, détaché de son université de San Diego à la NSF, qu’il se préparait à quitter, se voit charger par la directrice générale, suite à une lettre de démission salée qu’il lui avait adressée, de coordonner un programme extrêmement volontariste, tranchant avec les habitudes de l’auguste maison, tandis qu’il développe une curieuse fascination pour la philosophie tibétaine en se liant d’amitié avec les exilés du Khembalung, noue une très étonnante histoire d’amour avec une enquêtrice d’une agence gouvernementale de sécurité, et entreprend un bizarre retour à la nature, dans le principal parc de la ville partiellement rendu à la vie sauvage par l’inondation, conduisant quelques expériences titillant sa curiosité de socio-biologiste, dans une capitale livrée au froid d’un hiver jamais vu, et qu’il est désormais vital de redémarrer le Gulf Stream, programme colossal s’il en est, à imaginer et conduire d’urgence.
C’est peut-être ici que les différentes briques narratives maniées par Kim Stanley Robinson s’ajustent le moins bien, c’est pourtant ici aussi que la lectrice ou le lecteur peut développer une étrange complicité, voire une certaine fascination, pour ces scientifiques à la fois terriblement lucides et un peu fous, au sens social du terme, se lançant dans une approche volontariste qui ne leur est guère coutumière, pour tenter de dégager les moyens d’un sauvetage terriblement tardif pour la biosphère.
Ils regardèrent la dernière diapo. Frank se dit que les implications avaient tendance à stagner à la surface de l’esprit, exactement comme l’eau dans l’Atlantique Nord. Elles refusaient de s’enfoncer. Le monde entier, enfermé dans un mode climatique global chaud et humide, qui se réchauffait et devenait plus humide à cause du réchauffement global provoqué par les gaz de serre libérés par les hommes, pouvait basculer dans un schéma froid, sec et venteux à l’échelle planétaire. Et la dernière fois, ça s’était produit en trois ans. Ça avait beau être difficile à croire, l’analyse des carottes de glace du Groenland était formelle, et le reste du dossier tout aussi convaincant. Du coup, le terme scientifique utilisé pour définir ce niveau de certitude était le suivant : incontestable.
60 jours et après
Phil Chase a franchi le pas. Venant d’être élu président des États-Unis, déployant un savoureux mélange d’expérience politique, de ruse médiatique et de sincérité intelligente, il a fait de la lutte d’urgence contre les conséquences du réchauffement climatique une priorité nationale, et lance un vaste mouvement de coopération internationale dans lequel son pays, de frein depuis des décennies, devient moteur, bien décidé à appliquer aussi intégralement que possible le programme législatif exigeant concocté par ses conseillers scientifiques rassemblés autour de la NSF.
Pendant que les intrigues baroques nouées autour de Frank Vanderwal et de son curieux mode de vie expérimental s’acheminent vers un dénouement, Kim Stanley Robinson nous propose une éblouissante revue de l’imbroglio d’agences gouvernementales et para-gouvernementales, d’intérêts politiques à utiliser, ménager ou circonvenir, d’alliances parfois bien improbables à nouer, tant au plan national qu’au plan international, et de la possibilité de gérer les conflits, secrets industriels ou secrets nationaux, qui ralentissent la coopération scientifique d’urgence et les gigantesques travaux d’ingénierie planétaire à conduire en quelques années : « terraformer la Terre » et « sauver le monde pour que la science puisse continuer » deviennent ainsi les maîtres mots, paradoxaux et presque occultes, de ce troisième tome qui est sans doute le plus impressionnant des trois.
Le temps que Phil Chase soit élu président, le climat du monde était bien engagé sur la voie du changement irréversible. Il y avait déjà quatre cents parts par million (ppm) de CO2 dans l’atmosphère, et il y en aurait bientôt cent de plus si les hommes continuaient à brûler du carbone fossile – or, à ce stade, il n’y avait pas d’autre solution. De même que Roosevelt avait été élu au milieu d’une crise qui s’était, par certains côtés, aggravée avant de s’améliorer, ils étaient englués dans un moment de l’histoire où le changement climatique, la destruction de la nature et la généralisation de la misère se combinaient pour former un mélange toxique et explosif. Le nouveau président devait envisager des mesures radicales alors qu’il était corseté par un certain nombre de facteurs économiques et politiques, dont le moindre n’était pas la gigantesque dette de l’État, délibérément entretenue par les administrations qui l’avaient précédé.
En résumé, si le « thriller » salué par une partie de la critique me semble plutôt raté, l’investigation conduite par Kim Stanley Robinson dans le concret de la science en action, fût-ce dans un cadre qu’il est convenu d’appeler « science-fiction », est réellement impressionnant.
Desserrer le jeu de contraintes économiques, sociales et politiques qui semblent pourtant – et les avancées toujours insuffisantes de ces dernières années le rappellent hélas régulièrement – inexorables, en mettant en scène une responsabilisation et un engagement de la communauté scientifique, servant de véritable levier pour que des politiques responsables puissent – enfin – déployer dans le bon sens la formidable machine d’ingénierie et d’imagination dont dispose l’humanité : c’est tout le propos de cette trilogie, sous ses péripéties et ses excursions parfois bien curieuses. Un roman qui distille donc malgré ses défauts un détonant mélange d’espoir (il reste bien du possible) et de désespoir (les dirigeants mondiaux n’en empruntent pas vraiment le chemin), et à nouveau une puissante incitation à la réflexion et à l’action.
Pour acheter les trois tomes chez Charybde : le premier, le deuxième, et le troisième.
Hugues Charybde, le 13/11/2023
Kim Stanley Robinson - Les 40 signes de la pluie, 50 °au—dessous de zéro et 60 jours et après - éditions Presse Pocket
© Future Publishing