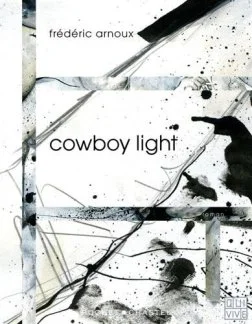Cowboy light : le vagabondage orwellien de frédéric Arnoux dans le Genève des 80's
Dans la dèche gouailleuse à Besançon et à Genève dans les années 80. Cru, savoureux et sauvage.
Soleil ou pas, la lumière s’affalait sur le plexi du toit plus dégueulasse que transparent et restait là-haut jusqu’au soir. Y avait bien des néons mais ils claquaient les uns après les autres et personne ne les remplaçait. Le matin, je traversais le hangar à tâtons en me repérant à l’immense colonne de plastique blanc, livide, raide, à côté de la machine.
À sept heures cinq, le premier Fenwick arrivait face à moi avec une palette chargée de cartons remplis de je-sais-pas-quoi. Il la déposait sur la plate-forme, je tirais sur le rouleau pour coincer le plastique sous les cartons du bas.
J’appuyais sur le bouton vert. Des centaines de fois par jour. La plate-forme tournait sur elle-même et le plastique s’enroulait autour. Trois semaines déjà, je n’arrivais pas à m’habituer. En s’étirant, la matière expulsait des râles qui s’étiraient eux-mêmes au fur et à mesure que la rotation écartelait une à une ces milliards de particules avec la lenteur du bon vieux bourreau moyenâgeux.
Ça me donnait la chair de poule.
Certains jours, je faisais des contorsions tellement ça me tiraillait. Il suffisait de six tours pour conditionner une palette entière. Avec un cutter, je faisais un accroc dans le film qui se déchirait en une longue balafre et je le rabattais contre les cartons. Ça collait tout seul.
J’appuyais sur le bouton rouge. Stop. Le Fenwick enfourchait la palette, reculait, et l’emportait dans un camion qui attendait la remorque au ras du quai.
Un autre Fenwick arrivait.
Et ça repartait pour six tours. On n’avait pas trop le temps de se parler avec les conducteurs. Le matin, un petit signe de la main lorsqu’ils déposaient la première palette. Ils étaient salariés par une autre société et un Algeco leur servait de vestiaire sur le parking. Le soir, on se faisait un doigt d’honneur. Pas besoin de causer beaucoup pour sentir qu’on s’aime bien.
Le jet d’eau de Genève (Photo : Sylenius, CC-BY-2,5)
Le quartier de Palente, à Besançon, en 1984. Faubourg rural devenu cité de HLM dans l’urgence de l’après-guerre puis des Trente Glorieuses et de l’afflux de main d’œuvre Peugeot à Sochaux-Montbéliard, LIP y a été définitivement liquidée en 1979, quelques coopératives ouvrières en perpétuant encore l’héritage épars durant une dizaine d’années. Comme dans la Nemours du « Fief » de David Lopez, trente ans plus tard, une frontière invisible et mouvante sinue entre les barres de béton et les zones pavillonnaires adjacentes, au milieu des friches industrielles rendues progressivement à la nature désolée.
Au bout du parking Lip, j’ai bifurqué à gauche et longé la quatre-voies. Elle faisait frontière avec les HLM. Des immeubles de cent mètres de long sur six étages. A priori, pas mal de concurrence pour mon petit trafic. Et en fait non. De ce côté-ci, c’était le quartier des maisons, et avec les gens des HLM, personne ne se fréquentait. Pour eux, on n’était que des bourges vu qu’on vivait dans des maisons. Et pour les gens d’ici, ceux des HLM n’étaient que des feignasses enchaînant les gosses uniquement pour les allocs.
Au-dessus, les nuages bloqués par les montagnes du Jura pas loin prenaient le coin pour une pissotière, et des jours durant, ils se vidaient sur nos têtes pâles de faux bourges ou de vrais cas sociaux. Ce jour-là, il faisait beau. Ça arrive en juin.
Vagabondant entre jobs intérimaires et trafic de hasch à la plus ou moins petite semaine, le narrateur joue à saute-mouton avec les obligations comme avec les motivations, avec les frontières aussi, entre Jura français et Suisse des bords du Léman, jusqu’à s’imaginer un instant gigolo auprès d’une femme du double de son âge, dotée du sens de la fête et de solides appétits, jusqu’à voir surgir l’amour, et son cortège de possibles, agréables ou non.
Faux conte de la zone et vraie farce métaphorique douce-amère, ce « Cowboy light » paru dans la collection Qui-Vive de Buchet-Chastel en 2017 est le premier roman de Frédéric Arnoux, et propose à la lectrice ou au lecteur un énigmatique voyage, sous couvert de récit désolé, à la première personne, à propos de certaines voies sans issue apparues au fil des années, un voyage qui saisit à merveille l’une des zones de basculement et de dissolution du collectif (portant encore un peu d’utopie) dans l’individuel combatif, résolu et écrasant pour les autres. Et l’amour peut-il donc y résister ?
Je n’ai pas eu le temps de dire un mot. La Zote m’a agrippé la tignasse et m’a traîné derrière les clapiers de l’autre côté de la rue. La Raclure, lui, me faisait décoller du sol à coups de manivelle dans les côtes.
– Alors, tête de fion ? a commencé la Zote.
Impossible de sortir un son, j’avais le souffle coupé.
– T’entends c’qu’o’dit ? s’égosillait la Raclure.
J’ouvrais la bouche pour essayer d’avaler de l’air. Même respirer faisait mal.
– Tape dessus, Raclure, comme pour la télé.
Deux grandes gifles.
– Et là, t’as le son ?
– Quoi ? Bordel de merde ! j’ai gueulé.
– Dis donc, Raclure, mieux qu’avec la télé de la mère ! Et ils se sont tapé dans les mains comme les beaufs.
– Paraît que tu deales ? a entamé la Zote.
Frédéric Arnoux
Cowboy Light de Frédéric Arnoux, éditions Buchet-Chastel, collection Qui Vive
Charybde2 le 8/01/18
l'acheter ici