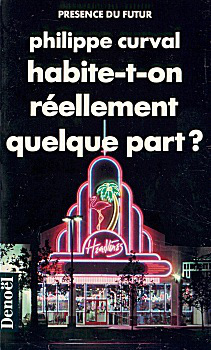Curval vient s'épancher chez Charybde et parler des ses nouvelles
21 nouvelles écrites entre 1975 et 2017 pour récapituler ou aborder l’un des monstres de la SF française
Qu’y a-t-il de commun entre un survivant qui se voit (littéralement) pousser des ailes, un ingénieur ivrogne errant avec son fils dans la jungle guyanaise, une jeune femme laissant d’elle une trace de selfies au Mexique, un homme seul sur une plage, avec son pliant essoufflé, son parasol décrépit et ses bières semi-enterrées dans le sable, un physicien pamphlétaire figé dans l’immobilité à une terrasse vénitienne de la via Garibaldi, une créature de silice explosant à l’intérieur d’un réfrigérateur, une thérapeutique de choc à base de livres en papier, seul remède connu à un virus galopant, un cuisinier aztèque s’interrogeant sur l’amour, ou encore un touriste chauve manquant mourir noyé au Kenya ? Toutes et tous ont été mis en scène, à un moment ou à un autre d’une carrière d’écrivain singulière et prolifique, par Philippe Curval, dans 21 nouvelles (choisies parmi plus d’une centaine par Richard Comballot) entre ses Passion sous les tropiques et Adamève de 1975, et sa Malinka est-elle morte ? de 2017, jusqu’ici inédite.
– Toutes mes excuses, maman ! Pardonne-moi de t’abandonner si vite, un acheteur important me demande sur une autre ligne », prétexta-t-il.
D’un clic, Guy Fortnum quitta le site. Depuis qu’il s’était abonné à Deathbook, sans doute le meilleur réseau social, qui permet aux « orphelins » de communiquer avec leurs défunts, c’était la première fois qu’il cédait à un mouvement de colère. Après tout, sa mère l’avait plongé dans un terrible embarras en mourant sans prévenir, d’un AVC fulgurant qu’aucun signe n’avait laissé présumer. Car, malgré ce qu’il venait d’affirmer, le lavage du linge sale en famille ne faisait qu’empirer. Pas à propos du principal dont le notaire avait réglé le partage sans problème. Mais au sujet de broutilles, la copie d’un bronze de Bugatti, une minuscule sanguine de Degas, un vase en porcelaine de Sèvres que chacun réclamait, le petit cendrier chinois aux trois singes, sans aucune valeur, des albums de photos, des livres papier, des vinyles antiques qui faisaient l’objet de conflits sentimentaux absurdes qui l’épuisaient. Au point qu’en raison d’un blocage qui avait réveillé chez Guy une intense fureur, il ne communiquait plus avec son frère et sa sœur. (Deathbook, 2015)
Lorsque l’on évoque la figure tutélaire de Philippe Curval, on pense souvent davantage à ses grands romans, beaucoup d’entre eux largement primés, depuis « L’homme à rebours »(1974), « Cette chère humanité » (1976) ou « Congo Pantin » (1995), jusqu’aux plus récents « Lothar Blues » (2008) ou « Juste à temps »(2013). La parution de ce recueil, « On est bien seul dans l’univers », en octobre 2017 aux éditions La Volte, constitue une occasion rare, pour la lectrice ou le lecteur, de retrouver la quintessence caractéristique de son écriture en forme courte, dans des nouvelles jusqu’à récemment accessibles uniquement par des revues désormais presque introuvables ou par des anthologies épuisées, disponibles seulement (et encore pas toujours) en occasion. Comme l’auteur le confiait en entretien avec Richard Comballot, et en substance, dans l’excellent « Clameurs – Portraits voltés » en 2014, même après avoir écrit plus d’une quinzaine de romans, l’art particulier de la nouvelle, la manière dont il faut y forcer la condensation de l’écriture et de l’idée, demeure peut-être le plus emblématique de toute la science-fiction, encore aujourd’hui, et même bien après qu’une certaine reconnaissance littéraire (toujours insuffisante) en soit intervenue.
Dans les papiers trouvés à l’intérieur de la boîte à gants de la Volkswagen bleu nuit, Julia avait écrit : « La lumière me saisit ». Exprimait-elle cette impression quelques jours ou quelques semaines avant sa disparition ? Aucune date manuscrite ne permettait de la savoir. Son journal avait été rédigé d’une manière intemporelle. Comme une suite d’annotations sans indication de durée. Et pourtant, d’après les factures d’hôtel qui l’accompagnaient, conservées avec soin dans le sous-main en plastique rouge façon séminaire d’entreprise, ses textes épousaient scrupuleusement son programme mexicain. Ils commentaient en pointillé les diverses photographies ultérieures découvertes dans ses valises. (« Un voyage objectif », 1987)
Le recueil permet de mesurer très concrètement à quel point cette obsession de l’adéquation entre l’idée et la forme adoptée pour l’y couler est et demeure, à travers les années, au centre de l’écriture de Philippe Curval. « Jongler avec les points de vue et les angles de perception, la fusion des genres, a toujours été mon obsession. Je m’y suis livré avec passion. » Si l’auteur n’a que rarement manié l’expérimentation formelle d’une manière aussi radicale que, par exemple, Antoine Volodine, Jacques Barbériou Emmanuel Jouanne, autour de l’époque du groupe Limite, son souci permanent de combler les fossés que s’ingénient à creuser, de part et d’autre, les thuriféraires des genres balisés et étiquetés, et du cloisonnement entre littératures, souci très perceptible dans ce recueil, s’est aussi illustré, au plan de l’exigence littéraire, dans son travail acharné d’anthologiste et de critique.
Philippe, malgré ses douze ans, pensa qu’il était temps d’intervenir dans la dérive de son père. Il se retourna avec son hamac, selon son habitude, et, face au sol, désengagea ses genoux enclavés latéralement dans les poches du tissu, se laissa glisser en avant, fit un rétablissement sur ses pieds nus et se faufila sous la toile. Dans ces cas-là, il se prenait pour un agouti, un pac, ou quelque gros rongeur frémissant de frousse. Surtout, ne jamais passer à ses yeux pour craintif. Pile, il s’arrêta au bord des planches, souleva délicatement ses orteils boueux pour vérifier s’ils fonctionnaient toujours, que son pied n’avait pas été piqué par un insecte à pustules urticantes. Ainsi, pourvoyant préventivement son imagination en frayeurs, Philippe n’avait jamais peur dans la brousse. (« Regarde, fiston, s’il n’y a pas un extraterrestre derrière la bouteille de vin », 1980)
En 21 occurrences ici, il est saisissant de constater, sur plus de quarante ans d’écriture en forme courte, la variété des techniques et des registres utilisés, des tons adoptés et des types de clin d’œil sous-jacents, le cas échéant. Si l’on voit rôder tour à tour comme une clef laxienne de Robert Sheckley (« Silane », 2004), l’étrange nostalgie habilement twistée d’un dernier homme(« Adamève », 1975), une ultime dégénérescence des « Vermilion Sands »de J.G. Ballard (« La vie est courte, la nature hostile et l’homme ridicule », 1998), de beaux échos retournés de la « Loterie solaire » de Philip K. Dick et du « Immortalité à vendre » de Joe Haldeman (« Au tirage et au grattage », 2003), et en plusieurs espaces discontinus, les ombres portées subtiles de Jorge Luis Borges ou d’Italo Calvino, on sera peut-être surtout frappé par l’omniprésence des cinq sens, à une échelle vertigineuse, et rarement aussi visible dans les romans de l’auteur. Comme il le disait lui-même dans l’entretien avec Richard Comballot mentionné plus haut : « C’est par le toucher, l’odorat, le goût, que nous percevons la réalité et que nous la mettons peu à peu en perspective. Ce travail des cinq sens est intéressant à plus d’un titre, mais essentiellement parce qu’il secrète des illusions. Grâce à eux nous réinventons le monde qui nous entoure, nous transformons nos souvenirs en hybrides qui n’ont qu’une vérité relative. » À la lecture, la réputation d’auteur sensuel (dont parlait alors André Ruellan) semble moins que jamais usurpée, et fait entre autres de l’écriture de Philippe Curval en forme courte une relative rareté dans la science-fiction, dont elle parvient pourtant à être si emblématique.
Le cadeau de Petterson s’avérait empoisonné. Quand je déchiffrai Malone meurt de Samuel Beckett, puis Impressions d’Afrique, de Raymond Roussel, et enfin Substance mort de Philip K. Dick, je faillis mourir d’une overdose.
Impossible de résumer mes tourments, mes abandons en quelques lignes. Si je n’avais pas mordu, dès mes premiers essais, à l’hameçon de la lecture, jamais je n’aurais triomphé de mes doutes et de mes périodes d’accablement. Mais j’étais ferré et me débattais avec l’énergie du désespoir. Plusieurs fois, j’atteignis le seuil du suicide. Juliette sut trouver les mots, les attitudes qui me permirent de surmonter les difficultés. Grâce à elle, j’acquis la certitude que la vraie réalité de l’espèce humaine se situait sur le versant du langage. Sa conquête ne s’obtenait qu’à travers la littérature, par le biais de la fiction. (« Canards du doute », 1997)
Même s’il est bien entendu risqué d’évoquer des thématiques principales, dans une sélection qui n’est après tout qu’un (bel) échantillon, et qui pourrait refléter avant tout les goûts de l’anthologiste, on notera que, si bon nombre des grandes préoccupations de la littérature et de la science-fiction sont ici largement présentes, trois d’entre elles semblent peut-être un peu plus marquées, le corollaire sombre de l’appréhension par les sens qu’est la question de l’illusion de la réalité (« Un voyage objectif », 1987 ; « La nécropole enracinée », 1984 ; « Malinka est-elle morte ? », 2017 ; « On est bien seul dans l’univers », 2000), celle du rapport à l’augmentation humaine et à l’immortalité (« Deathbook », 2015 ; « L’homme qui s’arrêta », 2009 ; « Perdre son temps », 2005 ; « Au tirage et au grattage », 2003 ; ainsi que le puissant billet final du recueil, « Écrire »), et enfin celle de l’enjeu constitué par la reproduction sexuelle, par l’amour et par leur impact social et politique (« Passion sous les tropiques », 1975 ; « Adamève », 1975 ; « L’enfant-sexe », 1977 ; « L’arc tendu du désir », 1995 ; « Parlez-moi d’amour », 2003).
Mais comment le saurais-je ? Déjà, à mesure que l’euphorie me gagne, je me défais de l’homme que j’habite. Comment ferais-je, plus tard, pour hanter en même temps que les miens cet esprit qui se refuse ? Ne risquons-nous pas d’être définitivement assimilés par lui ?
L’avenir dira qui sera le plus fort de celui qui mange ou de celui qui fut mangé, de celui qui pille ses tombeaux ou de celui qui absorbe la culture des Anciens qui les ont créés, enrichie par l’apport des millions d’étrangers à leur tour ensilés. Si nous triomphons, j’accepte sans remords d’être distribué en sachets de « nourriture ». (« La nécropole enracinée », 1984)
Philippe Curval
Ce recueil constitue bien ainsi une somme indispensable, et nous aurons le plaisir d’en parler avec Philippe Curval à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris) le mardi 17 octobre 2017 à partir de 19 h 30.
On est bien seul dans l'univers de Philippe Curval , éditions La Volte
Charybde2, le 17/01/17
l'acheter ici