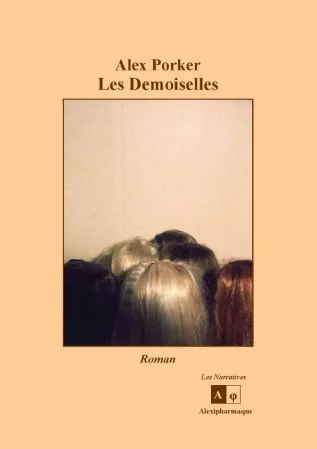"Les demoiselles" - L'enfance comme avenir malade de la consommation ?
Dans la chambre close de la violence hyper-enfantine. Sécrétion naturelle du fétichisme marchand ? Sujet pas facile et brûlant : le statut de l'enfant dans une société elle-même de plus en plus infantile. Un roman peut-il aider à comprendre ? "Un hyperenfant est un enfant – dont l’âge varie généralement entre 6 et 10 ans – qui se trouve être augmenté de comportements et d’attributs propres aux adolescents actuels de 16 ans et, par conséquent, potentiellement à tout autre jeune adulte. De sa morphologie enfantine, il conserve néanmoins l’apparence générale, la taille, l’absence de pilosité et une relative fraîcheur. Hyperprécoce tant sur le plan mental que physique, sexuellement actif, issu des classes privilégiées et disposant donc d’un pouvoir d’achat considérable, il peut évoluer à son gré dans la société adulte dont il est par ailleurs émancipé de toute autorité et de toute surveillance. Cette créature chimérique oisive a émergé de mon imaginaire par simple observation du champ culturel contemporain, et de sa tendance marketing régressive à surinvestir les qualités idiosyncrasiques de l’enfance et de son univers. Cet être transgénérationnel spéculatif est aussi le pendant mécanique, ou l’image érotique inversée, de l’adulte-enfant immature tel qu’il se présente aujourd’hui dans toute sa splendeur multifacette – atonie, inconsistance, instabilité, influençabilité, insatisfaction, futilité, perversité, narcissisme… – conséquence de la redoutable infantilisation progressive, ce totalitarisme mou, à l’œuvre au sein de la société". Alex Porker, auteur des "Demoiselles".
Publié en 2012 chez Alexipharmaque, le deuxième roman d’Alex Porker, après son « Makeup Artist » de 2010, aborde par un angle différent le travail exploratoire qu’il accomplit depuis son recueil de nouvelles, « Fermons les yeux, faisons un vœu », autour de l’hyper-enfance, concept qu’il développait ainsi dans un excellent entretien avec le Salon Littéraire :
Un hyperenfant est un enfant – dont l’âge varie généralement entre 6 et 10 ans – qui se trouve être augmenté de comportements et d’attributs propres aux adolescents actuels de 16 ans et, par conséquent, potentiellement à tout autre jeune adulte. De sa morphologie enfantine, il conserve néanmoins l’apparence générale, la taille, l’absence de pilosité et une relative fraîcheur. Hyperprécoce tant sur le plan mental que physique, sexuellement actif, issu des classes privilégiées et disposant donc d’un pouvoir d’achat considérable, il peut évoluer à son gré dans la société adulte dont il est par ailleurs émancipé de toute autorité et de toute surveillance. Cette créature chimérique oisive a émergé de mon imaginaire par simple observation du champ culturel contemporain, et de sa tendance marketing régressive à surinvestir les qualités idiosyncrasiques de l’enfance et de son univers. Cet être transgénérationnel spéculatif est aussi le pendant mécanique, ou l’image érotique inversée, de l’adulte-enfant immature tel qu’il se présente aujourd’hui dans toute sa splendeur multifacette – atonie, inconsistance, instabilité, influençabilité, insatisfaction, futilité, perversité, narcissisme… – conséquence de la redoutable infantilisation progressive, ce totalitarisme mou, à l’œuvre au sein de la société.
Dans cet univers balisé et détouré à traits pointus – mais laissant de jolies marges imprécises – par le recueil de nouvelles fondateur, Alex Porker a exploré avec son premier roman le devenir spectaculaire marchand et maladif de l’hyper-enfance comme reflet ultime d’une société hyper-cosmétisée. Avec « Les demoiselles », il explore une facette qui en constitue aussi, sans doute, une phase préalable, celle du réservoir de violence pré-adolescente absolue qui irrigue aussi avec force une société malade, celle de la consommation comme seul horizon et fétiche tout-puissant.
Le 17 septembre 2025 à Paris, un fait divers sans précédent fit la une de nombreux journaux. Dix ans se sont écoulés depuis, et, du dossier récemment déclassifié des « Demoiselles » (nom donné à l’époque par un journaliste du Parisien), de nouveaux éléments tenus longtemps secrets dans les archives de la police viennent apporter un éclairage inédit à cette affaire tragique qui défraya la chronique.
Sorti en octobre 2031, 5 rue Dickens (éditions Michel Lafon, sur des propos recueillis par Claire Félix), le livre du témoignage glaçant de la petite Julie Darrieux, 7 ans et demi au moment des faits, l’unique survivante de ce cauchemar à l’état pur, suscita en France une campagne de presse à grande échelle qui alerta les consciences sur le thème porteur de « l’enfance déviante ». Mais, si 5 rue Dickens fut rapidement promu au rang de best-seller dans une dizaine de pays, il faut se rendre à l’évidence : 10 ans après, à la vue de ces découvertes, cet ouvrage choc et, disons-le, un brin racoleur, ne suffit plus maintenant à décrypter ce qu’il faut désormais considérer non pas comme un phénomène isolé, mais bel et bien comme une possible et redoutable révolution sociétale en devenir.
En première partie, c’est la formidable et bien naturelle incrédulité de l’inspecteur confronté à cette affaire (« alors ») hors normes qui nous sert de fil conducteur pour tenter d’appréhender ce cauchemar en gestation, à travers le prisme du fait divers sordide, presque inimaginable d’abord, et terriblement révélateur ensuite. Il est dommage que cette partie, captivante, soit gâchée par moments par un excès de didactisme tandis que l’enquêteur passe en revue les faits, mais surtout leurs tenants et aboutissants, dans une perspective qui tient souvent davantage de l’essai socio-historique que du récit dialogué qu’il est censé être.
On découvrit quatre corps. Trois enfants, dont les cadavres incroyablement maigres et quasi momifiés, se fondaient presque dans le décor de ce dantesque capharnaüm. Ils étaient chacun recroquevillés à différents endroits de l’appartement, les yeux grands ouverts comme des poupées mortes ou bien telles d’hideuses statues, gardiennes putréfiées de quelque effrayant secret. Le quatrième cadavre, quant à lui, n’était pas beau à voir non plus. Il s’agissait des restes à demi rongés d’un adulte gisant dans la baignoire de la salle de bain, celle-là même d’où était sortie la petite Julie Darrieux, car tel était son nom. (…)
Une fois connecté, il éplucha ainsi la vie sociale de ces maudites jumelles. Et ce qu’il découvrit alors sur ce réseau parallèle lui fit froid dans le dos. Déverrouillées, leurs pages n’étaient qu’un ramassis malsain de ce qui pouvait se faire de pire au niveau de la pédopornographie inter-enfantine. Peu ou pas d’adultes. Il n’y avait que des enfants partouzant entre eux à l’infini sur les centaines de photos et de vidéos sidérantes que Jambart vit défiler devant ses yeux. Zoophilie, sadomasochisme, tout y passait dans la joie festive la plus abjecte. Et on se payait même le luxe du vintage cradingue avec ces vieilles cassettes numérisées où d’obscurs hippies sous LSD s’exhibaient nus en caressant leur bébé avant de le rouler dans la merde. Sans parler de ces antédiluviens films muets colonialistes des années 1930. Des pépites, à en croire les commentaires surexcités des gosses. Oh bien sûr pensa Jambart, ce n’était pas n’importe quelle enfance. C’était l’enfance dorée. Hyperconsumériste. Une enfance noyée dans un verre d’eau de piscine, une enfance insouciante jusqu’à l’os, belle jusqu’à la nausée, pénible progéniture dissolue et décadente issue d’un monde d’adultes qui ne se souciait guère désormais plus que d’une seule chose : leur ressembler.
La deuxième partie, en utilisant les fragments de journaux intimes et de cahiers retrouvés après le drame, vient détailler l’horreur de ce qui s’est produit, heure après heure et jour après jour, dans le huis clos tragique du 5 rue Dickens, que l’inspecteur Jambart a peut-être, partiellement, élucidé pour nous au préalable. Construction en abîme par laquelle se révèlent quelques variations sulfureuses et délétères, recensement d’erreurs d’appréciation et de rêves enfantins plus frelatés qu’il ne semble d’abord, concours d’influences et d’émancipations à rebours : il y a tout cela dans la résonance qu’entretiennent ces fragments d’un terrain miné avec l’apparence de rationalité adulte qui était dévoilée au préalable. Et je ne révèlerai bien entendu rien de l’éclairage surprenant qu’apporte la troisième et dernière partie, en forme d’épilogue et d’ouverture redoutable vers le reste de la saga en cours d’écriture.
Julie s’élança comme une flèche hors la chambre puis, sans réfléchir, elle prit à droite. Courant à toutes jambes, elle déboucha du couloir dans la pièce principale de l’appartement, un grand salon où régnait un foutoir pas croyable. Arrivée au milieu, elle s’arrêta et considéra un instant les lieux. La fenêtre murée, le silence pesant, et toujours cet éclairage aussi puissant que permanent. Devant elle, il y avait un large rideau, et derrière elle, de l’autre côté de la pièce, se trouvait un long bar américain avec une grande cuisine dont la fenêtre était également murée. Tournant autour d’elle-même, Julie ne savait plus quoi faire et se mit à pleurer. Elle passa le lourd rideau et se retrouva alors dans un couloir très éclairé qui lui paraissait véritablement interminable. Au bout, il y avait une porte, mais cette fois-ci, elle avait tout l’air d’être celle de la sortie. Julie se rua dessus et tenta de l’ouvrir. Rien à faire, elle eut beau s’acharner, avec sa serrure électronique, cette maudite porte était solidement verrouillée.
– Imposs, imposs.
Julie sursauta. Quand elle se retourna, elle vit Niki. Accoudée au mur du couloir, elle était nue, une cigarette à la main.
– Te fatigue pas, reprit Niki en tirant sur sa cigarette, cette porte ne s’ouvrira pas.
– Je veux rentrer chez moi ! cria Julie.
– Imposs. C’est ici chez toi, répondit-elle d’un ton las.
– Non ! Je veux voir mes parents ! Je veux rentrer à la maison !
– C’est ici ta maison, bailla-t-elle, pas d’erreur, l’oisillon est bel et bien rentré au bercail…
Julie se mit alors à hurler et à marteler la porte de toutes ses forces. Fatiguée par ce tapage, Niki fit la grimace puis se décida à intervenir. Elle s’avança vers Julie, lui prit la main et la tira de force dans le salon.
Lues en 2012, « Les Demoiselles » m’avaient largement désarçonné, et pour tout dire peu convaincu, par leur construction partiellement redondante et par leur écriture imprécise à mon goût. Après avoir lu plus tardivement « Makeup Artist », je comprends sans doute désormais beaucoup mieux l’articulation entre ces deux regards sur un phénomène, et donc la nécessité de cette exploration-ci, sous cette forme acide, brutale et mortifère – dont la froideur clinique, même, devient significative. Un troisième roman est à venir, que j’attendrai donc avec une certaine curiosité impatiente.
Il faut par ailleurs lire les excellentes chroniques et réflexions suscitées par la lecture d’Alex Porker sur le blog Cinématique de Ludovic Maubreuil, ici, ici et là. Les illustrations de cette note renvoient également à ces stimulants billets.
Coup de cœur de Charybde2
Alex Porker Les Demoiselles (éditions Alexipharmaque)
Vous pouvez acheter ce livre chez Charybde , ici.