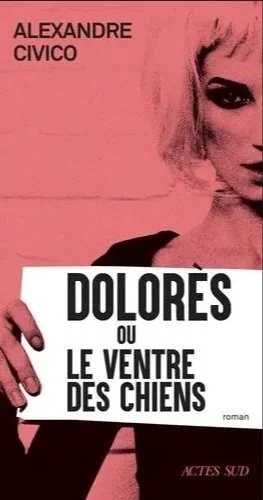La violence comme incandescence avec Dolorès et le ventre des chiens
Violence financière et patriarcale, contre-violence improvisée : à force, entre les deux, il n’y a plus rien. Un magnifique quatrième roman de feu et de flamme, poignant, rageur et néanmoins curieusement poétique.
Des poings contre la porte. Des poings d’hommes, des poings fermés, des poings si serrés que les jointures devaient craquer comme des noix sous des bottes. Des poings de colère. Ça criait. J’entendais à peine ce que ça disait. Le son était ouaté, presque onctueux, pourtant ça criait, pourtant ça hurlait. Puis ça s’est arrêté. Ça a grogné, discuté, frappé à nouveau du plat de la main. Et des pas lourds ont dévalé l’escalier, le bruit s’atténuant à mesure qu’ils s’éloignaient. Un peu de silence, enfin. J’étais assise dans cette mare humide et rouge, collante. Je continuais à caresser doucement sa tête comme une mère qui ne pourrait se détacher de son enfant mort-né. Rien qui vienne me traverser l’esprit. Pas un mot, pas une sensation. Je n’étais que cette main flattant une chevelure éparse. Du temps a passé mais je ne sais pas combien. Et puis c’est revenu. Les mêmes paroles, les mêmes voix qui se diffusaient doucement dans mes tympans mais qui ne parvenaient pas à construire un sens. Une suite de phonèmes que je ne rattachais pas entre eux. Soudain il y a eu un coup assourdissant, énorme, brutal. Suivi d’un deuxième. La porte a volé en éclats. Je n’ai pas levé la tête, j’ai vu leurs chaussures, des brodequins noirs et luisants. Quatre paires qui se sont précipitées dans la pièce. C’est elle, c’est sûr que c’est elle. J’ai entendu un appareil de transmission, ça crachait, il a dit je crois que c’est elle, je crois qu’on l’a. Il s’est adressé à deux des paires de brodequins luisants, vous restez là, vous appelez une ambulance et vous sécurisez. Il a sorti des menottes, m’a demandé de tendre les mains. Je les ai avancées, jointes, comme en prière. Il m’a relevée, a attrapé le manteau qui se trouvait dans l’entrée, l’a posé sur mes épaules. On l’emmène, les gars. J’ai levé les yeux sur un visage carré au regard bleu. Il m’a prise par le bras et m’a fait descendre l’escalier. Son camarade était avec lui. Il n’avait pas besoin de me tenir, lui. Un seul suffisait. Je ne risquais pas de leur échapper. La voiture était garée juste devant la porte de l’immeuble. Avant de sortir, l’homme au visage carré et aux yeux bleus a relevé le manteau et a couvert ma tête de manière à cacher mon visage. Il m’a poussée à l’arrière de la voiture. Le gyrophare tournait, bleu comme les yeux de l’homme au visage carré. La voiture a démarré en trombe. Ils ont appelé le commissariat, on leur a dit ne venez pas, pas tout de suite. Tournez. Visage carré a demandé confirmation. On vous a dit de tourner. On attend un fourgon. Le collègue de visage carré a ralenti. Son air con de flic avait quelque chose de délicieux. Il roulait sans savoir où aller mais hésitait tout de même par moments entre la droite et la gauche. Alors qu’il n’allait nulle part. Qu’il tournait. Il ne s’arrêtait pas aux feux. Il activait la sirène et passait prudemment les carrefours. Nous avons longé le Rhône ou la Saône, je n’en avais que foutre. Un large fleuve en tout cas. J’ai regardé les hauts immeubles haussmanniens. Ils étaient faits de la pierre qui dure, de la pierre qui protège, de la pierre qui étouffe le bruit des rues. Après un temps ça a éructé dans le poste. Allez à l’hôtel de police du 7e. Le chauffeur a fait un demi-tour acrobatique et a appuyé de nouveau sur l’accélérateur. Il avait l’air content de pouvoir faire son rodéo sur les grandes artères de la ville. Quelques minutes plus tard, il s’est arrêté devant un bâtiment administratif, blanc et vitres, s’est garé juste derrière un fourgon dont les portes se sont ouvertes. Visage carré est sorti de la voiture, en a fait le tour, a remis le manteau sur ma tête et m’a transférée d’un véhicule à l’autre. Les portières ont claqué très fort. On m’a assise sur un banc, entre deux flics armés. Un troisième, visage poupin, était en face de moi. Son fusil aurait dû être à bouchon tant il avait l’air jeune. Le fourgon a démarré. J’entendais à nouveau la radio. Sortez de la ville, on vous dira ensuite. Le flic-enfant avait l’air perplexe. La même expression que l’autre quand on a lui a dit de « tourner ». J’ai aperçu à travers le hublot que nous prenions l’autoroute. J’ai dit on va où ? Le gamin a hésité à me répondre. Le manteau commençait à glisser sur mes épaules, découvrant mon soutien-gorge. Je l’ai remis en place comme je pouvais.
Il a répondu on ne sait pas encore. Visiblement, on cherche un centre pénitentiaire pour vous accueillir.
– C’est légal, ça ? Je n’ai pas droit à ma garde à vue ?
– Vous êtes spéciale, il a répondu, vaguement gêné. On ne peut pas prendre le risque de vous garder dans un commissariat. Et puis, avec les dernières lois antiterroristes…
Au bout d’une demi-heure peut-être, la radio, encore. Un nom que je ne connaissais pas a été prononcé. Le fourgon a accéléré. Bientôt, j’ai entendu des sirènes devant et derrière. On nous escortait.
Le flic-enfant regardait mes cuisses du coin de l’œil, gêné comme un adolescent devant le décolleté un peu trop lâche de la mère de sa copine. J’ai rabattu un pan du manteau dont ils m’avaient recouverte pour le priver de la vue. J’ai imaginé un instant ce qui se tramait sous sa casquette. À portée de main, une chair rose, appétissante, interdite. Il devait bander à regret. J’étais Méduse, ou Circé, ou les sirènes de l’Odyssée. Bref, une salope. J’ai passé doucement ma langue sur mes lèvres et j’ai vu son regret devenir douleur. Les menottes marquaient mes poignets. J’avais froid, n’en disais rien. Le fourgon a cahoté une nouvelle fois. Le bruit du moteur grondant comme ronfle un ogre ne masquait pas les sirènes autour. Je ne voyais l’extérieur que par le hublot de la porte arrière, enfermée dans le ventre de métal d’un fourgon pénitentiaire, trois flics armés à mes côtés. Sous mes ongles, le sang avait séché. Il était brun, couleur de terre. La terre et le sang, la même chose.
Ennemie publique n°1 : depuis qu’elle a commencé, un soir, en assassinant un PDG rencontré en boîte de nuit qui croyait banalement que son argent et sa position sociale lui autorisaient n’importe quoi, qu’elle a récidivé, et – bien pire – qu’elle a fait de nombreuses émules, instinctivement décidées comme elle à menacer concrètement – et terminalement – la domination financière et patriarcale sans foi ni loi (autre que celle taillée le cas échéant à ses – souvent larges – mesures), toutes les polices françaises chassaient sans répit Dolorès Leal Mayor. Lorsque la cavale prend fin, son arrestation digne de celle du plus redoutable djihadiste la conduit directement à la case prison, sans passer par les cases commissariat, garde à vue, avocat, etc. : sa seule présence médiatique et – il faut bien le dire – populaire est une grenade dégoupillée pour tout gouvernement – et tout particulièrement pour un gouvernement dont la fragile légitimité est avant tout assise sur la défense de ceux qui vont bien et qui ont l’argent pour en témoigner.
La solution à ce dilemme de police, de justice et surtout de communication – maintenant que les éléments de langage constituent le seul horizon tangible d’une pensée politique : trouver un psychiatre aux abois, facile à manipuler et diriger, qui déclarera la terroriste – comme ils disent – plus ou moins folle à lier, ce qui permettra de l’enterrer vivante pour le salut de la communauté, sans passer par la dangereuse case du procès public. Cela tombe bien : le docteur Antoine Petit, bercé par l’alcool et la cocaïne, n’est pas du tout en position de décliner une offre que précisément, et selon la coutume bien connue, l’on ne peut pas refuser. Le voici donc en chemin pour la petite prison des Alpes où l’attend la prisonnière, sommé de produire rapidement un diagnostic sans appel.
Il reste bien, dans l’ombre ou dans la lumière qui aveugle, un troisième protagoniste : Pedro, le protecteur des situations désespérées, le vieux révolutionnaire habitué des luttes anti-fascistes, familier des surveillances et des vies ténues sous le radar sécuritaire, celui qui a couvé Dolorès en fuite (« Ce que tu as commencé, personne ne peut l’arrêter, Dolorès. Ça monte, ça déborde, ça va tout inonder »), celui qui s’inquiète et cultive pourtant l’espoir fou que, enfin, on y arrive – même par des chemins imprévus. Dans un monde tellement à bout, voilà peut-être l’étincelle à préserver quoi qu’il en coûte.
Je n’ai pas vraiment dormi. Me suis agité dans le lit, ressassant des choses que je ne ressassais plus depuis un moment. Avant de me lever, j’ai allumé mon portable. Une notification : un autre pauvre type s’était fait crever la peau au sortir d’un grand restaurant de la capitale. Cadre dirigeant d’une boîte de télécommunications. Une perte pour la France. Ça continuait.
Je me suis extirpé d’entre les draps, me suis vêtu rapidement, me suis à peine débarbouillé, et j’ai attrapé la convocation qui était assortie d’un billet de train pour une petite ville nichée dans les Alpes. Les échanges que j’avais eus avec le juge, le fait même qu’il ait pensé à moi m’avaient considérablement surpris. Je n’avais ma thèse en poche et mon nouveau poste à l’hôpital que depuis quelques mois seulement. J’étais, oui certes, officiellement psychiatre, mais j’avais supposé jusqu’alors que pour des affaires de cette ampleur la justice faisait appel à des confrères d’un autre calibre. Lors du premier coup de téléphone, reçu dans mon bureau, quelques jours après l’arrestation surmédiatisée de Dolorès Leal Mayor, j’avais même émis l’hypothèse qu’ils se soient trompés de personne. Ayant un nom relativement commun, j’envisageais possible qu’un autre Antoine Petit fût psychiatre dans un autre établissement. mais c’était bien moi qu’on voulait. Le magistrat instructeur avait fait ses recherches. Il avait été séduit par le sujet de ma thèse. Soit. Elle n’avait pourtant pas eu un écho retentissant au sein de l’académie, les facéties des autorités soviétiques n’intéressaient plus grand monde. Encore moins la créativité de leurs psychiatres et les diagnostics fantaisistes inventés dans le seul but d’enfermer les opposants.
Alexandre Civico excelle à créer des tunnels d’incandescence, rentrée ou explosive : confinée à l’habitacle d’une voiture lancée en course unique entre la France et l’Andalousie (« La terre sous les ongles », 2015), exposée aux vents secs du désert, de la savane ou de la ville désormais hostile (« La peau, l’écorce », 2017), circulaire et hantée autour d’un lieu de mise à mort légale, déjà (« Atmore, Alabama », 2019), ses irruptions de lumière noire et de colère fascinent et dérangent, nécessairement, sous la beauté de la langue qu’il invente pour chaque occasion tout en restant fidèle à sa belle écriture de chemin sec. Son quatrième roman, « Dolorès ou le ventre des chiens », publié en janvier 2024 chez Actes Sud, pousse son art bien particulier un cran plus loin encore.
Comme en écho actualisé d’une ancienne fureur froide, celle qui habitait les personnages fassbindériens du « Si les bouches se ferment » d’Alban Lefranc (là où la Fraction Armée Rouge tuait des fascistes – comme le condensait aussi si magnifiquement, bien plus récemment, le dramaturge Tiago Rodrigues dans un tout autre contexte – quoique…), Alexandre Civico confronte le bouillonnement de celles (et de ceux) qui ne peuvent plus supporter à un univers carcéral – dans lequel il a par ailleurs, et ce n’est pas neutre, assidûment pratiqué l’atelier d’écriture auprès des détenus. De ce choc tragique qui ne peut plus du tout être feutré, celui de la violence des dominations en place et des contre-violences improvisées, il extrait une fascinante démonstration incarnée. En déplaçant la redoutable équation posée par Mathieu Riboulet en 2015, il signifie ce qui sépare désormais Dolorès du ventre des chiens : entre les deux, il n’y a rien.
Un bureau, un ordinateur, deux chaises de part et d’autre du bureau. Une jeune femme à la queue de cheval haute était assise, raide, elle ne s’est pas levée pour m’accueillir.
– Je suis votre conseillère de probation. Je suis venue prendre un premier contact, savoir comment vous vous sentez.
– En prison.
– J’entends bien, j’aimerais savoir comment vous encaissez le passage derrière les murs.
– Je vous dirai ça dans quelques jours.
– Souhaitez-vous joindre quelqu’un à l’extérieur ? Voulez-vous que je prenne contact avec votre famille ?
– Non.
Je n’avais même plus ma mère. Elle était morte, avait cessé de baver quelque part dans un mouroir à des centaines de kilomètres d’ici quelques années plus tôt. Elle avait de toute façon fini par oublier complètement qu’elle avait une fille. Un genre de fille.
– Vous êtes en observation, ici au quartier arrivants. Vous serez transférée à la maison d’arrêt du centre pénitentiaire, d’ici quatre ou cinq jours. nous nous reverrons pour parler et mettre au point votre projet de détention. Si vous souhaitez me contacter, il faudra m’écrire.
Je n’ai pas relevé le terme de « projet de détention ». J’ai simplement esquissé un sourire vaguement narquois. Trop fatiguée. De projet, je n’en avais jamais eu. Ça n’allait pas commencer ici, au milieu du peuple des grilles.
Hugues Charybde, le 20/03/2024
Alexandre Civico - Dolorès ou le ventre des chiens - éditions Actes Sud
l’acheter chez Charybde, ici