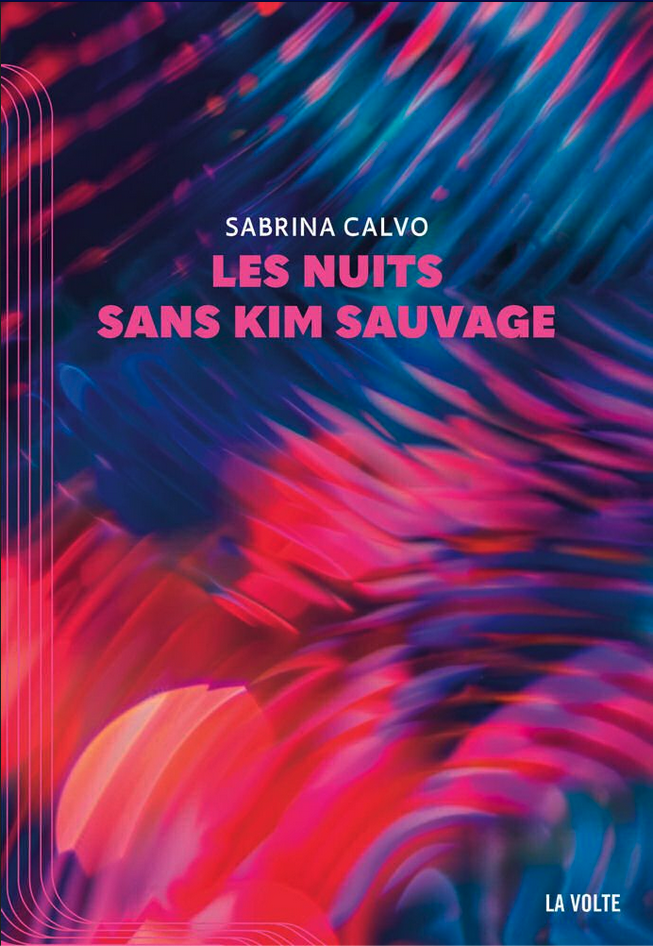Madame Smith s'ensauvage chez Sabrina Calvo
Entre réel et virtuel, entre étoffe drapée et technologie hackée, dans le tourbillon sans fin du marketing du luxe, une quête d’identité et de sens de haute volée, servie par une écriture éclairée d’invention et de précision.
Pas de note de lecture proprement dite pour « Les nuits sans Kim Sauvage », roman de Sabrina Calvo paru en septembre 2024 à La Volte : l’ouvrage fait en effet l’objet d’un petit article de ma part dans Le Monde des Livres daté du vendredi 11 octobre 2024 (à lire ici). Comme j’en ai pris l’habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l’article lui-même (et l’occasion de quelques citations du texte, bien sûr).
À l’enfance !
Impression de plages au bord du mur de l’Atlantique – bunkers sous un ciel d’oiseaux morts. Les vagues se hissaient, leurs crêtes brisées en mousse à l’écume. Dans cette transparence dérivaient les méduses au courant ascendant, descendant. Elles s’échouaient sur le sable – cerveaux s’opacifiant. Accroupie sur la rive je tâtais d’un bout de bâton leur agonie dans l’espoir peut-être d’y percer l’abcès de mon innocence.
Le jour de mon sixième anniversaire j’ai trouvé le courage d’en toucher une du doigt. Au début juste une phalange et lentement le reste de la main. Je me souviens de la sensation de passer mon être dans cette masse – un transfert d’émotions ou d’informations. Rester immobile à l’intérieur et pianoter des airs que moi seule entendais, litanies portées au vent de l’iode. J’ai resserré ma paume sur la glaire malaxée en triture de chaos. J’ai tenu cette purée au soleil et ses rayons lui ont donné éternité.
Je suis rentrée avec le reste de méduse entre les bras. Ma peau piquée de partout, dessins en hiéroglyphes chuchotant le secret d’un lieu magique. J’ai posé la dépouille sur la table du repas en proposant d’en faire une combinaison pour papa qui voulait plus sortir du canapé, déjà soumis à son casque. Alors, pour le souper, mère m’a obligée à manger la méduse crue. Je me souviens d’un goût âcre comme du sel en gelée. Et l’éveil d’un endroit de malheur tout au fond de moi.
Entre deux marées.
Comme je le signale très brièvement dans l’article, et sans remonter à Roland Barthes et son « Système de la mode »(1967) ou à Gilles Lipovetsky et son « L’empire de l’éphémère » (1987), c’est bien William Gibson qui, dans sa trilogie inaugurée avec « Identification des schémas » (2003) et poursuivie par « Code source » (2007) et « Histoire zéro » (2010), s’attaque certainement le premier aux liens d’abord improbables entre la technologie et la mode faite luxe (luxe qui s’est réaffirmé, en ces vingt dernières années de capitalisme tardif, comme seul horizon décidément indépassable pour le taux de marge – avec la tech impalpable, justement) : signe de signes, comme il l’écrivait en déplaçant le sillon ouvert par la Naomi Klein de « No Logo » (1999), et comme le fouaille ici Sabrina Calvo avec son incomparable brio, au cœur du matériel comme du virtuel.
Face au vertige de la mode, Sabrina Calvo, comme elle l’avait déjà montré de moins en moins subrepticement, face aux masques de Mickey grimaçants, dans son « Melmoth furieux » (2021), sait déployer l’art de la couture sous toutes ses facettes, geste matériel s’il en est – comme s’en constitue aussi un, parallèlement, par les doigts du codeur. Comme en une anthropologie du geste chère à Marc Graciano, il se tisse ici à nouveau une étoffe différente, celle des songes incubés à l’exact opposé du spectaculaire marchand encore et toujours ressassé.
Quand papa s’était décidé à déménager à Paris, pour travailler sur le chantier de l’Ouvert, il avait dit : depuis qu’il y a ce trou dans la couche d’ozone, les eaux s’évaporent alors ils ont construit ces immenses halles sous la coupole de Paris pour protéger les forces vives de la nation – c’est à elles qu’il revient de bâtir l’avenir. Papa avait dit qu’ici notre maison était trop loin du signal source, qu’il fallait être au plus près du cœur battant du nouveau monde s’il voulait devenir le héros de sa propre vie. Il lui fallait toujours plus de vitesse. J’ignorais encore le prix que devaient payer ces premiers ouvriers du virtuel, abrutis dans leurs cellules à machiner les bords d’un univers désirable. C’était le stade final du monde accéléré divisé compacté. Réduit aux pixels d’or. Pour père, tout ce qui se passait dans l’Ouvert était devenu la seule façon d’œuvrer dans le réel. Les fantasmes devenaient monnaie d’échange et père s’imaginait prendre part au plus grand ouvrage de France Réconciliée depuis la construction des cathédrales.
Mère, son rêve à elle c’était de défiler pour ces Maisons de mode qui prenaient tant de place dans notre quotidien – la renommée d’une haute couture nationale devenue art de vivre. Je la regardais le soir quand elle empruntait le casque de papa pour se mettre nue devant la glace et se draper dans l’infini de son caprice. Elle pour qui j’avais tendresse et admiration, pour ses cheveux blonds et ses énormes fesses cellulite. Pour ses bottes, que je lui enlevais le soir quand elle rentrait du travail. Elle qui savait comment faire des châteaux de sable et qui m’apprenait tendrement à m’habiller en me murmurant « depuis le centre de toi qui t’appartient, exprime tout » ; elle qui était le monde pour moi, elle disparaissait. Je savais que malgré cette force en elle, ses robes d’été, ces peintures à moitié finies dans le local technique de la piscine, tous ces paysages intimes qu’elle n’osait plus offrir à personne, pas même à son propre regard, je savais qu’elle ne souhaitait plus qu’une chose : se réfugier elle aussi dans l’Ouvert et profiter comme le reste de l’humanité des merveilles de l’être qui s’achève.
Moi, je voulais faire partie de leur monde. Je voulais être acceptée pour qui j’étais. À six ans, je n’étais pas moins moi-même et ma pensée n’en était pas moins légitime. Je n’avais rien d’autre que mes mains et mes méduses et mes rêves simples d’être une petite fille que tout le monde aimerait.
Enfant bannie des merveilles du virtuel orchestré.
Sabrina Calvo excelle aussi, comme nous avions pu le constater sous des formes différentes de celle adoptée ici, dans « Elliot du Néant » (2012), « Sous la colline » (2015) ou « Toxoplasma » (2017), dans la création littéraire d’une rare mélancolie sans tristesse. Le clip de Laurent Voulzy à propos de ces « Nuits sans Kim Wilde » en constitue bien sûr ici l’emblème, avec sa beauté investigative (soutenue par la dissémination de nombre d’autres discrets indices d’un état d’esprit parfois inattendu) qui parvient – et c’est bien d’art littéraire dont il s’agit alors – à échapper à la psychologie du kitsch qui hante (comme le rappelait en son temps le Milan Kundera de « L’insoutenable légèreté de l’être ») le vintage et le rétro organisés par le capitalisme tardif (et dont le clinquant nanti et autosatisfait de la série « Emily in Paris », que je mentionne en conséquence dans l’article du Monde des Livres, constitue une forme d’aboutissement logique et navrant).
Migraine flash en coup de semonce. Sous la couette je pose une main au creux de mes grottes – là où je me rassure quand le drapé du rêve se fige dans le marbre de ma life.
J’ouvre mon coquillage sur le fil des collections de la veille – déchets d’une Fashion Week dans la splendeur de ses ruines. Je tire les galeries d’images vers le haut, froncé de looks et de runways. Je mémorise chaque détail, chaque combinaison d’unités de mode répétées ou modifiées depuis les collections précédentes. Rien ne s’invente : tout est multiplication de boucles dans des boucles. J’y trouve satiété, hygiène intime. Par petites touches je compose mon humeur du jour : une frustration sans objet, boléro Miyake, skinny tee Brandy Melville et combi débraillée sur Buffalo compensées.
Suivant la ligne d’excitation qui me remonte du périnée, j’ouvre de vieilles photos de Nova : Nova dans sa joie d’être nue offerte et ses gestes beaux sans fin ses boobs et sa chatte en piscine sous ciel de palmiers. Mes cavernes en écho de sa sexualité libre, vagues dont je réprime toute mousse. J’ai pris la bonne décision, tous les matins je me dis que j’ai pris la bonne décision. L’abandonner, c’était me sevrer du malheur. Me donner le droit de vivre. Exister ici et maintenant, pas là-bas, pas dans ce putain de temps fucké. Avant que je ne décide de laisser Nova pour toujours dans les bas-fonds de l’Ouvert, je pouvais vivre dix ans en quelques heures. Nova ne vieillissait pas. Aujourd’hui j’ai l’impression d’avoir cent deux ans. Je n’en ai que dix-neuf. Ici dans le Clos, le temps s’écoule lentement, tellement lentement.
Ça vibre dans le coquillage. Les filles s’affolent sur le groupe de la rédaction – et gnagnagna t’as vu la coll de Jacquemus avec les strings furoncles ?
Fuck, où sont mes lunettes ?
– Wat, je texte de mon pouce valide.
– Pow-wow bitch, écrit Valérie.
– Minute please.
– On t’attend pas.
Dehors, la nuit éternelle vitrifie les halles de Nouvelle-Arcologie.
Et là – le feu dans mon eau.
Je retrouve ma paire de Chloé sous Bladet, mon lit, ami fidèle qui me supporte sans moufter. Il y a de la buée sur les prismes. Je vérifie le système et je retourne en rampant sous Jansjö, ma couette refroidie. Je la remercie de me donner tant de confort – la pauvre : des fois la nuit quand je cauchemarde je la jette par terre et je me demande si ça lui fait mal.
Je respire, mes deux paumes à plat sur le ventre. J’ai faim et tout dans ce corps demande sommeil et vallées profondes, pas travail, pas putain d’écran. Je trouve dans mon dos un étirement qui me rappelle que je me néglige depuis des semaines. Ça n’a pas vraiment d’importance : je n’ai plus rien à me mettre.
Les signaux des verres clignotent vert. Je plugge les lunettes au coquillage. Je teste le pastel de mes ongles connectés – ça ne glitche plus. Presser trois touches sur le minuscule clavier déplié, fragments phosphorescents rose pute édition limitée Cardin × Arashi.
Souffle prend racine.
Cerveau boote en parade de feedbacks et blam – tout gris.
Le fond du virtuel – banalité glaciale. Odeur d’algues et de javel.
Mon bureau se compose depuis le rien, fragments par unités – lignes immaculées. Mon mug Phil Collins. Mes catalogues de fringues, des échantillons et des produits tests que nous envoient les annonceuses, des bodys en petit mesh remap, shoes et collerettes, visuels de serpents. Des revues concurrentes à décortiquer, pour y piocher des détails de looks destinés aux stories du numéro en cours : Magie des glaces ; Vision d’une portée de mue ; Alhambraxxas et Dans la mâchoire des ventres Ciels. Je scrute les images de ces femmes dépliées dans des positions impossibles, habillées comme par magie. Mort × frivolité.
Autour de moi des collègues échangent sur le chan des informations sur comment s’incruster à tel ou tel défilé. Certaines se vantent d’avoir leurs entrées chez SheinKlein, comme si c’était un putain de privilège. Elles veulent se prouver qu’ici, dans l’Ouvert, c’est bien réel. Que cette salle de réunion, ces bureaux, ce job, c’est bien concret. Elles gloussent sans me regarder, des oies sans ombres. Je jalouse pourtant chacune d’entre elles, ces meufs bien sapées qui prennent bien soin de me snober. Elles ne savent pas que je sais tout d’elles, rien qu’en les observant. J’ai catalogué tous les détails de leurs outfits. Je suis capable de déceler chaque variation d’humeur. J’ai en moi l’intégralité de leurs larmes, de leurs kinks. Tout est statut et moi je me crois super-modasse mais tout dans mon allure dit la cheap pétasse et tout le monde peut voir que je fais bien trop d’efforts pour pas avoir l’air aussi nulle que je ne le suis en réalité. Hypnotisée dans mes draps sales, une goutte de pipi au fond de la culotte.
L’une des notes de basse qui hante « Les nuits sans Kim Sauvage » est familière aux lectrices et aux lecteurs de Sabrina Calvo : comme dans ses ouvrages précédents, et en mode pas si mineur que cela, un regard circonstancié sur la matière technologique est porté ici, comme mine de rien, comme un questionnement acquis et en permanence indispensable. Ni technophilie, ni technophobie, car ce n’est pas ainsi que les femmes et les hommes vivent – dans leur chair comme dans leur âme -, mais un patient debunking de toute une mythologie de la hackeuse et du hacker, mythologie ailleurs trop souvent considérée comme une donnée, et qu’il s’agit tout le temps d’éprouver au fil des péripéties et des absorptions marchandes. Ni de toute-puissance, ni d’impuissance, un chemin existera pourtant, que Vic et Maria Paillette sauront emprunter à leur manière unique.
Enfin, et peut-être surtout, Sabrina Calvo démontre une fois de plus – et peut-être plus que jamais – qu’en matière de science-fiction comme de littérature « en général », tout est bien affaire d’écriture, qui transforme l’idée en pensé et en ressenti, et en vécu – de plus d’une manière, nous permettant de plonger matériellement dans des affres réputées ne pas être les nôtres. Qu’il s’agisse de charge mentale ou d’identité de genre, de road novel souterraine ou de clignotement entre réel et virtuel, l’inventivité et la précision de la langue de l’autrice, son rythme propre et sa poésie secrète, lui permettent de donner chair et sens à ces nuits qui n’en sont pas vraiment. Et c’est ainsi que la littérature est grande.
Valérie grogne. Elle porte le chignon haut dans un tailleur Jil Sander jaune canari. Moi j’ai honte dans ma robe à fleurs Jennyfer et mon string dentelle.
— Si personne n’a d’idée, on mettra une pub.
On dit que Valérie élève des piranhas capables de dévorer toute intrusion dans son corail. Tout le monde la craint. C’est notre cheffe à toustes. Pour nous autres à Jeudi, elle n’existe que dans l’Ouvert. Elle garde sa présence physique pour Thursday, Rive Gauche. Nous ne sommes rien. Tout Nouvelle-Arcologie sait que Jeudi est un magazine publirédactionnel à destination des plus jeunes. 96 % de notre contenu édito est recomposé par l’algorithme propriétaire du groupe, nous on se charge juste de trouver des annonceuses locales et on ajoute des conseils beauté, du chinage, des adresses de cantines nanobio et un courrier des lectrices généré aléatoirement.
— Le filet Chanel × Zoloft est pas encore maquetté…
— Il faudrait un bouche-trou.
Valérie scanne la salle. J’essaie de me faire toute petite mais trop tard : vers moi son sourire carnassier.
— Souvenirs, souvenirs.
Je blinke. C’est la rubrique que j’avais imaginée il y a un mois, pendant la semaine des Possibles où toutes les stagiaires du journal pouvaient rêver d’un poste fixe de rédactrice. Correction : que Maria Paillette m’avait suggéré de proposer. J’avais refusé de l’écouter parce que je voulais pas faire du zèle et me mettre en première ligne. Parce que je me trouvais pas assez belle.
Ptin, Maria Paillette.
— Prends ça comme une promotion chatonne.
La secrétaire de rédaction ouvre une fenêtre pour me faire glisser tout le sujet de la rubrique – nostalgie pourrave – la décennie 80 c’est le gros biz du moment. Un clip d’une chaîne musicale, « MCM », un article. Des photos.
— L’idée c’est de nous faire un petit topo sur les fringues de ce clip ringard. Le manteau du chanteur c’est peut-être un Montana, il y a aussi une petite robe noire, une chemise à jabot et, mm, des lunettes. Je ne sais pas comment réagir. Je ne veux pas m’exposer. Mon job, c’est de donner des informations aux autres. Pas d’occuper le devant de la scène : c’est le meilleur endroit pour se griller. Ce milieu est impitoyable. Tout le monde va me jalouser cette petite miette de toute petite gloire.
— Good ?
Valérie m’observe les bras croisés. Est-ce qu’elle sait ce qui se cache en moi, dans le mou de Jansjö que je malaxe du bout du pied ? J’ai l’impression qu’elle me sonde, qu’elle me tend un piège, à moi la nobody.
Tout ce qui me vient, et que je tais :
Rendez Perséphone à sa mère.
Gros malaise. Valérie disparaît dans un nuage mais les rédactrices restent concentrées sur leurs notes en m’ignorant, leurs yeux fardés d’eau lustrale et leurs cheveux tirés en arrière. Génériques et belles. Parfois, j’ai envie de croire qu’il y en a une qui serait secrètement amoureuse de moi. Elle cacherait son désir aux autres et le soir, elle me penserait allongée et le cœur battant de me retrouver au matin, incapable de me dire combien sa vie ne vaut rien sans moi.
Je me téléporte à mon bureau.
Pas t’énerver, meuf, souviens-toi de tes exercices de respiration vaginale.
— Maria, je chuchote dans mon micro.
Rien.
— Maria ! je gueule.
Dans une nouvelle fenêtre de mon champ optique, Maria Paillette sort la tête de sa salle de bains, s’essorant les cheveux.
— Ma chérie.
— T’étais où ?
— Au bain. Pourquoi tu cries ?
— La rubrique Souvenirs, souvenirs.
Silence.
— Ils ont dit oui ?
— Je te déteste.
— Crie pas.
— Pourquoi tu l’as proposée ? Je t’avais interdit de l’envoyer.
— Crie pas je te dis.
— Je crie pas ! je crie.
Maria met les oreilles en arrière.
— T’es vraiment fâchée ?
Elle me gave, Maria Paillette. Elle est complètement buggée Maria Paillette mais j’ai pas les moyens de la remplacer. Elle était livrée avec le système d’exploitation des Chloé et y a plus de support d’update pour cette version d’assistante depuis deux ans.
— Faut vraiment pas m’en vouloir, je voulais bien faire et te rendre service. Des fois, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, et moi je suis là pour t’aider. J’ai cette manie un peu vieillotte de tout bien faire tu sais, j’y peux rien, je suis comme une vieille grand-mère, ou le toutou dans Fraggle Rock.
— Tu me saoules, Maria Paillette.
— Pardon pardon pardon pardon.
J’essaie de trouver un endroit pour accepter ses vrilles et sa dépendance affective. Sa fonction originelle n’était qu’une reconnaissance de formes et puis c’est devenu une reconnaissance tout court. C’est ma faute : je peux pas m’empêcher de penser que je lui ai laissé une trop grande place dans ma vie.
Hugues Charybde, le 21/10.2024
Sabrina Calvo - Les Nuits sans Kim Sauvage - édiions La Volte
l’acheter chez Charybde, ici