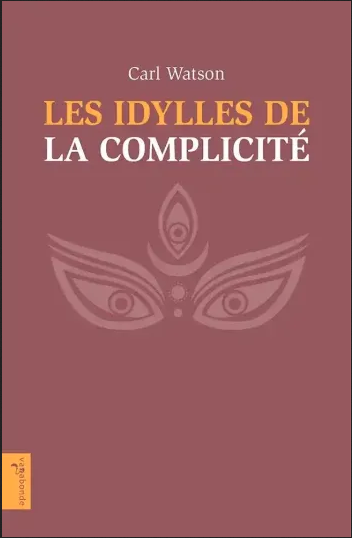Tardif, comme le capitalisme d'aujourd'hui et ses idylles…
Deuxième voyage en compagnie de Frank Payne : des années 80 entre Chicago et l’Inde, en guise de liquide révélateur, pour une décennie qui broie des rêves déjà malmenés et impose sa lecture à sens unique d’une histoire intime du capitalisme tardif. Avec une écriture encore plus éblouissante que précédemment, peut-être.
Sophie se passionnait pour les tueurs en série et les vrais crimes. je lui racontai qu’une nuit sombre et orageuse à Bloomington, dans l’Indiana, je fus pris en stop par John Wayne Gacy, et qu’à un feu rouge je bondis hors de sa voiture. Voilà pourquoi je pouvais lui faire la cour aujourd’hui. Elle m’accusa, hilare, de créer de toutes pièces un souvenir falsifié.
« Non, protestai-je, c’est réellement arrivé.
– Dans tes rêves », renchérit-elle.
Je réalisai que tout ce que je lui dirais serait dès lors considéré comme la métaphore d’un désir refoulé. Cela devint même un jeu entre nous. Un jour, je lui rapportai qu’enfants, nous vandalisions les cimetières des environs, que c’était une manière de banaliser la mort. Nous manipulions des crânes à l’occasion de rituels de fertilité. Les adolescents de notre ville avaient une sacrée réputation : acclimatés au goût de la mort, nous relevions n’importe quel défi et en tirions plaisir.
Peu importait à mes yeux que les histoires fussent authentiques. Sous la couverture ocre d’un ciel sulfureux, rafraîchi par les vents d’ouest imprégnés de la puanteur du bétail abattu et entouré de rivières dont les émanations piquaient les yeux, il était nécessaire de rêver. Les bibendums buveurs de bière qui faisaient grossir les culs rêvaient de déguster des burgers près du barbecue au fond du jardin, tandis qu’une volière aux couleurs sucrées gazouillait et que les arbres gris de la pépinière Gary affectaient d’être verts. Les filles des gros pleins de bière rêvaient de chevaux, de voitures rapides et de la Californie, pendant que la rivière Calumet poursuivait sa course à travers les marais infestés. Ce n’était ni le Danube, ni le Gange, ni la Seine. Comme on ne pouvait pas s’y baigner, ni jouer au troubadour sur ses berges, on racontait des histoires à dormir debout.
Une grande partie du présent récit – ou plutôt les conversations qui l’émaillent – se déroule dans des bars, tous reliés par des trous de ver spatio-temporels tels des cordons ombilicaux entre les mots et les événements, transformant une causalité aléatoire en destin narratif. Et voilà comment je me suis retrouvé sur Falkland Road, à Bombay, dans un rade appelé le Rava Lounge. Le Rava se trouve au terminus de la ligne de Falkland Road. Ce n’est pas un bar indien typique – je veux dire par là que la clientèle n’y est pas exclusivement masculine ; il est fréquenté par des marchands, des voyageurs, des prostituées – l’écume débordant de l’Olympia Café, situé un peu plus loin dans la rue. Mais le Rava accueille moins de monde, et il est beaucoup moins chic. Il y a pourtant des ventilateurs au plafond, l’eau courante, tous les équipements classiques – c’est un rade cool, en somme.
Je pourrais volontiers le décrire comme un havre de paix parmi les hurlements des prostituées à cinquante roupies enfermées dans leurs cages, le vacarme des charrettes tirées par des ânes, les porteurs d’eau et les chaiwallahs, mais cette description ressemblerait à un cliché. On pourrait du reste m’accuser de recopier ce cliché trouvé dans quelque brochure de voyage ou roman d’aventures. Or les clichés, même dérangeants, sont souvent vrais. Ce sont les quartiers nord de Bombay, après tout, pas deux de Paris ou d’Istanbul. Il faut décider de ce qu’on veut : l’existentialisme, une intrigue digne de la guerre froide ou l’aliénation postcoloniale dans les rues chaudes du tiers-monde.
Je buvais une de ces grandes bouteilles bien glacées de Lord Ganesha Lager – une tête d’éléphant posée sur un corps d’homme, un mythe finissant en icône sur une bouteille de bière qui m’adressait des signes de kung-fu amicaux ou, si vous préférez, des signaux de sémaphore, comme pour essayer de guider mon esprit volage, tel un avion errant, jusqu’au tarmac de l’ivresse alcoolisée, ou du moins un épisode introspectif. À vrai dire, je ne savais pas ce que je faisais là, ni pourquoi je persistais à croire Sophie vivante. Sophie Marie. En buvant un verre, je prononçai son nom à voix haute, comme un signe de ponctuation pour chasser les pensées vagabondes qui aboutissaient à elle. J’ignore pourquoi ; c’était une idée stupide. Si j’avais des archives photos en tête, je pourrais sans doute comparer les souvenirs, confronter telle idée à telle autre, leur accorder une note de félicité, peut-être. Mais ce n’est plus le « peut-être » d’autrefois. Et puis, je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Cela est sans doute lié aux parasites qui infectent mon esprit.
Il y a quelque chose du grand prestidigitateur chez Carl Watson : celui qui vous montre d’abord soigneusement qu’il n’a rien dans les mains ni dans les poches, qui vous montre ses poignets sans abris cachés, et qui réalise pourtant devant vous, quelques minutes plus tard, le tour impossible auquel vous n’osiez pas croire. « Les idylles de la complicité », publié en 2016 et traduit en 2023 par Brice Matthieussent toujours chez Vagabonde, deuxième volume de sa souple trilogie amorcée avec le magnifique « À contre-courant rêvent les noyés » en 2012, où l’on retrouve Frank Payne (même s’il ne se dévoilera – et ce sera j’espère le seul spoiler que je vous infligerai – qu’à la page 45) en narrateur et conducteur, relève de cette magie-là : même après plusieurs exposés aussi programmatiques que sarcastiques soigneusement intégrés, sans traces de coutures résiduelles, aux premières pages du roman, le déroulé implacable de la narration, quittant les années 70 où la figure tutélaire était celle de Janis Joplin pour les années 80 où elle se détriple en Kali, Vierge Marie et Maria Callas, saura nous surprendre jusqu’au bout (avec toujours ce redoutable maniement d’ellipses temporelles lorsque nécessaire : celle de la page 214, notamment, est particulièrement somptueuse) tout en exécutant pourtant fidèlement le programme.
Les Hindous croient que nous vivons actuellement au quatrième stade de l’univers, connu sous le nom de Kali Yuga, la vertu étant au plus bas et l’espérance de vie humaine la plus faible. (Il ne s’agit pas de Kali Ma, mais du démon Kali, du Kalki Purāna et du Mahâbhârata.) Le Kali Yuga est une époque maléfique, aucun doute là-dessus – on la nomme « le dernier coup de dé ». À la fin de l’ère de Kali, l’apocalypse arrivera sous la forme d’une jument émergeant du fond de l’Océan. Des flammes inextinguibles jailliront de sa bouche. C’est une image formidable, une vision catastrophique. Sophie croyait obstinément à une sorte de cataclysme de nature métaphysique, à un châtiment mérité par les humains. On décelait cette croyance derrière toutes ses extravagances, comme le désespoir qui se cache derrière le rire. Mais c’était peut-être une posture, un stratagème destiné à séduire un homme pessimiste. Eh bien, dans ce cas, cela fonctionna. La route qui me mena à Sophie et au-delà était en effet pavée de personnages qui auraient adoré me mettre en garde : Kathe et Bernadette, Rajinder et Boggs, ainsi qu’Arnaud. Sans oublier Sonny – Sonny Valentine, un nom qui ressemble à une mauvaise blague quand on l’entend pour la première fois.
Ces hommes évoquent désormais de simples mécanismes. Quant aux femmes, j’entends toujours la voix de chacune d’elles, je vois leurs jupons voleter sous mes yeux tandis qu’elles lèvent très haut la jambe en dansant le french cancan dans le canon d’un flingue. Sophie était partie maintenant. Mon boulot consistait à expliquer sa disparition, à comprendre le comment et le pourquoi des choses. Je n’ai jamais été très bon pour ça. Par contre, j’excelle à pointer les défauts d’autrui. Mais ce n’est pas une qualité qui vous rend très populaire. C’est ce qui explique en partie pourquoi je me trouvais à Bombay, au Rava Lounge, et pas au Studio 54, sur Broadway. Je buvais une Lord Ganesha Lager bien glacée. Cette bière, on ne la trouve que là : la lager du dieu de la bonne Fortune. Et j’allais voir besoin d’un peu de ça.
Si la folie à deux qui caractérisait « Une vie pyschosomatique » (2008) voit ici son identité profondément renouvelée, c’est bien sous ses auspices que démarrent « Les idylles de la complicité ». Lorsque le voyage en Inde (opérant à mi-chemin entre une nouvelle déconstruction du mythe routard, une rusée satire de la figure de l’écrivain-voyageur – Carl Watson lui-même a séjourné deux fois trois mois dans le pays, dans les années 70 puis dans les années 80 – et un musardage à la Fabcaro du « Carnet du Pérou » autour du cliché touristique et de l’imposture qui peut si aisément l’accompagner) du couple formé par Frank et Sophie, qui y cherche – peut-être sans réelles illusions – son salut, prend son essor, c’est en réalité, dans ce sillage, toute la véritable folie de la décennie néo-libérale broyeuse qui s’abat sur les protagonistes, et, bien au-delà, sur une certaine vie interstitielle qui avait pu exister jusque là. Et dans les réflexions de Frank, servies à nouveau par une langue incroyablement habile, c’est toute la capacité prouvée du capitalisme à absorber, retourner et annihiler ses critiques (on songera certainement à l’ouvrage essentiel de Luc Boltanski et Eve Chiapello, leur « Nouvel esprit du capitalisme » de 1999) qui se déploie sans pitié sur les rêveries et les songes, qu’ils soient pleins ou creux.
En mobilisant diverses forêts de symboles (en toute conscience baudelairienne avouée à plusieurs reprises), parmi lesquels on trouvera aussi bien le jeu vidéo « Déjà vu » et James Ensor que Joseph Conrad et Francis Ford Coppola (« Nous recherchions volontiers le cœur sombre des lieux, leur Kurtz métaphorique dans la jungle de l’émotion »), « Pinball Wizard » que Paul Bowles (l’ensemble du roman pourrait se lire, sous une certaine lumière, comme un formidable palimpseste de « Un thé au Sahara »), Carl Watson nous offre une exceptionnelle mise en abîme (en toute lucidité permanente : « Je commençais néanmoins à m’inquiéter : trop de chansons pop affluaient aux moments cruciaux de mon récit ») de cet écrasement de l’individu par les icônes (et les modes de vie et de pensée qu’elles supposent) et de la complicité intime, de facto, des protagonistes avec ce qui les mine. En construisant ainsi, avec un machiavélisme peut-être encore plus affirmé (même si l’écriture se fait ici moins directement expérimentale) que dans « Hôtel des actes irrévocables » (1997) ou « Hank Stone et le cœur de craie » (2011), une double résonance sublime avec le travail d’un Hartmut Rosa autour de la vitesse, de l’accélération et de la disponibilité, ou d’un Jeremy Rifkin autour du capitalisme de l’accès, d’une part, et avec la vie conçue comme une pure narration, hommage au récit et aux récits, où l’on trouverait, au fond de la classe et du paradoxe, le sourire énigmatique d’un Milan Kundera, d’autre part, Carl Watson continue pour nous ses éblouissantes métamorphoses – en attendant le troisième volet à venir de cette trilogie, dont il se dit que la figure musicale principale serait cette fois Billie Holliday.
À cette époque, aucun d’entre nous n’avait d’ailleurs un vrai boulot. Nous ne connaissions que les emplois temporaires. Je collaborais en freelance à des catalogues, rédigeant des articles sur des chaussures disco en plastique fabriquées à Atlanta. Sophie bossait à son compte comme assistante pour installer les vitrines de Fields. Kathe avait un boulot temporaire dans la publicité, et son nouveau petit ami ouvrait des huîtres à la demande chez Nick’s, un restaurant de fruits de mer du centre ville. Quelques personnes commençaient cependant à se faire embaucher dans ce qu’on appelait alors de « secteur informatique ». Personne ne savait très bien de quoi il retournait et une partie du travail consistait semble-t-il à le comprendre. Nous allions surtout dans des clubs et à des fêtes où des gens qui nous ressemblaient discutaient de sujets censés nous intéresser – art et groupes de rock, poésie et littérature, sans oublier les ordinateurs.
Nous étions dans les années quatre-vingt et les conflits fantasmés flottaient dans l’air du temps. Compte tenu de leur rivalité féroce, Macintosh et IBM auraient pu être des équipes de football. Les néo-expressionnistes se bagarraient contre les pré-imagistes, qu’ils considéraient comme dépassés. Les super-réalistes flamboyants détestaient tout le monde, surtout les surréalistes tardifs. On comptait aussi les expressionnistes musculeux et les néo-préraphaélites éthérés. Chaque étiquette esthétique possédait son uniforme. Certains portaient de la peau de requin, d’autres des pantalons sport. Je connaissais même des types qui confectionnaient des T-shirts éclaboussés de peinture pour sortir en boîte.
Cependant, il régnait un ennui général dû au sentiment que tout avait déjà été réalisé. Le monde paraissait vieux. Et le monde était vieux – voilà ce qui consternait plus que tout la plupart des gens. Nous avions pourtant besoin qu’il soit vieux ; cela facilitait notre quête d’authenticité, un concept ou une qualité dont beaucoup doutaient même de l’existence. Cela donna naissance au syndrome « dénonce le bluff », selon l’expression inventée par Bernadette pour signifier que tout le monde essayait de disqualifier tout le monde en le taxant de poseur.
« Oh, c’est un indécrottable plouc », entendait-on ; ou : « Ce n’est pas un artiste, juste quelqu’un qui a fréquenté une école d’art. »
Un autre sujet de discussion fréquent tournait autour de la question de « se vendre ». On ne savait jamais bien quand cela se produisait au juste – quand telle ou telle personne se vendait, ni ce qui était vendu, ni à qui. À en croire certains, ce virage pris était clairement un moyen de s’affranchir d’une pauvreté auto-infligée. Nombreux étaient ceux qui se trouvaient des deux côtés de la barrière, et ils avaient du mal à prendre position sans être embarrassés. Bernadette soutenait que tout cela relevait d’un énorme fiasco, qu’il valait mieux ne pas s’en mêler et profiter du spectacle de loin. Le capitalisme digérait ses ennemis et faisait de nous des pantins. Plus personne ne savait ce qui était bien ou mal. Avant qu’une chose n’arrive, on la désirait, et dès qu’elle était arrivée, on la haïssait, tout en continuant à l’aimer en secret. Personne, toutefois, ne l’aimait suffisamment pour l’avouer. On pouvait participer à toutes sortes d’événements, ou pas, selon qu’on admettait ou non sa propre ambition. Si l’on ne voulait pas la reconnaître, on était soit « trop pur », et donc risible, soit un menteur. Tirer à balles réelles sur la Vierge Marie ou assassiner son épouse relevait d’une simple échappatoire – plus de décisions à prendre, finie la comédie : une paillasse, trois repas quotidiens et plein de temps libre pour rédiger ses mémoires.
Il faut lire les commentaires utiles que l’on trouve dans Gainsayer (ici) et dans A Gathering of the Tribes (ici), mais surtout le bel entretien dans Addict Culture avec Velda (ici), paru à l’occasion du volume précédent de la trilogie.
Hugues Charybde, le 5/06/2023
Carl Watson - Les idylles de la complicité - éditions Vagabonde
l’acheter chez Charybde ici