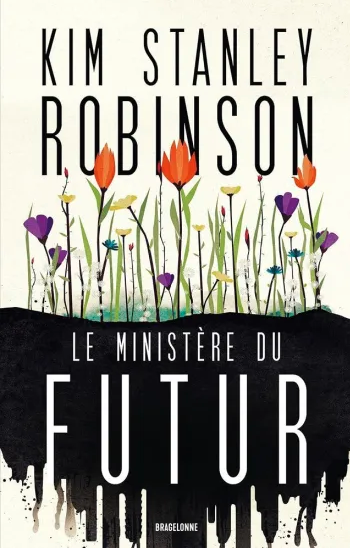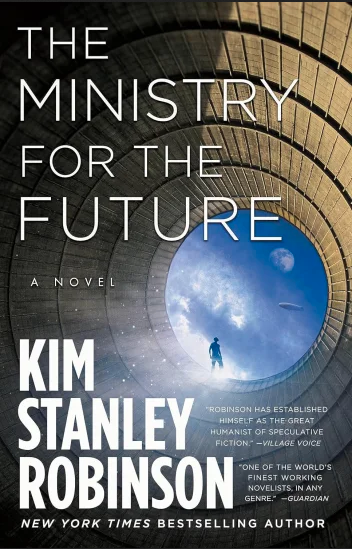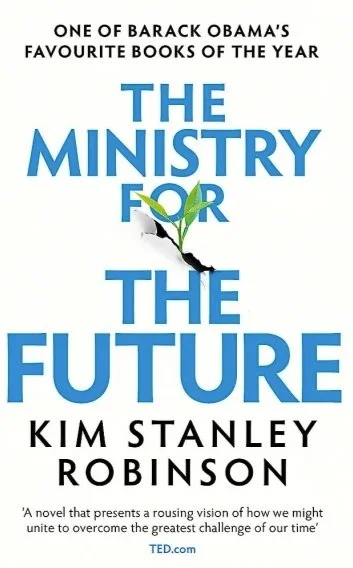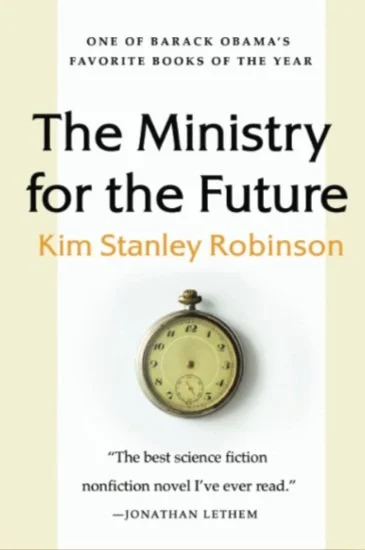Le ministère du Futur (de Kim Stanley Robinson) est-il amer ?
Le roman explosif de la fin de l’inaction climatique. Un chef d’œuvre indispensable, aboutissement provisoire de tout le travail de Kim Stanley Robinson.
Pas de note de lecture proprement dite pour ce redoutable chef d’œuvre : il fait en effet l’objet d’un petit article de ma part dans le Monde des Livres du jeudi 16 novembre 2023 (daté vendredi 17 novembre), à lire ici.
Comme il est désormais de coutume en pareil cas, je me contenterai donc ici d’ajouter quelques considérations et citations, comme autant de notes de bas de page pour l’article en question. J’attire par ailleurs votre attention sur les deux prochains épisodes du Planète B de Blast, qui traiteront largement aussi de cet ouvrage, d’abord en tant que summum d’un certain type de fiction climatique, ensuite dans le cadre d’un entretien d’une heure avec Kim Stanley Robinson.
Il faisait de plus en plus chaud.
Frank May quitta son petit matelas et s’avança jusqu’à la fenêtre. Murs et tuiles ocre, couleur de l’argile locale. Immeubles carrés, comme celui où il se trouvait, toits-terrasses occupés par des résidents qui y dormaient la nuit pour échapper à la chaleur des appartements. À présent, certains d’entre eux regardaient vers l’est par-dessus les garde-corps. Ciel du même ocre que les immeubles, teinté de blanc là où le soleil ne tarderait pas à apparaître. Frank prit une longue inspiration. Qui lui rappela aussitôt l’atmosphère des saunas alors que c’était le moment le plus frais de la journée. Il n’avait pas passé plus de cinq minutes de sa vie dans un sauna, faute d’apprécier la sensation. L’eau chaude, d’accord ; l’air chaud et humide, non. Pourquoi s’infliger une telle impression d’étouffement ?
ici, impossible d’y échapper. Frank n’aurait pas accepté le poste s’il avait su. Cette ville était jumelée à la sienne, mais ce n’était pas la seule, de même qu’il existait d’autres structures humanitaires. Il aurait pu travailler en Alaska. Sans que sa propre sueur lui pique les yeux. Il était déjà trempé, son short aussi, le matelas aussi, là où il avait essayé de dormir. Il crevait de soif mais la bouteille près du lit était vide. Toute la ville résonnait du bruit des climatiseurs, qui bourdonnaient comme des moustiques géants.
Puis le soleil surgit sur l’horizon. Avec l’éclat d’une bombe atomique, ce qu’il était par définition. Le contre-jour assombrit champs et bâtiments dans cette direction, tandis que la tache lumineuse s’élargissait, devenait un croissant aveuglant. La chaleur qui en émanait gifla Frank. Les radiations solaires lui brûlaient la peau. Ses yeux baignés de larmes ne voyaient plus grand-chose. Tout était ocre ou beige ou d’un blanc insoutenable. Une ville ordinaire de l’Uttar Pradesh à 6 heures du matin. Il consulta son téléphone : 38 °C. Ce qui faisait en Fahrenheit – il pianota – 103°. Humidité aux alentours de trente-cinq pour cent. C’était cette conjonction le vrai problème. Quelques années auparavant, il se serait agi de l’une des plus hautes températures humides jamais enregistrées. Non pas d’un simple mercredi matin.
Des gémissements affligés montèrent du toit d’en face. Cris d’horreur poussés par deux jeunes femmes penchées sur le garde-corps, vers la rue. Quelqu’un sur ce toit ne se réveillait pas. Frank s’empressa d’appeler la police. Pas de réponse. Dur de savoir si la communication passait. Des sirènes retentirent, distantes, comme noyées. Avec l’aube, les gens trouvaient des dormeurs en détresse et ceux qui ne se réveilleraient jamais de cette longue nuit torride. Alors ils cherchaient de l’aide. Les sirènes indiquaient que certains appels avaient abouti. Frank vérifia de nouveau son téléphone. Chargé, connecté. Mais aucune réponse du poste de police qu’il avait déjà contacté plusieurs fois depuis son arrivée quatre mois plus tôt. Encore deux mois à tirer. Cinquante-huit jours, beaucoup trop. Le 12 juillet et toujours pas de mousson en vue. Il fallait se concentrer sur chaque journée, une à une. Avant de retourner à Jacksonville en Floride, ridiculement fraîche par comparaison. Frank aurait bien des histoires à raconter. Mais ces pauvres gens sur le toit d’en face…
Le bruit des climatiseurs cessa d’un coup. Provoquant d’autres cris d’horreur. Plus de connexion sur le téléphone. Plus d’électricité. Baisse de tension ou coupure totale ? Les sirènes beuglaient comme tous les dieux et déesses du panthéon hindou.
Les générateurs prirent le relais, engins braillards à deux temps. Carburant illégal – essence, gazole ou kérosène – gardé en réserve pour ce genre d’occasion, passant outre la loi qui imposait le gaz naturel liquéfié. L’air, déjà pollué, ne tarderait pas à s’emplir de vapeurs d’échappement. Autant se mettre le pot d’un vieux bus sous le nez.
Frank toussa rien que d’y penser. Il voulut s’abreuver mais la bouteille était toujours vide. Il l’emporta en bas, la remplit d’eau filtrée au bidon placé dans le réfrigérateur de la réserve. L’eau était encore fraîche malgré la coupure de courant et le resterait un moment dans la bouteille isotherme. Il y ajouta un comprimé d’iode pour faire bonne mesure puis vissa fort le bouchon. Le poids de l’eau le rassura.
La réserve de la fondation abritait en outre deux générateurs et assez d’essence pour tenir deux ou trois jours. Rassurant, là aussi.
Tout d’abord, il faut noter (on en reparlera aussi dans l’entretien avec l’auteur pour Planète B) que « Le ministère du futur » constitue une nouvelle démonstration de cette capacité si rare de l’auteur californien, celle de présenter toujours à la lecture un univers mental évolutif, une histoire du futur mobile et non dogmatique, dans laquelle ses anticipations romanesques intègrent nouvelles informations scientifiques, nouvelles approches socio-politiques, voire virevoltes presque purement littéraires (il y a ici un curieux point commun avec la manière dont un Alain Damasio peut par exemple assez largement « désavouer » certains partis pris de « La zone du dehors » dans « Les furtifs », vingt ans après). Ainsi, si « La trilogie martienne » de 1992-1996 n’est pas intégralement prise en compte dans « 2312 » en 2012, et moins encore dans « Aurora » en 2015, on trouvera ici (dans un roman publié en 2020 avant d’être traduit en français en 2023 par Claude Mamier chez Bragelonne) une résonance particulièrement fructueuse quant à l’état de l’art de la lutte pour le climat et la justice sociale qui doit inévitablement l’accompagner en comparant les éléments scientifiques, bien entendu, mais surtout les composantes politiques – voire géopolitiques – mobilisées ici par rapport à celles de « S.O.S. Antarctica » (1997) ou de la « Trilogie climatique » (2004-2007) (sans remonter nécessairement jusqu’à son « Lisière du Pacifique » de 1992), et même de « New York 2140 » (2017) – le traitement réservé à la finance de marché en étant particulièrement emblématique – et de « Lune rouge » (2018), pourtant beaucoup plus récents : Kim Stanley Robinson apprend de chacune de ses immersions romanesques, et nous en fait toujours plus que bénéficier, en intelligence comme en émotion, dans ses créations ultérieures.
L’article 14 de l’accord de Paris, régi par la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, prévoit un point régulier sur les émissions de carbone des États signataires, ce qui revient à calculer la quantité totale de carbone émise dans le monde l’année en question. Le premier « bilan mondial » était prévu en 2023, suivi d’autres tous les cinq ans.
Ce premier bilan se déroula fort mal. Les rapports, incohérents et incomplets, permirent néanmoins de constater que les émissions de carbone demeuraient largement supérieures aux promesses faites par l’ensemble des Parties à l’accord, malgré le plongeon de 2020. De rares nations respectaient leurs engagements chiffrés, pourtant pas fixés bien haut. Conscients du problème dès avant le bilan de 2023, cent huit pays avaient accru leurs promesses, mais il s’agissait de petits États responsables au total d’environ quinze pour cent des émissions.
L’année suivante, lors de la COP – la Conférence des Parties -, une poignée de délégations signalèrent que l’accord, dans son article 16, disposition 4, spécifiait que la COP pouvait prendre « les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective », notamment par la création des « organes subsidiaires jugés nécessaires ». Ces délégations prirent pour exemple l’article 18, disposition 1, qui créait explicitement deux de ces organes. Lesquels étaient jusqu’à présent considérés comme de simples comités se réunissant durant la COP annuelle. Mais elles arguèrent que, vu l’échec flagrant mis en lumière par le bilan mondial, il fallait créer un nouvel organe investi de missions permanentes et doté des ressources pour les mener à bien.
Ainsi, lors de la COP29 tenue à Bogota, en Colombie, les Parties actèrent la création d’un nouvel « organe subsidiaire jugé nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord » sur la base des articles 16 et 18, financé comme prévu à l’article 8 par le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques. La résolution fut approuvée sous la forme suivante :
« Il est décidé, par la vingt-neuvième Conférence des Parties signataires de l’accord de Paris, de la création d’un organe subsidiaire chargé de travailler avec le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, avec toutes les agences des Nations unies et tous les gouvernements signataires de l’accord de Paris, afin de plaider la cause des générations futures de citoyens du monde dont les droits, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme, sont aussi valables que les nôtres. De plus, ce nouvel organe est chargé de défendre toutes les créatures vivantes présentes et à venir qui sont dans l’incapacité de s’exprimer par elles-mêmes, en promouvant leur statut légal et leur protection physique. »
Un journaliste crut bon de surnommer cette agence « le ministère du Futur », une expression qui se répandit comme une traînée de poudre au point de devenir l’appellation usuelle de ladite agence. Elle s’installa en Suisse, à Zurich, au mois de janvier 2025.
Peu de temps après, la grande canicule s’abattit sur l’Inde.
Ensuite, comme dans chacune de ses œuvres, des plus concises (notion toutefois toujours quelque peu relative dans le cas de Kim Stanley Robinson) aux plus amples, « Le ministère du futur » peut à bon droit impressionner par la variété et la profondeur technique du jeu déployé, entrant souvent en résonance avec les recherches contemporaines les plus pointues en matière de science « dure » : on sait au moins depuis la « Trilogie martienne », « S.O.S. Antarctica » et la « Trilogie climatique » que la glaciologie, la compréhension intime des milieux (très) froids et montagnards – que l’on se souvienne aussi de l’étrange recueil de nouvelles « Les Martiens » – ou la géo-ingénierie – dont le traitement n’a rien à envier ici au précurseur Norman Spinrad de « Bleue comme une orange » ou au tout récent « Choc terminal » de Neal Stephenson – ne présentent guère de secrets pour le docteur en littérature (dont la thèse, en 1984, portait sur « Les romans de Philip K. Dick », sous la direction de Fredric Jameson) intensément féru de documentation physique, chimique, géologique ou biologique. On constate ici avec bonheur que cette curiosité précise et boulimique s’étend aussi, plus que jamais, à l’économie et aux sciences humaines, avec une analyse des mécanismes financiers et fiscaux (déjà finement abordés dans « New York 2140 » trois ans plus tôt) que ne renieraient ni Thomas Piketty (à qui le nom d’une taxe imaginaire particulière est notamment dédié dans le roman) ni David Graeber (dont le « Dette : 5 000 ans d’histoire » irrigue vraisemblablement une partie de ce texte), ou encore avec une prise en compte des méthodes nécessaires de lutte très en phase avec celle d’Andreas Malm. Dans un excellent entretien pour Médiapart (ici) et dans celui à venir dans Planète B, Kim Stanley Robinson précise d’ailleurs qu’il aurait ardemment souhaité avoir lu « Comment saboter un pipeline » (2020) – qui, rappelons-le néanmoins, pour les organes de sécurité ayant du mal avec certaines lectures, n’est PAS un manuel de maniement d’explosifs brisants – avant la rédaction du « Ministère du futur », afin de mieux différencier l’indispensable éco-sabotage (cher au précurseur Edward Abbey et à son « Gang de la clef à molette ») de l’éco-terrorisme beaucoup plus problématique – qui doit donc rester un pur artifice fictionnel.
Le ministère du Futur était dirigé par Mary Murphy, une Irlandaise de quarante-cinq ans, ancienne ministre des Affaires étrangères de la république d’Irlande et, avant cela, avocate en droit syndical. Ce jour-là, en arrivant au bureau, elle trouva son agence plongée dans une crise qui ne l’étonna pas un seul instant. Impossible de ne pas être tétanisée par l’horreur de la canicule en Inde. L’événement meurtrier aurait à coup sûr de lourdes conséquences ; la première frappait déjà à la porte.
Le directeur de cabinet de Mary, un petit homme mince nommé Badim Bahadur, suivit sa supérieure dans le bureau ministériel.
– Tu sais que le gouvernement indien lance une opération de gestion du rayonnement solaire ?
– Oui, j’ai vu ça ce matin, répondit-elle. Ils nous ont fourni les détails ?
– C’est arrivé il y a une demi-heure. Nos géo-ingénieurs affirment déjà que, si l’Inde suit ce plan, ça équivaudra plus ou moins à l’irruption du Pinatubo en 1991. Laquelle a fait chuter la température mondiale d’environ un degré Fahrenheit pendant un an ou deux. À cause du dioxyde de soufre contenu dans le nuage de cendres que le volcan a propulsé dans l’atmosphère. D’après nos experts, les Indiens mettront plusieurs mois à reproduire une telle décharge de dioxyde de soufre.
– Mais ils peuvent le faire ?
– Sans doute, avec leurs forces aériennes. En tout cas, ils vont sûrement essayer puisqu’ils ont assez d’avions et d’équipements. En gros, il suffit de reconfigurer le système de ravitaillement en vol. Les avions balancent toujours du carburant par-dessus bord, donc ce ne sera pas bien difficile. leur vrai problème, ce sera de monter le plus haut possible. Ensuite, c’est juste une question de quantité de vols. Il en faudra des milliers.
Mary sortit son téléphone de sa poche et appela Chandra. La cheffe de la délégation indienne pour l’accord de Paris n’était pas une inconnue. Il se faisait déjà tard à Delhi, mais c’était l’heure habituelle à laquelle les deux femmes communiquaient.
– Chandra, c’est Mary. Je peux te parler une minute ?
– Juste une minute, alors, dit l’Indienne. Je suis très occupée.
– Je m’en doute. C’est quoi cette histoire d’imiter le Pinatubo avec votre armée de l’air ?
– Nous espérons même le réitérer en deux fois plus puissant. C’est ce que recommande notre Académie des sciences, et le Premier ministre a donné son aval.
– Mais l’accord… (Mary s’assit pour se concentrer sur la voix de son interlocutrice.) Tu sais ce qu’il dit. Pas d’intervention atmosphérique sans consultations préalables.
– Nous rompons l’accord, annonça froidement Chandra.
– Personne ne sait quels effets ça pourrait avoir !
– Les mêmes que le Pinatubo. En deux fois mieux, donc, avec un peu de chance. C’est exactement ce qu’il nous faut.
– Tu ne peux pas certifier qu’il n’y aura aucune répercussion inattendue si…
– Mary ! s’exclama Chandra. Arrête, Mary. Je connais par cœur tout ce que tu vas me dire. Ce que je peux te certifier, c’est que des millions de personnes viennent de mourir en Inde. Nous n’aurons jamais de chiffrage précis, c’est trop difficile à compter. Peut-être vingt millions. Tu comprends ce que ça veut dire ?
– Oui.
– Non. Tu ne comprends rien. Je t’invite à venir voir par toi-même. Pour ton édification personnelle.
Mary déglutit, soudain à bout de souffle.
– Je viendrai, si c’est ce que tu souhaites.
Long silence au bout de la ligne. Chandra reprit, la voix serrée :
– Merci, mais ce serait trop compliqué pour nous de gérer ce genre de visite en ce moment. Tu verras les images dans les rapports. Je te les enverrai dès qu’ils seront prêts. Tu dois bien te rendre compte que nous avons peur, et que nous sommes aussi très en colère. Ce sont l’Europe, les Etats-Unis et la Chine qui ont causé cette canicule, pas nous. je sais que nous avons brûlé beaucoup de charbon ces dernières décennies, mais sans commune mesure avec les émissions occidentales. Pourtant nous avons signé l’accord. Nous avons même fait notre part. Mais personne d’autre ne tient ses promesses, personne ne soutient financièrement les pays en voie de développement, et voilà qu’on se prend cette canicule ! Ça peut recommencer la semaine prochaine ! Les conditions climatiques n’ont pas changé !
– Je sais.
– Oui, tu le sais. Tout le monde le sait, mais personne ne bouge. Donc nous prenons l’affaire en main. Nous allons abaisser la température mondiale pendant quelques années, ce qui bénéficiera au monde entier. Ainsi, nous éviterons peut-être un autre carnage.
– D’accord.
– Je ne t’ai pas demandé ta permission ! hurla Chandra.
– Ce n’est pas ce que je voulais dire.
Mais l’Indienne avait déjà raccroché.
Enfin, Kim Stanley Robinson propose ici un ensemble de choix formels de narration qui sublime une bonne partie de ses précédentes mises en évidence de savoir-faire littéraire.
Il a été noté de longue date, parfois de manière exagérément critique, que l’auteur s’affranchit très fréquemment du célèbre adage à l’emporte-pièce, fétiche des ateliers d’écriture de tout poil, qu’est le « Show, Don’t Tell ». Kim Stanley Robinson a amplement prouvé au fil du temps qu’il est plus que capable de « montrer », mais qu’il refuse absolument de se priver de la ressource de la discussion : ses personnages aiment à débattre et à échanger des arguments, éclatante concession au réalisme, justement (et le final de « S.O.S. Antarctica » en constitue sans doute le summum dans son œuvre). Le dialogue technique entre personnages jouera donc ici un rôle tout à fait instrumental, mais l’orchestration d’ensemble va bien au-delà.
La polyphonie (au sens de Mikhaïl Bakhtine) jouait déjà un rôle essentiel dans le travail de Kim Stanley Robinson : si toutes ses œuvres sont concernées, la « Trilogie martienne » ou sa monumentale uchronie, « Chroniques des années noires », en sont particulièrement emblématiques. « Le Ministère du futur », en tant que roman choral, va également beaucoup plus loin. De même, en un sens, que le Harry Parker de « Anatomie d’un soldat » avait su donner la parole à une vaste sélection d’objets pour saisir la complexité de la guerre en Afghanistan, il s’agit ici d’étendre le champ potentiel des témoins, locuteurs et acteurs bien au-delà des seuls humains : on trouvera ainsi, aux côtés des scientifiques, technocrates onusiennes, humanitaires, activistes, politiciennes ou simples passantes, un certain nombre de narrateurs étranges, allant d’atomes et de corps astraux jusqu’à des protocoles financiers ou des mécanismes fiscaux. Et c’est bien ainsi, dans cette multiplicité foisonnante mais toujours signifiante, que la littérature en général et la science-fiction en particulier sont capables de faire partager les aspects les plus systémiques, les liaisons enchevêtrées mais pourtant pas intouchables, des complexités auxquelles l’humanité est confrontée, en extrême urgence désormais.
Pendant un certain temps, il sembla que cette grande canicule était destinée à connaître le même sort que les fusillades de masse aux États-Unis : un crime déploré par tous, puis vite oublié ou remplacé par l’occurrence suivante, jusqu’à ce que la répétition finisse par instaurer une forme de normalité. Cette catastrophe, la pire semaine de l’histoire de l’humanité, était-elle appelée à suivre le même chemin ? Après tout, combien de temps resterait-elle « la pire semaine » ? Et que pouvait-on y faire ? « Plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme » : le vieil adage prenait un sens de plus en plus littéral.
Mais pas en Inde. Les élections suivantes éjectèrent les nationalistes hindous du BJP, parti au pouvoir jugé à la fois inapte à la tâche et en partie responsable du désastre puisque ses représentants avaient vendu le pays aux intérêts étrangers, brûlé du charbon et ravagé les terres tout en aggravant les inégalités. Le mouvement extrémiste RSS, dont le BJP était l’aile politique, tombait enfin en disgrâce auprès des Indiens. Un nouveau parti accéda au pouvoir, une formation composite regroupant des membres de toutes les religions et de toutes les castes, des intellectuels, des pauvres des villes et des pauvres des champs, unis par le grand désastre et par leur volonté de changement. L’élite traditionnelle perdit sa légitimité et son hégémonie tandis que les résistances éparpillées fusionnaient dans un parti nommé Avasthana, mot sanskrit signifiant « survie ». La plus grande démocratie du monde s’engageait soudain dans une nouvelle voie. Les producteurs d’électricité privés furent nationalisés, après quoi l’Inde entreprit de gros efforts pour fermer ses centrales à charbon et les remplacer par de l’éolien, du solaire, de l’hydroélectricité au fil de l’eau, sans oublier d’investir dans le stockage énergétique sans batteries afin de compléter la capacité croissante des batteries existantes. D’autres changements se dessinaient en parallèle. Le pays s’efforça par exemple d’annihiler les pires effets du système des castes ; cette volonté n’était pas neuve, mais s’élevait à présent au rang de priorité nationale parce qu’une part suffisante de la population était prête à s’y atteler. Dans l’Inde tout entière, les gouvernements locaux œuvraient au déploiement de ces réformes.
Ensuite, même si beaucoup le regrettèrent, une faction radicale de cette nouvelle classe politique crut bon d’envoyer au monde un message clair : « Accompagnez ces changements, tout de suite, ou craignez la colère de Kali. » Plus de main-d’œuvre indienne bon marché, plus de contrats juteux, plus de contrats du tout, sans ces changements. Si les pays qui avaient signé l’accord de Paris – et ils l’avaient tous signé – ne se conformaient pas à cette injonction, alors cette partie de l’Inde serait désormais leur ennemie, comptant bien rompre les relations diplomatiques et ouvrir toutes les hostilités possibles à part militaires. À commencer par les hostilités économiques. Le monde allait voir de quoi était capable un sixième de la population du globe, ancienne classe ouvrière du capitalisme mondialisé. L’heure était venue de mettre un terme à la servitude postcoloniale. L’heure était venue pour l’Inde d’occuper sa juste place sur la scène internationale, comme aux débuts de l’Histoire, afin de réclamer un monde meilleur. Puis d’aider à en faire une réalité.
Encore fallait-il savoir si une telle posture deviendrait la politique officielle du pays ou si elle resterait l’apanage de cette faction radicale. De l’avis de certains, cela dépendrait de la volonté du nouveau gouvernement indien de faire siennes les menaces de cette « faction Kali », voire de les mettre en œuvre. Déclarer une guerre économique à l’époque d’Internet, du village planétaire, des drones, à l’époque de la biologie de synthèse et des pandémies artificielles. Rien à voir avec les conflits d’autrefois. Mais le résultat pouvait s’avérer tout aussi violent. En réalité, même si seule la faction Kali s’y lançait, cela pouvait vite s’avérer très violent.
D’autant que tout le monde était capable de jouer à ce petit jeu. Il ne s’agissait pas que des cent quatre-vingt-quinze nations signataires de l’accord de Paris, mais aussi de toute une gamme d’acteurs privés, jusqu’au simple citoyen.
Ainsi débuta une période troublée.
Hugues Charybde, le 27/11/2023
Kim Stanley Robinson - Le ministère du futur - éditions Bragelonne