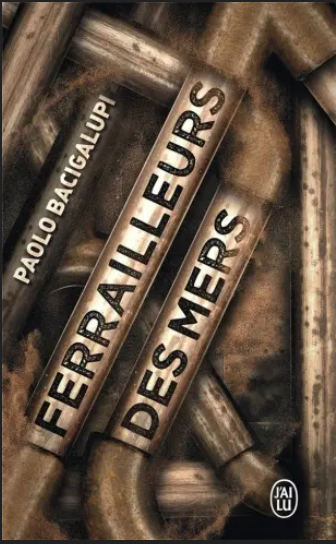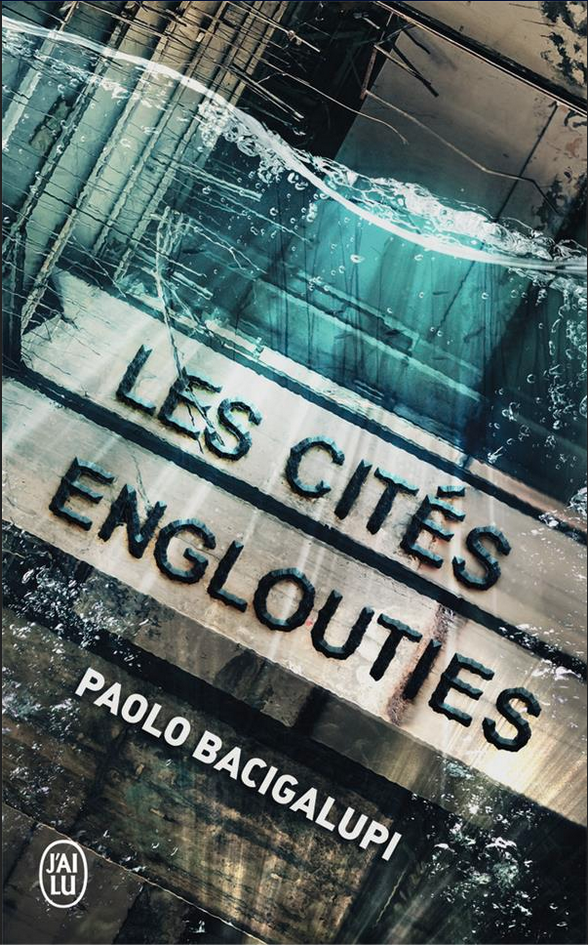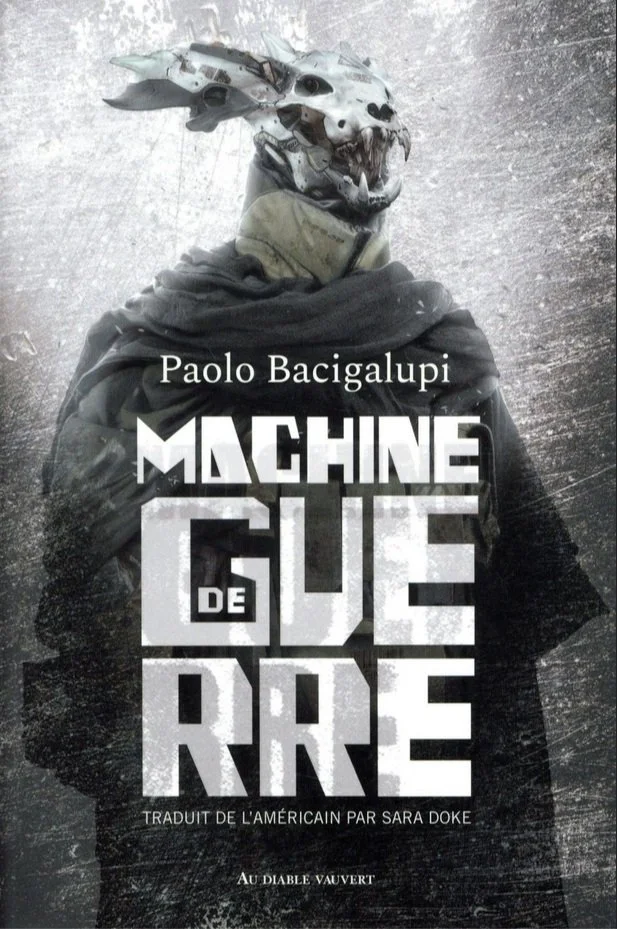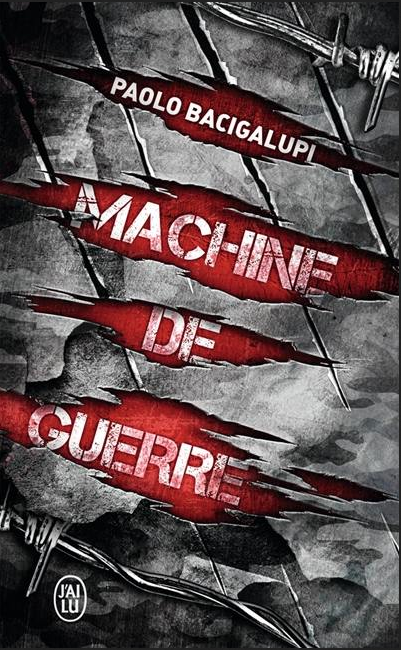Les Cités englouties, la trilogie noire de Paolo Bacigalupi
Ferraille, recyclage et petits trésors engloutis au cœur d’une vive saisie d’un capitalisme de l’effritement et de l’adaptation sous contrainte climatique. Une magnifique immersion fictionnelle.
Lancée début octobre 2022 avec les éditions La Volte, la librairie Charybde et le journaliste Antoine Daer (St. Epondyle), en attendant d’agrandir l’équipe, « Planète B » est l’émission mensuelle de science-fiction et de politique de Blast. Chaque fois que nécessaire, les lectures ou relectures nécessaires pour un épisode donné figureront désormais ici dans cette rubrique partiellement dédiée.
« La trilogie des cités englouties » (2010-2017) est l’un des livres-clé de l’épisode n°2, « Pénuries », à regarder ici.
Nailer rampait dans une conduite de service pour en arracher le câblage électrique, soulevant un nuage de fibres d’amiante et de déjections de souris chaque fois que le câble se détachait. Il progressait en faisant sauter les agrafes d’aluminium qui retenaient le câblage. Les attaches tintaient dans le conduit étroit comme des pièces offertes au Dieu Ferrailleur, et Nailer fouillait le sol pour les ramasser et les enfourner dans le sac en cuir qu’il portait à la ceinture. Quand il tira une nouvelle fois sur le câblage, un bon mètre du précieux cuivre se libéra entre ses doigts dans un nuage de poussière.
La peinture LED décorant le front de Nailer éclairait le passage d’un vert pâle phosphorescent. Le sel de sa propre sueur mêlée de poussière lui piquait les yeux et gouttait sur son masque filtrant. D’une main couverte de cicatrices, il essuya les rigoles salées en faisant bien attention de ne pas effacer la peinture LED. Le marquage lumineux le démangeait et le randait fou, mais il n’avait aucune envie de devoir retrouver son chemin à l’aveuglette dans le labyrinthe de conduites. Il résista donc à l’envie irrépressible de se gratter et vérifia une nouvelle fois sa position.
Des tuyaux rouillés disparaissaient dans la pénombre. Un peu de fer, un peu d’acier – les équipes de lourds s’en occuperaient. Nailer ne se souciait que des trucs faciles à transporter – le blanc : le câblage en cuivre, l’aluminium, le nickel, les attaches d’acier qu’il pouvait entasser dans sa besace et traîner dans le conduit pour rejoindre l’équipe de légers qui l’attendait dehors.
Il se redressa pour reprendre sa progression et son crâne heurta le plafond trop proche, provoquant un bruit sourd qui résonna dans la conduite, comme si Nailer s’était trouvé à l’intérieur d’une cloche d’église chrétienne. La poussière cascada sur ses cheveux et s’insinua sous les bords mal ajustés de son masque filtrant. Il éternua, une première puis une seconde fois, la larme à l’œil. Il retira le masque pour s’essuyer le visage et le remit en place, souhaitant sans beaucoup d’espoir que la bande autocollante fasse son effet.
Offert par son père, le masque était de deuxième main. Il démangeait et tenait mal en place parce qu’il n’était pas à la bonne taille, et, sur un côté, on pouvait lire « À jeter après 40 heures d’utilisation », mais comme ses compagnons, Nailer n’en possédait qu’un. Alors il s’estimait chanceux de disposer de celui-ci, même si les microfibres commençaient à se déliter après de nombreux lavages dans l’océan.
Sloth, son équipière, se moquait de lui chaque fois qu’il le nettoyait – elle ne comprenait pas pourquoi il se fatiguait à le faire. Elle prétendait que le masque était inutile et que ça rendait le travail dans les conduites encore plus étouffant et inconfortable. Nailer pensait parfois qu’elle avait raison. Mais la mère de Pima insistait pour que sa fille et lui en portent quoi qu’il arrive, et il n’y avait qu’à juger de l’épaisseur de crasse noire accumulée sur les filtres quand il plongeait l’objet dans l’océan, pour comprendre que c’était ça de moins qui pénétrait dans leurs poumons. Alors Nailer gardait le masque, même s’il avait l’impression d’étouffer chaque fois qu’il aspirait l’air tropical humide à travers les filtres détrempés par sa propre respiration.
Paolo Bacigalupi, auteur américain ayant longtemps vécu en Chine et en Asie du Sud-Est, est entré d’emblée au voisinage des sommets de la littérature de science-fiction : son premier roman, « La fille automate », en 2009, a été couronné immédiatement par les prix Hugo, Nebula et Campbell, de manière on ne peut plus justifiée. Les univers qu’il imagine sont pétris par les pentes fatales de nos économies politiques contemporaines, les « nouvelles » technologies, dans la lignée du cyberpunk des années 1985, y sont avant tout asservies aux (très) grandes entreprises et à la recherche du profit à court terme, au mépris toujours renouvelé des communs et des humains eux-mêmes, même lorsque le monde se délite autour des comptes de résultat. Dans cette noirceur, ordinaire ou extraordinaire, il parvient néanmoins toujours à inventer avec une ferveur lucide des échappées et des chemins de traverse, parfois joliment improbables – ou au moins inattendus -, enracinés dans des résistances et dans des espaces irréductibles à l’accumulation du capital. Son deuxième roman, « Ferrailleurs des mers », ouvre à partir de 2010 une somptueuse trilogie autour d’un effritement climatique et d’un épuisement des ressources terrestres qui ne provoquent pourtant toujours pas d’infléchissement notable dans la marche du monde – ce qui pourrait rappeler quelque chose aux lectrices et aux lecteurs moins familiers du genre science-fictif, en se contentant de suivre la triste litanie des rapports du GIEC poliment (ou pas) entendus sans déclenchement réels d’actions, ce qu’égrènent au fil des ans les COP numérotées, montagnes encore et toujours accoucheuses de souris, dans la difficulté.
Depuis le pont du tanker, Bright Sands Beach s’étirait au loin, étendue goudronneuse de sable et de flaques d’eau, bordée de vestiges d’autres pétroliers et de cargos. Certains étaient encore entiers, comme si leurs capitaines, pris de folie, avaient simplement décidé de les ensabler avant de les abandonner. D’autres étaient écorchés, dénudés, n’offrant plus que leur carcasse d’acier rouillé. Des coques gisaient comme des poissons vidés : un poste de commandement ici, un quartier d’équipage là, la proue d’un vieux pétrolier pointant vers le ciel.
C’était comme si le Dieu Ferrailleur était descendu parmi les vaisseaux, tailladant et hachant, découpant en morceaux les énormes structures d’acier, avant de laisser leurs cadavres s’étaler derrière lui. Et, où que reposent ces immenses tankers, des gangs de ferrailleurs comme celui de Nailer grouillaient comme des mouches. Arrachant la viande de métal et ses ossements. Traînant la chair du vieux monde le long de la plage pour rejoindre les centres de pesage et les hauts fourneaux de recyclage qui brûlaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour le profit de Lawson & Carlson, l’entreprise qui transformait le sang et la sueur des ferrailleurs en argent liquide.
Avant de plonger dans chacun des trois tomes, je vous propose toutefois de vous immerger cinq minutes dans ce saisissant extrait du documentaire « Workingman’s Death » (Michael Glawogger, 2005), rythmé ici par la musique de Kyuss (« El Rodeo », extrait du quatrième et dernier album du groupe, « …And the Circus Leaves Town », en 1995), pour mieux vous préparer à l’univers dans lequel évoluent les ferrailleurs des mers et leurs compagnons d’infortune :
1 – Ferrailleurs des mers (2010)
L’équipe se rassembla autour d’un feu de joie, fit passer la bouteille de bouche en bouche. Pima s’éloigna et revint un peu plus tard avec une casserole de riz et de haricots, et Moon Girl fit cette fois-ci à Nailer la surprise d’une brochette de pigeon grillé. Devant son air étonné, elle déclara :
– D’autres gens veulent se rapprocher de Dieu et du Destin. Des gens t’ont vu sortir du bateau. Personne n’a une chance pareille.
Il ne posa plus de questions et mangea avec avidité, heureux d’être vivant et de dîner aussi bien.
Ils burent en se passant la lame rouillée qui avait failli le tuer, envisageant la possibilité de la transformer en talisman, un bijou à accrocher à son cou. La griserie de l’alcool le réchauffait, rendait le monde encore meilleur. Il était vivant. Sa peau chantait la vie. Même la douleur dans son dos et dans son épaule lui semblait douce. Se retrouver si proche de la mort rendait la vie d’autant plus belle. Il fit rouler son épaule et savoura la douleur.
Pima le regardait, de l’autre côté du feu.
– Tu crois que tu peux bosser avec l’équipe demain ?
Nailer se força à hocher la tête.
– Écorcher du câble, c’est rien.
– On aura qui pour fouiller les conduites ? demanda Moon Girl.
Pima grimaça.
– Je pensais que ce serait Sloth. Il va falloir faire prêter serment à quelqu’un d’autre pour la remplacer. Trouver un raccroc, putain !
– Pour ce que ça change, marmonna Tick-Tock.
– Ouais, mais il y a encore des gens qui tiennent parole.
Ils tournèrent tous les yeux vers l’endroit où Sloth avait été abandonnée. Elle aurait bientôt faim et besoin de quelqu’un pour la protéger. Quelqu’un avec qui partager la récup, quelqu’un pour la couvrir quand elle ne pourrait pas travailler. Sans équipiers, la plage n’était pas un lieu facile où survivre.
Publié en 2010, traduit en 2013 par Sara Doke pour Au Diable Vauvert, « Ferrailleurs des mers » est ancré dans le sable accueillant aux grands navires en fin de vie de Bright Sands, immense rivage où les tankers, méthaniers et autres porte-conteneurs géants, mais aussi les cargos communs et les petits rouliers, viennent s’échouer en attendant leur désossement à bas coût et à haut risque d’accident du travail. Paysage familier de nos jours, sur les vastes plages du Pakistan, du Bangla Desh et de l’Inde, et répandu dans bien d’autres endroits (vous découvrirez grâce aux indices disséminés par l’auteur où se trouve, à peu près, Bright Sands) dans l’univers de ce futur relativement proche imaginé par Paolo Bacigalupi. Dans ces chantiers de démolition / récupération à ciel ouvert, de petites multinationales du ferraillage international emploient à la tâche, au quotidien, sans aucun contrat digne de ce nom, bien évidemment, des bandes de « lourds », adolescents et adultes aux muscles développés pour désosser les coques, et de « légers », enfants fluets et teigneux capables de s’infiltrer dans les tuyauteries désaffectées des ex-géants des mers pour y glaner précieux câblages métalliques, pièces mécaniques ou même gisements résiduels occasionnels de produits chimiques et d’hydrocarbures. Ici, tout est payé une misère, mais c’est mieux que rien, les alternatives n’incluant guère que la vente de ses propres organes aux Moissonneurs qui hantent les rivages, la prostitution sous ses diverses variantes toutes plus saumâtres les unes que les autres, ou la mort pure et simple. Impitoyable loi de la jungle, de la mangrove et de la plage, dont seules les micro-solidarités et les féroces loyautés inventées chaque jour, et consolidées par d’intransigeants rituels, préservent un semblant de cohésion, en attendant les rares manifestations de la Chance.
Mais lorsqu’un clipper de plaisance (face à la pénurie presque définitive d’hydrocarbures, les riches ont su ici très tôt se reconvertir dans la voile de haute technologie pour leurs affaires et pour leurs divertissements) de la (très) haute société est jeté à la côte par une énorme tempête, même pour les normes météo cataclysmiques qui sont désormais le plus souvent en vigueur, le destin de quelques « légers », enfants travailleurs n’ayant pas encore totalement abandonné leurs rêves de gosses trop vite grandis, pourrait singulièrement s’infléchir – si la Chance veut bien sourire un peu dans l’imbroglio politique et économique qui se précipite alors sur Bright Sands.
Nailer contemplait les feux de bois, réfléchissait à la nature de la chance. Une simple décision de Sloth avait fait basculer sa vie. Elle n’avait plus beaucoup d’options, et toutes étaient laides. Pleines de sang, de douleur et de désespoir. Il avala une nouvelle gorgée, se demanda s’il avait pitié d’elle malgré ce qu’elle avait fait.
– On pourrait prendre Teela, suggéra Pearly. Elle est petite.
– Elle a un pied-bot, objecta Moon Girl. À quelle vitesse peut-elle se déplacer ?
– Pour raccrocher une équipe de légers, elle se presserait.
– Je déciderai plus tard, intervint Pima. Nailer se remettra peut-être plus vite qu’on ne le pense et nous n’aurons pas besoin d’un raccroc pour les conduites.
Nailer sourit amèrement.
– Ou alors, Bapi pourrait m’égoïner et revendre ma place. On n’aura pas le choix dans ce cas-là.
– Il faudra me passer sur le corps !
Personne ne réagit. C’était une trop belle nuit pour la gâcher avec des spéculations de malheur. Bapi ferait ce qu’il voulait, mais il n’était pas nécessaire d’en parler ce soir.
Pima ressentait leurs doutes.
– J’ai déjà parlé à Bapi, annonça-t-elle. Nailer a deux jours de congé. Sur le quota du patron. Même Bapi veut profiter de ce genre de chance.
– Il est pas furieux que j’aie perdu tout ce brut au profit des autres équipes ?
– Ouais, c’est vrai qu’il y a ça. Mais le blanc est sorti avec toi, alors il est content. Tu as le temps de guérir. Que le Saint de la rouille m’en soit témoin.
Cela sonnait presque assez juste pour le croire. Nailer avala une nouvelle goulée. Il avait déjà entendu suffisamment de promesses d’adultes ne se révéler que des mots en l’air. Il ne s’attendait à rien. Il avait besoin de travailler avec l’équipe dès le lendemain et il devait se montrer rapidement efficace. Il fit prudemment rouler son épaule, avec la ferme volonté de guérir. Deux jours à déshabiller des fils serait une bénédiction. S’il y avait quelque chose de favorable dans tout ce bordel, c’était bien l’arrivée de la tempête.
Quoique, sans la tempête, il ne serait pas retourné dans le trou une deuxième fois.
Comme il l’avait montré dès les premières pages de « La fille automate », avec ce fol accident industriel survenant sur un factory floor de science-fiction, Paolo Bacigalupi s’est très vite inscrit au panthéon de ces écrivains qui évitent les exposés et font ressentir des ambiances, en usant de regards biaisés et partiels (ici, les hauteurs d’enfants et d’adolescents plongés dans un impitoyable broyeur économique et écologique font particulièrement merveille), en laissant la lectrice et le lecteur faire leur propre travail de construction – en glanant les indices laissés en évidence (ou mieux dissimulés) – pour parvenir à une certaine vision du monde inventé par l’auteur. L’univers post-cyberpunk qui se dévoile ici, sur une Terre de réchauffement climatique ayant déjà produit ses principaux effets (élévation drastique du niveau des océans et météorologies volontiers déchaînées), sur une Terre rongée par l’épuisement des ressources naturelles, où recyclage et récupération n’empêchent guère le jeu de la grande finance, sur une Terre dominée par des multinationales tentaculaires qui font régner leur loi, ou presque, par la technologie d’abord, par le droit orienté et la violence légitimée ensuite, est à la fois une sérieuse extrapolation du nôtre, et une redoutable quête des interstices, enchâssées dans un authentique roman d’aventure et d’apprentissage.
Les vaisseaux à voile glissaient silencieusement sur l’horizon, si vite que leurs lumières disparaissaient derrière la courbure de la Terre en quelques minutes. Il s’imagina debout sur le pont d’un clipper, oublier la plage et le boulot de léger, glisser librement et rapidement sur l’eau.
Pima lui prit la bouteille de tord-boyau des mains.
– Tu rêvasses ?
Nailer hocha la tête et détourna les yeux des lumières lointaines.
– Tu as déjà voyagé sur un de ceux-là ?
– Un clipper ? (Pima secoua la tête.) Impossible. J’en ai vu un à quai un jour : il y avait tout un groupe de mi-bêtes pour le garder. L’équipage n’aurait jamais laissé une raclure des plages comme moi s’approcher, même à la nage. (Elle fit la grimace.) Les faces de chien avaient électrifié l’eau.
Tick-Tock éclata de rire.
– Je me souviens de ça. J’ai essayé de nager mais ça chatouillait de partout.
Pima fronça les sourcils.
– Et on a dû te ramener en te traînant comme un poisson mort. Tu as failli griller.
– Je m’en serai sorti.
Moon Girl renifla de mépris.
– Les faces de chien t’auraient bouffé tout vif. C’est comme ça qu’ils font. Ils ne cuisent même pas leur viande. Ces monstres arrachent la bidoche crue, à pleines dents. Si on t’avait laissé là-bas, ils auraient utilisé tes côtes comme cure-dents.
– Écrase ! Il y a un mi-bête qui fait le musclé pour Lucky strike… comment il s’appelle déjà ? (Tick-Tock resta silencieux un instant, perdu.) De toute façon, je l’ai vu. Il a de très grandes dents, mais il ne mange pas les gens.
– Comment tu peux le savoir ? Ceux qu’il mange ne sont plus là pour se plaindre.
– Des chèvres, intervient soudain Pima. Le mi-bête mange des chèvres. Quand il a débarqué sur la plage, on le payait en chèvres pour récolter du noir. Maman m’a dit qu’il était capable de manger une chèvre entière en trois jours. (Elle grimaça.) Mais Moon Girl a raison. Il ne faut pas se mêler des affaires de ces monstres. On ne sait jamais quand leur côté animal va se réveiller pour te bouffer un bras.
Nailer regardait toujours les lumières osciller à l’horizon.
– Tu t’es jamais demandé ce que ce serait de voguer sur un clipper ? De partir sur l’un de ces bateaux ?
– Je ne sais pas. (Pima secoua la tête.) Ce serait rapide, j’imagine.
– Sacrément rapide, suggéra Moon Girl.
– Plus rapide que tout, renchérit Pearly.
Ils regardaient tous l’océan à présent. Envieux.
– Vous croyez qu’ils savent seulement qu’on est là ? demanda Moon Girl.
Pima cracha sur le sable.
– Nous ne sommes que des mouches à rouille pour des gens comme eux.
2 – Les Cités englouties (2012)
Les chaînes tintaient dans la pénombre des cellules de rétention.
La puanteur de l’urine, les miasmes de la sueur et de la peur se mélangeaient avec les relents douceâtres de la paille pourrissante. De l’eau gouttait le long des parois en marbre, les noircissant de mousses et d’algues.
L’humidité et la chaleur. L’odeur de la mer, lointaine, un parfum cruel rappelant aux prisonniers qu’ils ne goûteraient plus jamais à la liberté. Parfois, un détenu, chrétien hauturier ou dévot du Saint de la rouille, élevait la voix, priait, mais la plupart des captifs attendaient en silence, préservaient leur énergie.
Un cliquetis de ferraille à l’extérieur leur annonça que quelqu’un approchait. Le bruit de nombreuses bottes.
Quelques prisonniers levèrent les yeux, surpris. Ils n’entendaient aucune foule en liesse, aucun soldat qui appelait au sang. Pourtant, on ouvrait la porte de la prison. Mystère. Ils attendirent, avec l’espoir que ce mystère ne les concerne pas. L’espoir de survivre un jour de plus.
Les gardes entrèrent en groupe pour se donner du courage, se poussèrent en avant les uns les autres jusqu’à la dernière cellule rouillée. Plusieurs avaient des pistolets. Un autre brandissait une matraque électrique qui crépitait d’étincelles, un outil de dresseur, même s’il n’en avait pas la maîtrise.
Tous puaient la peur.
Le préposé aux clés jeta un coup d’oeil entre les barreaux. À première vue, ce n’était qu’une cellule comme les autres, sombre et étouffante, jonchée de paille moisie, mais, dans le fond, il y avait autre chose. Une énorme flaque d’ombre.
– Debout, Face de chien, dit le portier. On t’attend.
Il n’y eut pas de réponse.
– Debout !
Toujours pas de réponse. Dans la cellule voisine, quelqu’un toussa grassement, symptôme de tuberculose. L’un des gardes marmonna :
– Il est mort. Enfin. Il est forcément mort.
– Non, ces choses ne meurent jamais. (Le portier sortit sa matraque et cogna les barreaux d’acier.) Lève-toi, maintenant, ou ce sera pire. On va se servir de l’électricité, et on va voir si tu aimes ça.
La chose dans le recoin ne broncha pas. Aucun signe de vie. Les minutes passèrent.
Finalement, un garde annonça :
– Il ne respire pas.
– Il est canné, acquiesça un autre. Les panthères ont fait le boulot.
– Il a mis le temps.
– Cette chose m’a fait perdre une centaine de billets rouges. Quand le colonel a dit qu’il allait affronter six panthères des marais… (Le garde secoua la tête à regret.) Ç’aurait dû être gagné d’avance.
– T’as jamais vu ces monstres combattre dans le Nord, sur la frontière ?
– Non. Sinon, j’aurais parié sur Face de chien.
Ils fixaient tous la masse morte des yeux.
– Bon, c’est plus que de la viande pour les vers maintenant, constata le premier gardien. Le colonel va pas être content. File-moi les clés.
– Non, grinça le préposé aux clés. Je n’y crois pas. Les faces de chien sont les fils du démon. Le commencement de la purification. Saint Olmos les a annoncés. Ils ne mourront pas avant l’inondation finale.
– File-moi les clés, vieillard.
– Ne t’en approche pas.
Le gardien lui décocha un regard dégoûté.
– C’est pas un démon. Seulement de la viande et des os comme nous, même si c’est un Augmenté. Tu le déchiquètes, tu tires dessus tant qu’il faut et ça crève. C’est pas plus immortel que les garçons-soldats de l’Armée de Dieu. Appelle les Moissonneurs, on verra s’ils veulent ses organes. On peut au moins vendre son sang. Les Augmentés ont toujours le sang propre.
Il enfonça la clé dans la serrure. L’acier renforcé gémit en s’ouvrant, une grille conçue spécialement pour le monstre. Puis une autre série de verrous joua entre les barreaux d’origine mangés par la rouille, assez solides pour contenir un homme normal mais insuffisants contre ce produit terrifiant de la guerre et de la science.
La porte s’ouvrit en raclant le sol.
Le gardien s’avança vers le cadavre. Il frissonna malgré lui, terrorisé. Même morte, la créature était effrayante. Il avait vu ses poings massifs réduire le crâne d’un homme en bouillie. Il avait vu le monstre bondir de six mètres pour enfoncer ses griffes dans la jugulaire d’une panthère.
Dans la mort, l’homme-chien s’était roulé en boule mais même ainsi il paraissait énorme. Vivant, c’était un géant dominant tous les autres, mais il n’était pas devenu un meurtrier à cause de sa taille. Le sang d’une dizaine de prédateurs coulait dans ses veines, un cocktail létal d’ADN – tigre, chien, hyène et le Destin savaient quoi d’autre. Une créature parfaite, conçue uniquement pour chasser, combattre et tuer.
Il marchait comme un homme mais, quand il montrait les dents, sa bouche révélait des crocs de tigre ; quand il tendait l’oreille, c’était l’ouïe d’un chacal qui écoutait ; quand il humait l’air, c’était un limier qui reniflait. Le gardien l’avait assez souvent vu sur le ring pour préférer affronter une dizaine d’hommes armés de machettes plutôt que cet ouragan dévastateur.
Il se tint un long moment au-dessus du monstre à le regarder. Pas un souffle. Pas un mouvement. Pas un signe de vie. De la force meurtrière de Face de chien, il ne restait que de la viande pour Moissonneurs.
Enfin mort.
Il s’agenouilla et fit courir sa main sur la fourrure rase de la créature.
– C’est dommage. Tu rapportais gros. J’aurais bien aimé te voir combattre les coyloups qu’on rassemble en ce moment. Ç’aurait été un beau combat.
Un œil d’or s’alluma dans l’obscurité, plein de malveillance.
– Bien dommage, en effet, gronda le monstre.
Même si le feeling du roman renvoie nettement à une Asie transfigurée, même si la présence détaillée du phénomène enfants-soldats évoque sans équivoque le si sublime et dérangeant « Johnny chien méchant » d’Emmanuel Dongala, par exemple, les « Cités englouties » sont pourtant géographiquement plus proches des bayous aux confins de Frank Smith (« Katrina – Isle de Jean-Charles, Louisiane », 2015), voire de la New York affaissée et semi-immergée de Kim Stanley Robinson (« New York 2140 », 2017). C’est dans l’organisation de ce cognitive estrangement-là (pour reprendre logiquement les termes de Darko Suvin) que l’art de Paolo Bacigalupi donne à nouveau toute sa mesure : déplaçant son curseur investigatif de la ferraille et du déchet eux-mêmes vers les micro-sociétés humaines qui en subsistent, plus ou moins bien, il poursuit sa tâche romanesque de mise en perspective des effritements humains continus engendrés par la logique bien pensée du capitalisme tardif, sans qu’il y ait d’apocalypse à proprement parler. Et son talent en est d’autant plus glaçant, bien entendu.
Ce n’était pas d’une nouvelle bouche à nourrir dont se plaignait réellement Amaya. Elle exprimait son rejet des orphelins et, plus précisément, des vers de guerre. Du genre de Mahlia, qui était arrivée à Banyan Town avec une main droite coupée, en sang, suppliant qu’on l’aide. Personne ne voulait d’un ver de guerre et les habitants de Banyan Town avaient dû décider quoi faire de la bâtarde abandonnée d’un Casque jaune, étendue dans la poussière au milieu de leur village. La plupart avaient pris une décision négative ; le Dr Mahfouz en avait décidé autrement.
– Ne t’inquiète pas pour cette bouche en plus, dit Mahlia. Salvatore récupérera le bébé dès qu’il pourra manger seul. Et le docteur va t’envoyer plus de nourriture pour ta peine.
– Qu’est-ce que le docteur peut bien trouver à une infirmière manchote ? demanda Amaya. C’est à cause de ta main que Tani est morte ?
– Ce n’est pas de ma faute si elle s’est fait mettre enceinte.
– Non. Mais elle n’avait pas besoin d’une Chinoise bonne à rien et estropiée comme infirmière.
Mahlia se hérissa.
– Je ne suis pas chinoise !
Amaya se contenta de la toiser.
– Je ne suis pas chinoise, répéta Mahlia.
– Tu le portes sur ton visage. Un véritable rebut de la Chine ! (Elle fit demi-tour, s’arrêta et posa son regard sur Mahlia.) Ce que je me demande c’est ce qui cloche chez toi, gamine. Pourquoi les Casques jaunes n’ont pas voulu de toi ? Et s’ils ne voulaient pas te ramener en Chine avec eux, pourquoi est-ce qu’on voudrait de toi ici ?
Mahlia lutta contre la colère qui montait en elle.
– Bon, celui-ci n’est pas chinois et ce n’est pas un rebut. Il est de Banayan Town. Tu le veux ? Ou dois-je dire au docteur que tu l’as rejeté ?
3 – Machine de guerre (2017)
Le drone volait en cercles loin au-dessus des ravages de la guerre.
Il n’était pas là une semaine plus tôt. Une semaine plus tôt, les Cités englouties ne valaient pas la peine qu’on les mentionne, encore moins qu’on envoie un drone les surveiller.
Les Cités englouties : littoral rendu marécageux par la montée des eaux et les haines politiques, lieu de décombres et d’incessants échanges de feu. Autrefois fière capitale, les gens qui alors circulaient dans ses couloirs de marbre dominaient une bonne partie du monde. Aujourd’hui, l’endroit avait à peine sa place sur les cartes, et encore moins au cœur des réunions des personnes civilisées. Les histoires qu’elles avaient contrôlées, les territoires qu’elles avaient gouvernés, tout avait été perdu à mesure que ses habitants sombraient dans la guerre civile – avant d’être oubliés.
Pourtant, un drone de surveillance de classe Rapace les survolait à présent.
Maintenu à distance par des courants humides et chauds, il observait les jungles impénétrables et les côtes érodées. Il tournait en ronds, les ailes déployées pour profiter des vents tièdes de l’océan Atlantique. Ses caméras passaient sur les marais emmêlés de kudzu et les étangs émeraude infestés de moustiques. Son regard s’attardait sur les monuments de marbre, les flèches, les dômes et les colonnes abattues, le squelette désarticulé de la grandeur de la ville.
Au début, les rapports avaient été écartés, ce n’était que récits de réfugiés rendus fous par les guerres : un monstre menant les enfants soldats à la victoire ; une bête immunisée contre les balles démembrant ses adversaires. Une immense créature sauvage qui exigeait un tribut sans fin de crânes ennemis.
Au début, personne n’y croyait.
Mais plus tard, des photos satellite floues montrèrent les bâtiments en feu et les déplacements des troupes, confirmèrent les témoignages les plus extravagants. Le drone fut donc lancé en chasse.
Le vautour électronique tournait, paresseux, lointain. Son ventre regorgeait de caméras, de senseurs de chaleur, de micros laser et d’équipements d’interception radio.
Il photographiait les ruines historiques et ses habitants barbares. Il écoutait les brèves communications radio, analysait les mouvements de troupes, le rythme des explosions. Il traquait les lignes de feu et enregistrait le morcellement des soldats ennemis.
Et au loin – de l’autre côté du continent, les informations rassemblées par le Rapace atteignaient ses maîtres.
Là flottait un grand dirigeable, majestueux au-dessus de l’océan Pacifique. Le nom inscrit sur son flanc était aussi grandiose que le vaisseau de guerre lui-même : Annapurna.
Un quart de la planète séparait l’aéronef de commandement et le Rapace d’espionnage, pourtant les informations arrivaient en un clin d’œil et déclenchaient l’alarme.
– Mon général !
L’analyste s’écarta de ses écrans de contrôle, clignant des paupières, essuya la sueur de son front. Le Centre stratégique de renseignement global de Mercier Corporation irradiait de chaleur à cause des équipements informatiques et des analystes serrés coude à coude, occupés à leurs propres opérations. Le murmure de leur travail emplissait la pièce, accompagné des gémissements épuisés des ventilateurs qui luttaient pour rafraîchir les lieux.
À bord de l’Annapurna, on accordait plus d’importance à l’efficacité spatiale et à la vigilance maximale qu’au confort, tout le monde transpirait donc et personne ne se plaignait.
– Mon général ! appela de nouveau l’analyste.
Elle avait, au début, détesté la chasse au dahu qu’on lui avait confiée – succession de petites tâches quand ses confrères en renseignement ourdissaient des révolutions, massacraient des insurgés et luttaient contre la spéculation sur les marchés du lithium et du cobalt. Ils s’étaient moqués de sa mission – au mess, dans les chambrées, dans les douches -, la chahutaient sous prétexte qu’elle ne participait pas au dessein global, lui rappelaient que ses primes trimestrielles seraient réduites à zéro puisqu’elle ne contribuait pas aux profits de la société.
Elle était secrètement et amèrement d’accord avec eux. Jusqu’à cet instant.
– Général Caroa ! Je pense avoir quelque chose.
Publié en 2017, traduit en français en 2018 par Sara Doke, toujours au Diable Vauvert, le troisième et dernier tome de la trilogie en constitue l’apothéose naturelle. Personnage d’arrière-plan dans le premier tome, fil conducteur de moins en moins souterrain dans le deuxième, le personnage de Tool, l’augmenté, l’un de ces nombreux humains génétiquement lourdement modifiés pour être plus forts et plus redoutables, au service des multinationales qui les ont brevetés, est cette fois pleinement sous les sunlights. En travaillant au corps et aux tripes les rebondissements inattendus d’une fort hégélienne dialectique maître-serviteur devenue folle et inopérante, Paolo Bacigalupi offre une conclusion à la fois logique et presque métaphysique à sa trilogie : questionnant de très près la différence entre l’arme et le tueur, entre le monstre et l’humain (qui, bien entendu, ne peuvent pas être définis aussi simplement que ce qu’impliquerait à première vue la légèreté souveraine et néanmoins avide du capitalisme tardif), entre la liberté et la servitude – qu’elle soit « librement » consentie ou absolument pas, il propulse sa narration à des sommets auparavant insoupçonnables (et pas uniquement du fait de scènes rugissantes à bord d’un dirigeable quartier général d’entreprise évoluant dans la haute atmosphère).
– Au sang, murmura le général Caroa. Au sang et à l’histoire.
Et à la fin du cauchemar.
Il leva un verre de cognac vers la vue de la fenêtre de sa salle de commandement.
Six mille mètres plus bas s’étalait le Pacifique éclairé par la lune. De sa hauteur, Caroa pouvait presque s’imaginer regarder une planète extraterrestre, des mers de mercure scintillant à ses pieds – un lieu sombre encore à découvrir.
Ce que la Terre était devenue à tout point de vue. Une grande partie du monde avait reculé à la fin de l’ère accélérée, s’était effondrée sous les désastres. Sécheresses et inondations. Ouragans. Épidémies et catastrophes agricoles. La faim et les guerres de réfugiés avaient ravagé la planète et laissé de vastes étendues à la ré-exploration humaine. Et il avait mené cette charge.
Il avait forgé de nouveaux territoires, réprimé des soulèvements et apporté la force gouvernementale de Mercier à tout ce désordre pendant plus de trois décennies. Sa salle de commandement était grande, comme il convenait à un homme de son rang, décorée des trophées de ses campagnes : un tapis en mémoire de l’offensive nord-africaine pour contrôler le canal de Suez ; une dague taillée dans l’os d’une baleine ramassé après les combats pour les droits sur le Passage du Nord-Ouest. Sur une étagère, des bouteilles de liqueur rappelant les guerres agricoles françaises brillaient au-dessus d’une autre planche couverte de livres imprimés sur du vrai papier, Sun Tzu, Clausewitz et Shakespeare, certains très anciens et d’autant plus luxueux considérant les contraintes de poids et d’espace d’un dirigeable de classe Narval. L’Annapurna pouvait transporter près de cinq mille âmes. Elle demandait un équipage de commandement et d’ingénierie de cinq cents personnes et emmenait un contingent de deux mille marines Raid éclair. Elle possédait des installations de lancement et de drones, des centres logistiques, de renseignement et de commandement sous la direction de Caroa.
L’influence du général s’étendait sur un quart de la planète – les Amériques, de pôle à pôle – depuis ses bureaux, grâce à ses yeux et ses oreilles électroniques liés aux satellites et aux communications avec les troupes et les flottes, selon les désirs de Mercier.
L’écusson de sa première compagnie présentait des augmentés enragés rampant et les mots : Mercier Raid Éclair.
Sous l’image, la phrase qui avait guidé sa carrière était brodée en lettres d’or. Feritas – Fidelitas : Férocité – Fidélité.
Il caressait l’écusson et se demandait si ses cauchemars avaient vraiment pris fin.
Loin sous ses pieds, la côte noire du protectorat CalSud de Mercier s’étendait vers le nord. Il apercevait les ruines piquetées de feux de camp de l’ancienne Los Angeles, accentués par le collier scintillant des tours gratte-ciel de Mercier qui longeaient le bord de la baie.
Il lui avait fallu une vie entière pour arriver aussi haut. Il n’existait quasiment aucun échelon au-dessus de lui dans les rangs de l’entreprise. Tout ce qui lui restait réellement était une promotion au comité exécutif de la société, un directorat au conseil permanent où l’élite de Mercier délibérait sa stratégie depuis l’un des bâtiments les plus hauts de Los Angeles.
S’il devait avoir une promotion, étrangement, il devrait perdre de la hauteur.
Amusé par cette pensée, Caroa rejoignit son bureau et vérifia ses écrans une dernière fois.
Le ComEx s’inquiétait d’accrochages dans l’Arctique, SinoCor mettait probablement la pression sur les opérations de forage et il y avait toujours le problème de piraterie dans le Passage du Nord-Ouest, la TransSiberia et ses soldats inuits tentaient de « taxer » les navires qui traversaient les pôles. C’était irritant, surtout quand ses forces étaient déployées dans le sud, sur les plaines de lithium dans les Andes. Déplacer les troupes d’un bout du monde à l’autre, même avec la flotte de dirigeables de Mercier, prendrait du temps. Au moins les soldats étaient déjà équipés pour le froid.
Il éteignit l’écran. Ça pouvait attendre. Il pouvait, pour une fois, se détendre et profiter des avantages de sa profession. Il tendit la main vers le cognac.
Le comm sonna.
Avec ce très fort roman offert en guise de conclusion à cette redoutable trilogie de chair et de métal, de gènes et de rouille, de carburant résiduel et d’antiquités recherchées, Paolo Bacigalupi démontre à nouveau, s’il en était vraiment besoin, à quel point il dispose d’un talent fort rare dans la littérature d’imaginaire contemporaine, celui de pouvoir dépeindre un univers corporate certes, fort logiquement, extrapolé, mais doté d’un réalisme aussi minutieux que paradoxal – ce que le coup de tonnerre de « La fille automate » en 2009 avait déjà largement établi, mais qu’il pousse ici à un degré cruel et intelligent de raffinement. Si l’on y ajoute son refus méticuleux du manichéisme, quand il s’applique à doter tous ses personnages ou presque de complexes contradictions internes, et son art de laisser toute la violence des dominations se refléter dans sa narration, sans complaisance aucune, mais sans se voiler la face, on comprendra que cette trilogie en général, et ce troisième tome en particulier, s’inscrivent dans une littérature d’aujourd’hui qui compte réellement, pour notre plus grand plaisir ambigu de lectrice ou de lecteur, toujours.
Mercier n’avait pas recruté Arial Madalena Luiza Jones pour qu’elle emmerde le monde. On l’avait engagée parce qu’elle avait explosé les scores du MX.
Alors, laisse tomber.
Pourtant, ça la dérangeait. Elle avait toujours été curieuse, obsédée par des questions et quand son esprit s’accrochait à quelque chose, c’était difficile de l’en décrocher.
Elle réfléchit, pensa à l’augmenté. Une vérification de routine à succès et Caroa s’était soudain intéressé à elle, lui avait demandé de dérouter les drones, ordonné de rapprocher leurs équipements de l’Atlantique nord des côtes au cas où il aurait besoin de plus de force de frappe.
Elle avait demandé au général quelle compagnie méritait leur attention, qui dirigeait les activités de l’augmenté mais Caroa avait répondu par une rebuffade, dit que ça n’avait pas d’importance.
D’après elle, l’augmenté devait travailler pour une société qui voulait reprendre le marché de la récupération dans les Cités englouties. Lawson & Carlson ou un autre. Mais ça n’avait pas de sens non plus. Les activités d’un unique augmenté dans l’un des innombrables trous à rats sans importance du monde étaient triviales comparées aux genres d’opérations que Caroa menait habituellement. Cet homme envoyait des milliers d’augmentés au combat conquérir de nouveaux territoires, étouffer des rébellions et reprendre des ports d’eau profonde. Caroa organisait les monopoles militaires du commerce maritime du pôle Nord fondu, il ne perdait pas son temps avec un unique augmenté dans une zone de récupération oubliée.
Sauf qu’à présent, il le faisait.
Donc, au lieu de s’inquiéter de savoir si Mercier allait perdre le contrôle de ses mines de lithium au Pérou, Jones s’inquiétait de la survie d’un vaisseau de contrebande de fer blanc venant du trou du cul du monde. Elle retourna à son bureau en fronçant les sourcils. Elle sirotait son expresso avec une grimace en débloquant ses fichiers de recherche.
Des listes de bateaux se déroulèrent sur l’écran, des clippers de classe Mante qui avaient jeté l’ancre dans des dizaines de ports de l’Atlantique, de Reykjavik à Rio de Janeiro. Même les ports les plus proches renfermaient des centaines de navires du même type. Jersey Orleans. Seascape Boston. Mississippi Metro. Récif de Miami. Ils étaient peut-être allés plus loin. Vers Londres ou Lagos. Avec un bateau de classe Mante, le monde entier était à portée de voile. Ils pouvaient tout aussi bien se diriger vers l’île de Shanghai.
Elle étudia les quelques captures d’écran dont elle disposait. Des images lointaines et pixellisées. Elle n’avait pas dirigé le Rapace sur le clipper pendant ses surveillances, il n’y avait donc qu’une petite série de bonnes prises, dix secondes de tournage pour le drone.
Jones repassa les images, se pencha inconsciemment pour regarder l’écran même si cela ne rendait pas les photos plus claires.
Des enfants soldats portant les couleurs de l’augmenté transportaient une cargaison quelconque, de forme étrange. Une jeune femme à la peau et aux cheveux sombres semblait les superviser. Ses traits semblaient venir d’Asie orientale mais n’étaient ni vraiment chinois, ni vraiment japonais, plus africains, en fait. Un mélange de Chinois et des Cités engloutie peut-être ? Une orpheline abandonnée par les casques jaunes qui avaient tenté de remettre de l’ordre dans le coin ?
On aurait dit que la fille était en charge de la cargaison, même si elle n’avait pas l’air plus âgée que Jones. Mais tout le monde dans les Cités englouties était jeune. Les vieux avaient été abattus des années auparavant. Celle-là semblait bien abîmée. Jones essaya d’affiner la résolution de l’image. La fille avait une cicatrice sur une joue qui ressemblait à un insigne de milice. Jones ouvrit ses fichiers de recherche.
Avec cette trilogie encore toute récente, Paolo Bacigalupi nous passionne encore et toujours. Héritier génétique du cyberpunk des années 1985-1995, il a su, comme quelques-uns de ses confrères (on songera certainement aux grands William Gibson et Neal Stephenson, voire à Cory Doctorow), se saisir de tout l’ADN prometteur de ce sous-genre qui fut décisif en son temps et au-delà, en ne se contentant jamais – comme trop de « continuateurs » des mythiques verres miroirs – de ressasser des motifs peu à peu vidés de leur sens et devenant de plus en plus purement ornementaux, et s’en saisir d’une manière tout aussi profondément politique que celle d’un China Miéville, même si son terrain de jeu personnel présente des caractéristiques bien différentes. Et c’est ainsi qu’il contribue tant, encore, à notre plaisir et à faire de la science-fiction l’une des littératures les plus essentielles qui soient.
Hugues Charybde le 4/01/2023
Paolo Bacigalupi - Trilogie - Les Cités englouties - Au Diable Vauvert
L’acheter chez Charybde ici