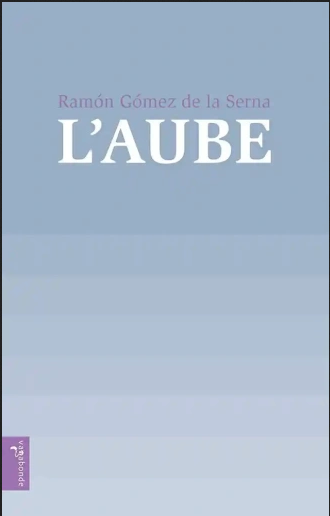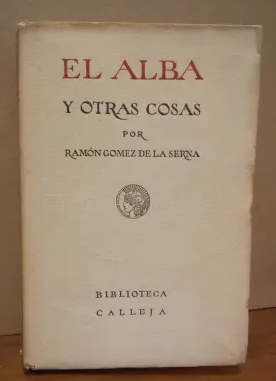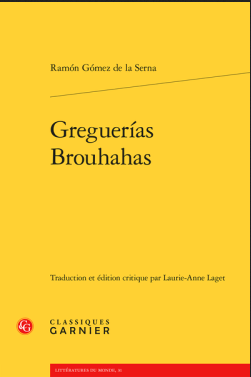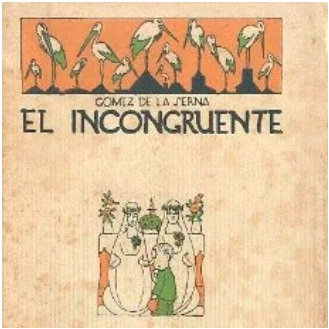L'Aube poétique qui frappe au carreau de Ramon Gomez de la Serna
D’une ligne à une page, des dizaines de variations comiques, poétiques, incongrues ou rusées autour de l’aube en métaphore totale : un somptueux échantillon de l’art des greguerías.
Prologue
J’ai été un espion de l’aube.
Plus que tout autre, j’ai fait ce livre avec la mort en moi ; la mort claire, sèche, maligne, sarcastique, inconvenante, mondaine, fluide, très fréquentable et très valeureuse.
J’ai mis longtemps à le distiller.
En le préparant j’ai détruit par erreur de nombreuses pages écrites dans les aubes de Paris pendant un hiver glacé, couvert de deux manteaux, de deux gilets et de deux couvertures, à l’affût de l’instant de l’aube, le visage gercé, les yeux pleins d’escarbilles, la langue brûlée par mes dernières pipes.
On dirait que la Providence, comme qui cherche des papiers compromettants et achète même le voleur qui doit les voler, m’a fait me tromper et déchirer ces pages que je m’avoue incapable de pouvoir jamais reproduire.
J’avais dû dire dans ces pages glacées quelque chose que la Providence ne voulait absolument pas que je dise, et elle m’a imposé sa censure implacable.
Cette vision-là de l’aube avait été celle d’une adolescence mi totalement stupide, mi totalement éveillée, dont je ne pourrais plus retrouver la claire tonalité de persiennes qui donnaient sur la pure idiotie.
Quoi qu’il en soit, voici finalement ce livre si souvent annoncé à travers les années et qui est, de mes livres, celui que j’ai le plus épuré dans mes cornues, filtres et alambics.
Ramon Gómez de la Serna (1888-1963) fut en son temps (long) un véritable enfant terrible des lettres espagnoles, brillant touche-à-tout, animateur de cercles de lecture madrilènes influents et renommés jusque loin à l’étranger (jusqu’à son exil en Argentine à partir de 1936 – à partir duquel rien ne fut plus comme avant, comme en témoigne sa monumentale autobiographie de 1948, « Automoribundia »), défricheur et créateur redoutable, souvent précurseur ou à la pointe des avant-gardes. Il reste néanmoins inscrit dans le patrimoine littéraire commun avant tout comme le créateur d’un genre littéraire quasiment à part entière, qu’il nomma les greguerías (littéralement : criailleries).
Ni simplement aphorismes (même si les exemples ci-dessous montrent que bon nombre pourraient s’inscrire dans une filiation souple qui mènerait à « L’autofictif » d’Éric Chevillard ou au travail incessant d’Olivier Hervy), ni pures flèches poétiques, ils doivent satisfaire à la formule joueuse inventée par leur auteur même (humour + métaphore ⇨ greguería), mais évoluent de facto aux frontières d’un terrain où se glisserait l’incongru (qui n’est pas tout à fait l’absurde !) analysé par Pierre Jourde dans son « Empailler le toréador » et où percolerait au fur et à mesure un certain surréalisme en devenir.
On entend l’artillerie de l’aube.
L’aube nettoie le monde des voleurs.
L’aube soigne les iris.
Les morts peuvent se mettre au téléphone au moment de l’aube ; mais il faut être discret pour la communication, il ne faut pas la demander, il faut profiter d’une négligence de la centrale et bien sûr se mettre à parler.
L’aube est l’heure à l’ouïe fine.
Les rues bordées d’arbres, les allées, se font plus obscures que dans la nuit profonde… Si cette minute nous surprend en pleine rue, il nous faut marcher au milieu pour être plus tranquilles, car ainsi nous voyons de chaque côté et nous pouvons prévoir le coup qu’on veut nous asséner.
La terre montre une aigreur, un scepticisme, un ton blasphématoire au fil de l’aube déconcertante… En voyant qu’on n’y pourra rien construire de véritable, on a envie de ne rien construire… Sauf si nous sommes de bonne humeur !…
Le métal résonne à l’aube comme à aucune autre heure. Les jantes métalliques qu’avaient autrefois les voitures résonnaient sur les pierres comme un vacarme de cerceaux. Ces compositeurs de poteaux et de rails de tramways produisent un son métallique qui va bien à l’aube, comme à l’eau le métal de tous les clous qui se délitent dans les cruches.
À l’aube on éprouve la honte du poste qu’on a… On voit ses compagnons épuisés… Passe l’idée de tables de bureau ensanglantées d’encre… On voit les ampoules sans lumière, fondues… C’est l’heure où les employés de bureau sont morts, raides, inanimés, secs, sans poste ni ombre… Quelle idée réconfortante de voir comme tout est raté ; du moins pendant l’aube de tous les jours !
Au cours de sa carrière littéraire, Ramon Gómez de la Serna a écrit des centaines de greguerías, rassemblées en recueils ou glissées dans des articles de journaux, des chroniques ou des essais libres. Une grande partie d’entre eux a été traduite en français par Laurie-Anne Laget pour les Classiques Garnier en 2019, mais comme cet éditeur destine hélas plutôt ses ouvrages, de par leur prix, aux rayonnages des bibliothèques universitaires qu’aux étagères des simples amatrices et amateurs, il est particulièrement heureux (même si l’on n’oublie pas le joli petit recueil de textes choisis des éditions Cent Pages publié en 2005) que les éditions Vagabonde aient décidé de nous offrir en ce mois de mai 2022, dans une traduction de Jacques Ancet (qui signe aussi une belle introduction), l’un des recueils les plus emblématiques, publié à l’origine en 1923 et largement revu et amplifié en 1956, sous ce titre de « L’Aube ».
Oh la pétoche de l’aube ! Pétoche d’authentique Jugement dernier avec quelque chose d’une fausse angine de poitrine du monde.
À l’aube, les espadrilles résonnent d’une manière atroce ; les chaussures à talon Louis XV des prostituées qui ont été lâchées parmi les délégations font un bruit de chaussures vides, et les bottes des hommes produisent ce bringuebalement des fers à chevaux détachés. (À leur écho, on pourrait savoir combien les bottes cloutées de semences ont de clous, car chacun produit sa note dans cet air si subtil.)
Dans les pharmacies il ne faut pas perdre de temps à l’aube, il faut remuer le pharmacien, il faut qu’il vous serve avant que ne passe l’aube ; au besoin avec un pistolet il faut vaincre cette parcimonie de l’homme endormi qui cuisine au fond de l’arrière-boutique.
À l’aube, toutes les voitures doivent rouler lentement, toutes roulent très lentement, même celles qui ont été louées. Tous les cochers, à l’aube, inclinent la tête sur le rebord de leur capote, sans forces déjà, blessés par l’attentat de l’aube.
Aussi celui qui va en voiture a-t-il la responsabilité d’un meilleur pourboire. Il a éveillé la voiture et le cheval. Il fait nager le cheval dans le courant du fleuve de l’aube et lui fait presque arriver l’eau à ses grandes narines, par les orifices desquelles il semble qu’il pourrait se noyer.
Celui qui rentre chez lui dans un fiacre de l’aube ne regarde pas autour de lui, il ne se fait pas remarquer, il ne sait pas que moi je le vois toujours.
L’aube transforme en gare d’arrivée toute la ville. Tout a un air de grande gare, de haute lucarne, d’immense marquise vitrée.
Voici l’esprit qui veille.
Les autres dorment.
L’aube est bien ici un personnage à part entière, qu’il s’agira d’appréhender sous toutes ses facettes, réelles, irréelles, ou encore plus improbables. Donnant son unité au recueil par la magie d’un seul mot, certes hautement chargé de mythes et de significations, Ramon Gómez de la Serna joue des longueurs (d’une ligne à une page, de la formule sibylline à la véritable petite histoire) et des tonalités, à travers des formes d’humour et de poésie toujours variables. Sur une note beaucoup moins sérieuse que l’immense « Paroi » de Guillevic, il transforme l’aube en métaphore totale à explorer encore et encore (un peu comme Nicolas Richard le pratiquait à une époque, par interpolations, avec son Niccolo Ricardo pouvant prendre tant de formes à deviner).
On voit comme ils sont vieux les toits et comme ils sont quelque chose qui ressemble à beaucoup de vieux souliers réunis, quelque chose par où toute maison un peu ancienne révèle sa vétusté.
Les toits sous l’aube avouent leur âge, leur misère, et ce en quoi ils ne sont pas une de ces choses très relevées qu’ils croient être à d’autres heures.
On voit les toits comme le haut de la tête des enfants qui s’approchent. On voit comme ils se sont fait leurs nombreuses raies qui ne signifient rien.
On caresse peut-être du regard, comme quelque chose de très modeste, ces toits atteints et convaincus de toiturité à cette heure qui se lève sur tout le monde et donne à contempler l’exactitude parce que c’est l’heure exacte.
Il faut une bonne vie pour voir l’aube. La plupart de ceux qui la traversent pensent à des choses ignobles, en essayant de pêcher des portefeuilles ou des mégots, les mégots, les bancs de mégots dont sont pleines les rues.
Les choses se créent peu à peu, et quand on en est à cette minute numéro douze de l’aube, est créée la concierge qui sort de la coquille du porche demeuré ouvert et balaie avec acharnement les restes du jour précédent, ses cheveux perdus, ses épingles, ses enveloppes déchirées en petits morceaux.
Ramon Gomez de la Serna - Aube - éditions Vagabonde
Hugues Charybde le 3/09/2022
l’acheter chez Charybde ici