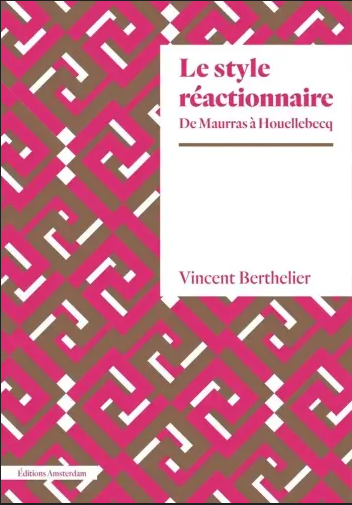Décortiquons le réactionnaire, pourvu qu'il soit stylé comme ici
Un passionnant parcours analytique à travers un siècle d’écrivains « réactionnaires » ayant laissé au fil du temps le « beau style » être revendiqué pour leur compte, et ce qu’il y a réellement là-dessous, dans l’épaisseur des textes eux-mêmes. Une brillante enquête littéraire et politique de Vincent Berthelier.
De nos jours encore (et peut-être même davantage qu’il y a une trentaine d’années, mettons), une certaine presse de droite, voire d’extrême-droite, se plait à revendiquer le « style » (comme une figure largement mythique), la « belle » ou la « bonne » écriture, pour son camp (tout en affectant naturellement de ne pas développer de logique partisane sur ce terrain). Les exemples de cette affirmation, parfois légèrement humoristique, souvent profondément sérieuse, abondent, et une note de deux fois la longueur de celle-ci ne suffirait pas à les citer, même en se concentrant sur les cinq dernières années. Face à cette posture qui semble pourtant étonnante lorsqu’un peu de rigueur et de bon sens sont réellement mis en œuvre, il fallait aller y voir de plus près.
François Dufay, en 2006, dans son « Le soufre et le moisi : la droite littéraire après 1945 », avait approché ce phénomène français par l’angle des accointances, des complicités, des renvois d’ascenseur, des filiations souterraines et des agendas personnels. Mais il ne s’était guère intéressé à ce qui figure au centre de cette revendication littéraire : le style lui-même, l’écriture proprement dite.
Avec « Le style réactionnaire », publié aux éditions Amsterdam en août 2022, Vincent Berthelier, agrégé et docteur ès lettres, membre organisateur du cycle de séminaires « Les Armes de la critique », nous offre avec cette réécriture de sa thèse officielle de 2021 une vigoureuse escalade de cette face nord improbable et pourtant si puissante dans les imaginaires contemporains, en la pratiquant, avec beaucoup de courage et d’abnégation dans certains cas, au plus près des textes.
Dans la revue La Parisienne de juin 1955, en réponse à un article hostile de L’Express qui les qualifiait, lui et ses amis, d’écrivains de droite, Jacques Laurent avançait, par plaisanterie, qu’on pouvait naguère distinguer facilement la droite de la gauche : « À propos du paquebot Normandie, les gens de droite disaient La Normandie et les gens de gauche disaient Le Normandie. Voilà un paradoxe qui ravira les rédacteurs de L’Express habitués à juger sommairement. » De la sorte, il définissait un clivage politique par une variation de signes et, sans le savoir, renvoyait à ses détracteurs de gauche le diagnostic de Barthes sur le fantasme petit-bourgeois (et tendanciellement fasciste) d’un monde lisible, où chaque signe a un signifié univoque. Mais le signe politico-grammatical évoqué ironiquement par Jacques Laurent est en même temps un trait stylistique – c’est-à-dire un choix entre deux variantes formelles de même signification. La gauche, la droite, la politique en général seraient-elles donc une simple affaire de style ?
On aura l’occasion de revenir sur cet article de La Parisienne, mais l’on peut déjà s’attarder sur son titre : « Existe-t-il un style littéraire de droite ? » Pourquoi supposer ainsi qu’une catégorie esthétique (le style) puisse avoir une affinité particulière avec une option politique ?
En 1982, Bertrand Poirot-Delpech attribuait cela (sans y croire) au scepticisme de la droite : « Est-ce à dire que le nihilisme donne du style, puisque la droite s’en adjuge volontiers le monopole ? Que l’espoir engraisse la prose et que le désespoir l’affine ? » En 2016, cette intuition semble encore valide pour certains, à l’instar de Bruno de Cessole – qui reprend, avec une feinte naïveté, une argumentation élaborée de longue main par la droite elle-même, comme on aura l’occasion de le voir : « Il n’est pas nécessaire, d’autre part, d’exprimer des idées ou un engagement déterminés pour être un écrivain de droite. C’est un tempérament, un style, une sensibilité, plus que des convictions, qui classent un écrivain à droite. Sans généraliser, les écrivains d’idées sont plutôt des écrivains de gauche et les écrivains à style plutôt à droite. » Cette affinité ne se limiterait pas même au style. Evoquant Albert Thibaudet, le grand critique littéraire de l’entre-deux-guerres, selon qui les lettres françaises pencheraient à droite, tandis que le Parlement suivrait une tendance « sinistrogyre », Cessole imagine une relation élective entre la littérature et la droite.
Houellebecq mettait une idée similaire dans la bouche de Philippe Sollers, qui apparaît comme personnage dans Les particules élémentaires (1998) : « Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire, Dostoïevski : que des réactionnaires. » On perçoit l’idée implicite : la lucidité politique et le pessimisme anthropologique des réactionnaires confèrent leur force à la bonne littérature (qui ne se fait pas avec de bons sentiments). Ou encore : pour faire de la grande littérature, activité essentiellement solitaire, il faut être au-dessus de la mêlée démocratique et du vulgus. D’où, corrélativement, un style – entendu comme un marqueur d’individualité, comme le je-ne-sais-quoi grâce auquel un écrivain se distingue et se reconnaît entre mille. La gauche, c’est le collectif ; la droite (pour ne pas dire l’extrême droite), tout comme le style, c’est l’individu.
Des revues en ligne comme Causeur ont repris de façon plus ou moins affirmée cette idée que le lien entre la droite et la littérature se jouerait au niveau du style. Et derechef, si le style est le pivot de cette affinité, c’est parce que la droite littéraire serait indifférente aux idées. À gauche donc, la pesanteur idéologique, à droite la légèreté. Le terme de droite serait d’ailleurs impropre, car imposé par la lecture obsessivement politique de la gauche : il faudrait lui préférer l’expression négative « pas-à-gauche », forgée par Élisabeth Lévy. Le paradoxe énoncé par Jacques Laurent est donc à double fond : la politique est une affaire de style, parce qu’en réalité le style est une affaire d’apolitisme.
Construisant avec vigueur un corpus historique d’écrivains majeurs – ou en tout cas significatifs – étant ou ayant été, tous, même si à des moments différents, au minimum conservateurs et au pire authentiquement fascistes, Vincent Berthelier nous entraîne donc sur les chemins des écritures, détaillées dans leurs manières et dans leurs syntaxes, dans leurs ruses et dans leurs tics, dans leurs évidences et dans leurs surprises, de Charles Maurras, des cohortes de « puristes » du premier après-guerre (parmi lesquels se distinguent plus particulièrement Abel Hermant ou Abel Bonnard), de Georges Bernanos, de Marcel Jouhandeau, des engagés (à divers degrés) aux côtés du fascisme durant la deuxième guerre mondiale (Abel Bonnard, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La Rochelle, Henry de Montherlant, Robert Brasillach, Lucien Rebatet), de Marcel Aymé, de Jacques Chardonne et de Paul Morand, des « Hussards » (Roger Nimier, Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent), d’Emil Cioran, pour finir par une analyse très fine des trois auteurs beaucoup plus contemporains que sont Renaud Camus, Richard Millet et Michel Houellebecq.
À l’issue de ce parcours passionnant (même si certains textes servant d’illustrations sont parfois d’une troublante aridité, pour de tels défenseurs du « beau style »), Vincent Berthelier nous propose une impressionnante perspective critique, une véritable démythification, analytique et patiente, d’une revendication ayant trop souvent fini par couler de source contre toutes évidences. La complexité de l’écriture, y compris de certains des « esthètes de droite » les plus dandys en apparence, dépasse largement les simplifications opposant le style et les idées : la capacité de quelques auteurs à innover, celle d’autres plus nombreux à se couler dans un moule qui ne dit pas toujours son nom, mais qui n’est que rarement constitué uniquement d’élégance primesautière, ébranlent joliment le faux bon sens qui tente d’entourer le « beau style » et le passéisme qu’il est censé accompagner.
Ce livre a discerné trois moments dans l’histoire de la droite littéraire au XXe siècle. Le premier moment, l’entre-deux-guerres, a pour centre de gravité l’Action française. Il est dominé par une droite traditionaliste et nationaliste, qui est et se dit réactionnaire et dont les racines remontent au tout début du siècle. Le deuxième moment se compose des diverses tentatives de dépassement du nationalisme traditionnel et de la vieille droite monarchiste, dévalués par l’émergence du fascisme européen, avant d’être plus ou moins anéantis avec lui. Le troisième moment, qui s’ouvre à la fin des années 1970, est à part : les écrivains auquel nous l’associons n’ont pour ainsi dire aucun lien direct avec leurs prédécesseurs et sont venus à la littérature par de tout autres voies. Ils ont en commun le sentiment d’être arrivés après l’Histoire ; pourtant leurs livres font écho aux idées d’une nouvelle droite des plus actives.
Ces trois moments sont-ils seulement des moments politiques, où le littéraire se réduit à jouer le rôle de caisse de résonance des débats idéologiques ? Certes, le champ et les pratiques littéraires sont inséparables de l’état des débats intellectuels contemporains, et la chronologie historique impose à la chronologie esthétique le poids de ses événements. Néanmoins, ces trois moments se caractérisent aussi par des éléments stylistiques ayant leur logique propre. Le premier correspond à une conception fonctionnelle du style, qui doit exprimer des idées avec clarté et vigueur, dans une langue saine. La droite réactionnaire se fait alors le porte-étendard du français classique et des normes langagières. Le style souhaitable est surtout dépeint en creux par l’absence de défauts (le style « impeccable » de Maurras). Le deuxième moment est fort différent : les normes stylistiques ou langagières sont dédaignées en faveur d’une pose aristocratique qui se joue des codes usuels. Pour se détacher de la vieille droite poussiéreuse d’abord, puis des intellectuels de gauche enrégimentés, les écrivains de cette période adoptent un ethos de légèreté, tantôt dandy (Drieu La Rochelle, Morand), tantôt potache esthète (Brasillach et Rebatet), tantôt les deux à la fois (les Hussards). Enfin, la troisième période doit moins être pensée en termes de nonchalance que d’exigence. Alors que la précédente était peu ou prou indifférente aux avant-gardes littéraires, celle-ci a conscience d’écrire à rebours ou du moins après coup. Assumant l’anachronisme de sa démarche, Cioran se plie aux contraintes d’un français classique réinventé, parce que celui-ci est le lieu de la grandeur historique de la France. Et si Houellebecq rejette en bloc le formalisme du Nouveau Roman au profit d’un retour au roman figuratif, Richard Millet et Renaud Camus reconstruisent, chacun à sa manière, l’itinéraire qui les ramène au classicisme à travers l’avant-garde.
Ces trois périodes ont en facteur commun la recherche d’une forme de distinction, que celle-ci procède de la maîtrise de la langue nationale, du dédain pour les normes communes ou de la valorisation d’une haute culture incluant ce que les avant-gardes ont de plus hermétique. Cette pratique classante s’articule avec une tendance politique. Les écrivains réactionnaires (y compris ceux qui se réclament d’une veine populaire) ont en partage leurs convictions antidémocratiques et l’hostilité aux masses. C’est pourquoi chez eux, la distinction stylistique est le plus souvent consciente et non masquée : en ce sens, le style réactionnaire est un écart. Mais une définition plus stricte de l’idéologie ajoutera encore quelque netteté à ce que l’on peut entendre par « style réactionnaire ».
Hugues Charybde le 10/10/2022
Vincent Berthelier - Le style réactionnaire : de Maurras à Houellebecq - éditions Amsterdam
L’acheter chez Charybde ici