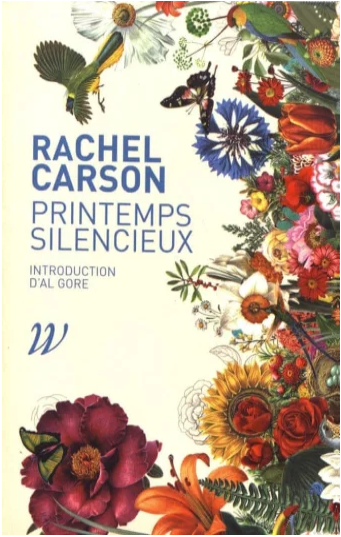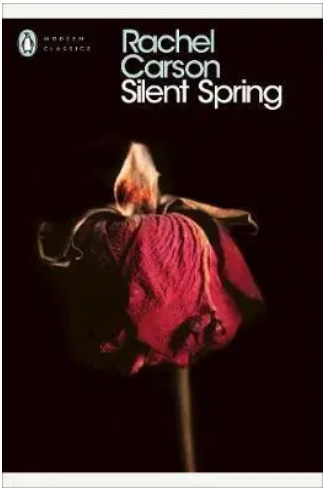Rachel Carson : En 1962, terrifique aperçu de la pollution agrochimique
En 1962, la première démonstration à grande échelle et à vaste retentissement du cynisme meurtrier des industriels de l’agrochimie. Et si tout cela avait encore beaucoup trop peu changé ?
Fable pour demain
Il était une fois une petite ville au cœur de l’Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l’entourait. Cette ville était au centre d’un damier de fermes prospères, avec des champs de céréales et des coteaux de vergers où, au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. À l’automne, érables, chênes et bouleaux formaient un incendie de couleurs qui brûlait et tremblait sur fond de pins. Les renards glapissaient dans les collines et les cerfs traversaient silencieusement les champs, à demi visibles dans les brumes matinales de novembre.
Le long des routes, les lauriers, les viornes, les aulnes, les hautes fougères et les fleurs sauvages enchantaient l’œil du voyageur presque toute l’année. Même en hiver, les bords des routes étaient beaux ; d’innombrables oiseaux venaient y picorer les baies et les graines que les herbes sèches laissaient pointer au-dessus de la neige. La campagne était d’ailleurs réputée pour l’abondance et la variété de ses oiseaux, et lorsque les flots de migrateurs déferlaient au printemps et à l’automne, les gens accouraient de très loin pour les observer. Des pêcheurs venaient aussi, attirés par les ruisseaux dont l’eau claire et fraîche descendait des collines, cherchant les trous ombreux affectionnés par les truites. Ainsi allaient les choses depuis les jours lointains où les premiers pionniers avaient édifié leurs maisons, creusé leurs puits et construit leurs granges.
Et puis un mal étrange s’insinua dans le pays, et tout commença à changer. Un mauvais sort s’était installé dans la communauté, de mystérieuses maladies décimèrent les basses-cours ; le gros bétail et les moutons dépérirent et moururent. Partout s’étendit l’ombre de la mort. Les fermiers déplorèrent de nombreux malades dans leurs familles. En ville, les médecins étaient de plus en plus déconcertés par de nouvelles sortes de dégénérescences qui apparaissaient chez leurs patients. Il survint plusieurs morts soudaines et inexpliquées, pas seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants, frappés alors qu’ils étaient en train de jouer, et qui mouraient en quelques heures.
Il y avait un étrange silence dans l’air. Les oiseaux par exemple – où étaient-ils passés ? On se le demandait, avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds ; ils tremblaient, sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. À l’aube, qui résonnait naguère du chœur des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de cent autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre ; le silence régnait sur les champs, les bois et les marais.
Dans les fermes, les poules couvaient, mais les poussins cessaient d’éclore. Les fermiers se plaignirent de ne plus pouvoir élever de porcs : les portées étaient faibles, et les petits mouraient au bout de quelques jours. Les pommiers fleurirent, mais aucune abeille n’y venait butiner, et sans pollinisation, il n’y avait plus de fruits.
Les bords des chemins, naguère si charmants, n’offrirent plus au regard qu’une végétation rousse et flétrie, comme si le feu y était passé. Eux aussi étaient silencieux, désertés de tout être vivant. Même les ruisseaux étaient sans vie, les poissons morts, et les pêcheurs partis.
Dans les gouttières, entre les bardeaux des toits, des paillettes de poudre blanche demeuraient visibles ; quelques semaines plus tôt, c’était tombé comme de la neige sur les toits et les pelouses, sur les champs et les ruisseaux.
Aucune sorcellerie, aucune guerre n’avait étouffé la renaissance de la vie dans ce monde sinistré. Les gens l’avaient fait eux-mêmes.
Cette ville n’existe pas, mais elle aurait facilement un millier d’équivalents aux États-Unis ou n’importe où dans le monde. Je ne connais aucun endroit qui a fait l’expérience de tous les malheurs que je décris. Et pourtant, chacun de ces désastres a réellement eu lieu quelque part, et de nombreuses communautés bien réelles ont déjà souffert d’un certain nombre d’entre eux. Un effroyable spectre s’est insinué parmi nous sans que nous nous en rendions compte, et cette tragédie imaginaire pourrait aisément devenir une réalité brutale que nous connaîtrons tous.
Qu’est-ce qui a déjà réduit au silence les voix du printemps dans d’innombrables villes américaines ? Ce livre essaie de l’expliquer.
À sa parution en 1962, ce n’est pas cette fable illustrative liminaire, qu’il s’agira d’expliquer tout au long de l’essai, mais bien la patiente investigation conduite par l’Américaine de cinquante-cinq ans Rachel Carson, alors biologiste marine renommée, comme scientifique et comme vulgarisatrice (son « Cette mer qui nous entoure » de 1951 a été un immense succès de librairie), mais pas spécialement tournée, initialement, vers la critique socio-politique, qui fera – enfin – trembler sur ses bases l’industrie chimique toute-puissante, aux États-Unis et ailleurs, et qui amènera à interroger, sérieusement mais tout de même fort timidement, la conquête du monde conduite alors à grandes déversées de millions de tonnes de pesticides un peu partout.
En quinze chapitres, « Printemps silencieux » (traduit une première fois chez Plon en 1963 par Jean-François Gravrand, traduction revue par Baptiste Lanaspeze en 2009, intégrant une remarquable introduction écrite par Al Gore en 1994, et désormais disponible chez les pionniers inlassables des éditions Wildproject) dresse le portrait accablant, effet secondaire par effet secondaire, patiemment documenté à partir de témoignages, d’études indépendantes et de sources officielles – exhumées et recoupées au lieu de rester parcellaires et enfouies -, des conséquences profondes et graves de la boulimie chimique pulvérisatrice qui a saisi les États-Unis et le monde depuis 1945, tout particulièrement. Rachel Carson analyse ici avec une particulière acuité les effets d’entraînement et les conséquences systémiques d’assauts empoisonnés qui prétendent toujours traiter un problème local, alors que les conséquences imprévues (ou dissimulées) peuvent s’enchaîner rapidement : dix ans après sa publication, les prolongements science-fictifs de ces empoisonnements à ramifications sous-estimées, si rien – ou toujours trop peu, trop lentement – n’est fait, seront mis en scène de manière terrifiante, par la raideur un peu empruntée du Philip Wylie de « La fin du rêve » et par le foisonnement spectaculaire du John Brunner du « Troupeau aveugle », tandis que le cynisme des opérateurs industriels sera le moteur narratif principal du Edward Abbey de « Désert solitaire », déjà en 1968, puis du « Gang de la clef à molette » en 1975.
La rapidité actuelle des changements, la vitesse à laquelle se créent des situations nouvelles correspondent plus au pas de l’homme, impétueux et irréfléchi, qu’à l’allure pondérée de la nature. La radioactivité ne provient plus simplement des émissions des roches naturelles et des bombardements de la Terre par les rayons cosmiques ou les ultraviolets du soleil, phénomènes antérieurs à la vie elle-même ; désormais, elle résulte aussi des créations artificielles de l’homme, qui joue avec les atomes. Les produits chimiques auxquels la vie doit s’adapter ne sont plus seulement le calcium, la silice, le cuivre, les minéraux arrachés aux roches par les eaux et transportés par les fleuves jusqu’à la mer ; ce sont aussi les produits de synthèse imaginés par l’esprit inventif de l’homme, fabriqués dans ses laboratoires, et sans équivalent naturel.
Pour s’adapter à ces éléments inconnus, la vie aurait besoin de temps à l’échelle de la nature : c’est-à-dire de siècles. Si d’ailleurs, par quelque miracle, cette adaptation devenait possible, elle serait inutile, car un flot continuel de produits chimiques nouveaux sort des laboratoires : près de 500 par an aux États-Unis. Ce chiffre est effrayant, et ses implications difficiles à saisir : 500 nouveaux produits totalement étrangers à l’expérience biologique, auxquels l’homme et l’animal doivent s’adapter tant bien que mal chaque année !
Parmi ces produits, bon nombre sont utilisés par l’homme dans sa guerre contre la nature. Depuis le milieu des années 1940, plus de 200 produits – sans parler de leurs dérivés – ont été créés pour tuer les insectes, les mauvaises herbes, les rongeurs, tout ce que le jargon moderne appelle les « nuisibles ». Ces substances sont vendues sous plusieurs milliers de noms de marque différents.
Sprays, poudres, aérosols sont utilisés presque universellement dans les fermes, les jardins, les forêts, les maisons d’habitation ; ce sont des produits non sélectifs, qui tient aussi bien les « bons » insectes que les « mauvais », qui éteignent le chant des oiseaux, coupent l’élan des poissons dans les rivières, enduisent les feuilles d’une pellicule mortelle, et demeurent à l’affût dans le sol ; tout cela pour détruire une poignée d’herbes folles ou une malheureuse fourmilière.
Est-il réellement possible de tendre pareils barrages de poison sur la terre sans rendre notre planète impropre à toute vie ? Ces produits ne devraient pas être étiquetés « insecticides », mais « biocides ».
Cette démarche de pulvérisation semble nous entraîner dans une spirale sans fin. Depuis que le DDT a été homologué pour l’usage civil, un processus de surenchère s’est mis en place, qui nous a contraints à trouver des substances toujours plus toxiques. Les insectes, en effet, dans une splendide confirmation darwinienne de la « survie du plus adapté » ont évolué vers des super-races immunisées contre l’insecticide utilisé ; il faut donc toujours en trouver un nouveau plus meurtrier – et un autre, plus meurtrier encore. Cette obligation a engendré aussi des contre-attaques lancées par la nature : au lieu de tuer les insectes, les pulvérisations entraînent souvent leur multiplication, pour des raisons que nous expliquerons plus loin. La guerre chimique n’est donc jamais gagnée, et toutes les vies sont exposées à ces violents feux croisés.
Parmi les conséquences du retentissement jamais vu alors de cet ouvrage, ainsi considéré à juste titre comme l’une des fondations de l’écologie militante contemporaine (et sauvagement critiqué à ce titre par tous ceux que peuvent mobiliser les soutiens de l’agro-industrie, et, bien au-delà, tous les partisans conscients ou inconscients de l’argent-roi), il y eut la création de l’Environment Protection Agency en 1970, organisme fédéral qui décida en 1972 l’interdiction de l’utilisation du DDT aux États-Unis, avant que le reste du monde n’emboîte progressivement le pas sur ce sujet. Notons toutefois que les autres pesticides analysés et dénoncés par Rachel Carson, membres infâmes des « Dirty Dozen » comme ils seront alors surnommés (et pas uniquement par des gauchistes, bien entendu), tels que l’aldrine, le chlordane, la dieldrine, le lindane, le toxaphène ou le parathion, ne seront interdits d’utilisation que par la Convention de Stockholm de 2001 (valable à partir de 2004), et encore, avec un dense tissu d’exceptions « temporaires ».
Ce que nous montre la lecture contemporaine de « Printemps silencieux », hélas, près de soixante ans après les faits, est l’extraordinaire capacité de l’agro-industrie (particulièrement emblématique, en ce sens, de l’art capitaliste de la manipulation de la démocratie) à conduire, grâce à un lobbying intense, accru et toujours davantage rentable, de phénoménaux combats retardateurs, dans lesquels chaque année gagnée, par la corruption directe ou indirecte, par la fragmentation des problèmes, par les contournements de juridictions, par la production d’études parcellaires et hautement dilatoires, notamment, se traduit en profits significatifs pour les actionnaires (que ceux-ci soient habillés ou non, cyniquement, en « défense des emplois » concernés). Le travail plus récent, en France, de Marie-Monique Robin, par exemple, autour du glyphosate et des néonicotinoïdes, nous montre à quel point les méthodes de riposte de trop d’industriels se sont affinées et améliorées au fil des années, dans un mépris absolument intact, en revanche, des équilibres systémiques et des populations touchées par les « effets secondaires » de leur quête inlassable de nouvelles ventes. Et c’est ainsi que « Printemps silencieux », avec soixante ans de recul, demeure à ce point vertigineux et précieux à lire.
Rachel Carson - Printemps silencieux - éditions Wildproject
Hugues Charybde le 22/02/2021
l’acheter chez Charybde ici