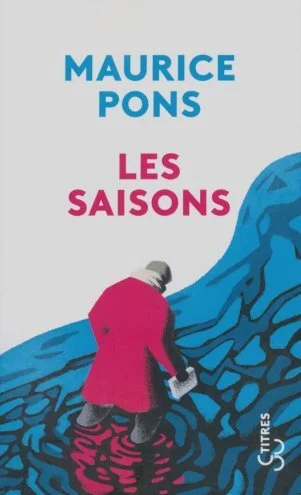Ainsi Pons, Pons, Pons et la servitude volontaire
La fable culte de la soumission librement consentie, l’humour grinçant de l’absurde quotidien, la joie sombre de la poésie inattendue et déchaînée.
Il arriva par le sentier de la cluse, vers le seizième mois de l’automne, qu’on appelait là-bas : la saison pourrie.
C’est Louana qui l’aperçut la première, et plus tard, lorsque le Conseil se réunit pour statuer sur le cas de l’étranger, elle intervint pour revendiquer ce premier regard. Elle avait ce visage d’enfant mongole, hilare, écarlate, qui n’était pas du pays ; elle avait ces intonations étranges qui faisaient qu’on l’écoutait toujours avec stupeur.
– C’est moi qui l’ai vu la première ! devait-elle crier ce jour-là au Conseil. Et elle avait ajouté en éclatant de rire : A travers le cul de ma mère !
Avec sa cousine Cherline, la pâle, la malingre Cherline, aux bras si blancs qu’ils attiraient les pinçons, Louana avait suivi la Brigde, sa mère, là-bas, vers les replats de San-Creps, tout en bordure de la faille rocheuse. Il avait plu la semaine entière, à verse, comme toutes les semaines précédentes depuis bientôt seize mois. Courbée en deux, les reins cassés, jambes nues dans ses bottines et par-dessus sa lourde jupe noire enduite de boue jusqu’aux cuisses, la Brigde n’avait cessé d’arracher, presque au ras du sol, les maigres plants de lentilles qu’elle enfouissait dans un bourras. Elle ruisselait d’eau, elle avait les doigts en sang et son postérieur barrait le ciel comme une montagne mouvante. De temps à autre, et sans même se redresser, elle se retournait pour houspiller les fillettes, les deux bougresses qui marchaient derrière elle dans le sillon pour ramasser la glane, et qui, dans son dos, se chuchotaient des immondices, en pouffant à chaque instant. Le visage de Louana brillait de rire et de pluie.
Et voilà que soudain, pinçant violemment sa cousine et éclatant de rire, elle cria de loin à sa mère :
– Hé, M’man ! Regarde, un type.
Elle disait vrai. Là-bas, sur l’autre versant de la cluse, on apercevait, au travers du rideau de pluie qu’agitait le vent, une lointaine silhouette sur la sente. Autant qu’on en pouvait juger, l’homme marchait d’un pas lent et appliqué en s’aidant d’un bâton. Il portait sur le dos un havresac et rentrait la tête dans les épaules, se faisant plus massif pour échapper aux bourrasques. Il semblait arriver de loin.
C’est en 1965 que « Les saisons », septième publication en volume du romancier, nouvelliste, comédien et cinéaste Maurice Pons, alors retiré de la vie parisienne depuis huit ans, au moulin d’Andé (Eure), paraît chez Julliard. Il sera régulièrement réédité jusqu’à la mort de l’auteur en 2016, et au-delà, devenant au fil des années l’incarnation-culte d’un art étonnant de l’épopée tragique, de la farce noire et du songe dévastateur. Christian Bourgois le réédite en juin 2020 pour inaugurer la nouvelle apparence de sa collection semi-poche, Titres.
Siméon laissa passer l’averse. Il demeurait là, immobile, à l’entrée de la salle, se frottant l’une à l’autre ses deux mains humides, dans un geste d’ecclésiastique frileux. Si étranges que lui parussent ces étranges chasseurs, il pensait bien que leur fou rire prendrait fin, et il attendait, hochant très légèrement la tête, et s’efforçant de sourire, pour enlever à son attitude toute nuance de condamnation.
Bientôt, en effet, les rires, après quelques hoquets, s’étouffèrent ; les positions se raidirent et commença une lente et sournoise négociation sur le mode conditionnel. Que Siméon prétendît dans ce café-hôtel recevoir le gîte et le couvert parut tout d’abord de la dernière incongruité.
– C’est qu’il ne vient pas grand-chose par chez nous, lui rétorqua d’abord l’aubergiste. Vous pensez, avec ce climat ! Et le peu qui vient, on le garde pour nous. On n’a pas besoin d’étranger.
En parlant, son visage s’animait d’une fièvre hargneuse. Elle avait des lèvres épaisses, très charnues pour une femme de son âge, et qui frémissaient ; au-dessus des lèvres, lui gâtant le visage, couperosé déjà mais point laid, une forte moustache sombre et une touffe de poils blancs, rêches à force d’avoir été coupés, qui dissimulaient mais en même temps précisaient un impressionnant grain de beauté. Des poils du même genre lui sortaient des oreilles et des narines.
Siméon regardait avec douceur, avec tendresse même, ce visage méchant qui l’affrontait. Il plaidait la frugalité extrême de ses appétits, et une accommodation naturelle aux conditions d’existence les plus frustes. Il ajouta un peu maladroitement :
– J’ai beaucoup souffert, autrefois… j’ai connu d’abominables horreurs…
Les deux douaniers bondirent vers lui, mus par une susceptibilité si soudaine et si semblable que Siméon ne douta pas d’avoir commis une bévue.
– Ah ! Ah ! Monsieur se figure peut-être qu’on ne souffre pas ici ! fit le douanier en second.
Il avait un regard chafouin, les paupières boursouflées, une courte moustache un peu rousse : Siméon pressentit que, tôt ou tard, cet homme-là lui ferait du mal.
Écrivain en devenir, mais très conscient de sa vocation, Siméon, issu d’un passé de souffrance impliquant un séjour en camp d’internement, passé dont on n’apprendra que quelques bribes indispensables au fil des 200 pages du roman, voit un matin – tout sauf beau – ses pas claudiquants le porter jusqu’au village. Lieu écrasé sous la pluie perpétuelle (en attendant une autre saison, au climat encore plus exigeant, s’il est possible), lieu dont les habitantes et habitants, rudes et grossiers, apparemment fort loin des préoccupations esthétiques et littéraires de Siméon, survivent chichement, dans la grisaille des lentilles d’eau, seule ressource agricole raisonnablement abondante dans ce coin déshérité du monde : c’est pourtant bien là que Siméon, pour des raisons difficiles à saisir, dont l’enchaînement causal constitue une bonne part de l’ossature souterraine du récit, choisit de poser son havresac, radical étranger espérant s’intégrer le plus harmonieusement possible au mode de vie local.
Siméon, du haut de sa porte, vit s’envoler sous la pluie, tournoyer un moment en l’air, puis se répandre çà et là sur le sol, près d’une cinquantaine de ses blancs feuillets satinés, aux précieux filigranes, en qui reposaient toutes ses espérances.
Dès que les douaniers, le béret bas sur l’oreille, eurent disparu en ronchonnant, au coin de la maison – et Siméon remarqua que cette fois, ils empruntaient l’un et l’autre le même coin – il descendit à son tour de l’échelle et courant partout derrière ses feuilles que le vent violent faisait tournoyer, il entreprit de rassembler, à grand-peine, son troupeau. Ce fut long et pénible. Certains feuillets étaient tombés à plat dans les rigoles de purin qui dégoulinaient des tas de fumier. La pluie tambourinait dessus, les rendant définitivement inutilisables. Siméon les ramassait tout de même, mais les roulait en boule et les jetait, et quelquefois, pris de remords, il courait après la boule, la dépliait, espérant la sauver, mais la rejetait à nouveau.
Enfin, il se retrouva au pied de son échelle, tenant à la main un gros bouquet en désordre de feuilles trempées et sales, tout ce qu’il avait pu sauver dans une périphérie accessible – car certaines, poussées par le vent, étaient parties trop loin ou derrière des palissades – et éprouvait un sentiment étrange, à peine définissable : au plus profond de sa misère, dont il était fort conscient, il serrait contre lui les feuilles qu’il avait sauvées, avec l’espérance d’un extrême bonheur – et de ce mélange de détresse et de joie naissait en lui une exaltation profonde, qui le faisait frémir et qui le fit tout à coup sangloter. Et en s’accrochant au montant de son échelle, il répétait :
– Ils ne savent pas, ils ne savent rien, ils ne connaissent pas leur bonheur, il faut que j’écrive…
C’est quand il mit les pieds sur le premier barreau de l’échelle, qu’il remarqua, soudain apaisé, qu’il était sorti ainsi, sans chaussures ni chaussettes. Et probablement, dans sa course éperdue, s’était-il cogné encore et estropié, car la plaie de son ongle, maculée de fumier, était toute sanguinolente.
Comme si, malgré la possibilité réelle de la gouaille, les cadres posés par le Marcel Aymé de « La jument verte » et de « La Table-aux-crevés », mâtinés du gothique râpeux du « Gormenghast » de Mervyn Peake (sans noblesse ni machiavélisme), maniant leurs résonances avec « Le château » de Franz Kafka et le « Pas Liev » de Philippe Annocque, avaient au fil des saisons des pluies et des saisons gelées, profondément mal tourné : Maurice Pons, dans son travail de fabuliste et de constructeur de métaphores lointaines, réalise aussi une formidable expérience de pensée, entrechoquant la vie matérielle (pour laquelle il développe – en se jouant – d’extrêmes conditions de température et de pression), l’obéissance et le renoncement (il est ici mené aussi une guerre soigneuse à l’espoir, « le sale espoir » de l’Antigone d’Anouilh), pour aboutir en une tristesse euphorique à une vie nue, bien avant celle analysée par Giorgio Agamben.
Une saison pour Maurice Pons (Sylvie Habault, 2016)
– C’est une maison honnête, ici, dit enfin la bonne femme. On ne garde pas sa pourriture.
Siméon expliqua que, précisément, il lui demandait conseil – et simplement conseil – afin de s’en débarrasser radicalement et ce, moins à cause de la douleur, finalement assez bénigne, qu’elle lui causait, que par respect pour elle et pour sa maison, et pour ce village qui avait la bonté de l’accueillir.
– Ici, fit alors Mme Ham, bêtes et gens, on va chez le Croll.
C’était là tout ce que Siméon, en tant qu’étranger, s’était permis de demander : une adresse, et il se fit expliquer, tant bien que mal, comment trouver la demeure de ce M. Croll.
– Et comment que je peux vous expliquer, si vous ne connaissez même pas le pays ! N’avez qu’à chercher vous-même. C’est dans le haut du pays, vers la Croix de Sépia.
Siméon ne se le fit pas dire deux fois. Depuis plusieurs semaines, il n’attendait qu’une occasion de visiter le village, et s’il n’avait pas jusqu’ici osé s’aventurer au-delà du pourtour immédiat du café-hôtel, c’était par crainte de passer aux yeux des habitants pour un quelconque touriste, occupé à tromper son oisiveté par de stériles promenades et de vaines curiosités. Il s’était déclaré écrivain et tenait à honneur de justifier son état, à tout le moins, par une attitude résolument sédentaire.
En vérité Siméon ne s’intéressait vraiment ni à l’architecture, ni au folklore, ni même aux beautés de la nature, et il imaginait assez que les ressources du pays dans ces domaines devaient être rudimentaires. Lors de son entrée dans le village, il n’avait remarqué ni église, ni château, ni même de ces portes cochères dont les touristes, généralement, sont assez friands. De plus, sa nature le portait à redouter tout contact avec les êtres humains. Non qu’il ne souhaitât pas, au fond de lui-même, parvenir à nouer des relations cohérentes avec les habitants du pays, mais il savait que sa vie entière n’avait été qu’un lent déchirement : il craignait que le moindre affrontement ne ravivât ses plaies ouvertes.
Cependant, puisqu’il avait maintenant un prétexte et même, aux yeux de Mme Ham qui ne manquerait pas, à l’occasion, d’en faire état, une justification : la nécessité où il était de consulter sur sa blessure M. Croll, il noua sa gabardine et s’engagea allègrement sur le chemin de la découverte.
Comme le dit avec une extrême justesse ma collègue et amie Marianne dans sa note de lecture sur ce même blog (ici), « Les Saisons » est un « livre de l’espoir gangrené qui meurt, [un] sombre questionnement sur la place de l’écrivain, éternel étranger, sur la possibilité d’écrire dans un monde insoutenable, livre incroyablement beau malgré la laideur du monde qu’il décrit. » Et c’est bien la vertu rare de cette imagination poétique que de glisser ainsi le politique global dans l’intime fabulé.
Maurice Pons - Les Saisons - éditions Christian Bourgois, collection Titres
Hugues Charybde le 3/09/2020
l’acheter chez Charybde ici
Maurice Pons