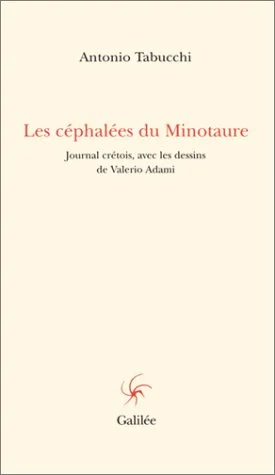Antonio Tabucchi fait un sort au Minotaure
Dans une esquisse crayonnée par Valerio Adami, au coin d’une pauvre table crétoise, l’invention fugace d’un autre Minotaure.
Cher Valerio, je crois que ce lieu, comme aucun autre peut-être, est idéal pour parler de ta peinture. J’ai emporté avec moi un peu de ton « atelier », quelques-uns de ses produits, sous forme de « photocopies », ainsi que tes « instructions » imprimées dans un petit ouvrage récent. Et puis quelques lectures sur les sites minoens, des vieilleries trouvées chez les bouquinistes de Florence ou de Paris, par exemple une pittoresque biographie d’Arthur Evans, où ce pionnier de l’archéologie est représenté sur de vieilles photos tandis qu’il dirige les fouilles du palais qu’il vient de mettre au jour : il est penché sur des pierres carrées qui affleurent au niveau du sol, à côté de lui, émergeant des mottes de terre retournées, il y a une amphore de Cnossos. Sir Arthur a l’air d’un braque qui a flairé la piste, son regard semble courir sur ce muret inattendu qui est sorti de la terre comme par enchantement, peut-être est-il déjà en train de l’imaginer suivant une géométrie qui lui est encore inconnue mais qu’il devine. Oui, il n’y a pas de doute, il a compris et a saisi le fil : il est maître du labyrinthe.
Antonio Tabucchi, dont le récent « Ces histoires qui arrivent » de Roberto Ferrucci, nous rappelait en beauté la profonde attention faussement désinvolte qu’il accordait à l’amitié, affectionnait notablement une forme particulière de témoignage littéraire dans ce domaine, celui de l’histoire-lettre, forme à laquelle appartiennent certains de ces textes les plus célèbres. En 2000, emmenant avec lui quelques dessins de son ami Valerio Adami (dont peut-être bien une copie de celui qui lui est directement consacré), il profite d’un bref séjour en Crète pour lui écrire, et pour ébaucher ce faisant une nouvelle visite du côté du mythe par excellence, celui du Labyrinthe et du Minotaure, mythe cher s’il en est à Fernando Pessoa comme à son traducteur et exégète italien.
Dans ce lieu désert et sauvage, que certains écrivains toujours en équilibre entre esthétisme et mysticisme définiraient comme « panique », je me suis mis nu et je me suis baigné. Il s’agit de situations pleines de risques, nous le savons, comme le sait l’homme de ton tableau qui regarde un jeune faune rose chair rempli de honte : aux aguets se tiennent des souvenirs d’adolescence et de roseaux, d’une fille épiée derrière les buissons, une érection tardive, le sentiment du ridicule, et avec lui une ombre indéfinissable de la mort. J’ai laissé toutes ces sensations me traverser tout en barbotant entre les pierres moussues, puis je me suis rhabillé et, avec ma voiture, j’ai roulé sur cette route de montagne escarpée où il y a une taverne pauvre qui loue des chambres pauvres. Des chambres pavées de briques, au-dessus du porche, avec un lit dont la tête est peinte de motifs populaires et un lavabo en fer forgé. Dans ces chambres, on fait des rêves pauvres. J’y ai fait le mien. C’est un de ces rêves frustes comme une veste qu’on aurait portée toute la vie, le rêve fait dans une chambre où l’on reconnaît cette chambre. Ah, cette chambre ! comme elle nous est familière !
Par les chemins de rocaille comme par les routes asphaltées et sinueuses, dans ces décors où, lorsque la pierre palatiale plusieurs fois millénaire n’affleure pas, on s’attendrait toujours à voir surgir le mécanicien dépenaillé et inventif du « Yparkho » de Michel Jullien, sans même parler de la silhouette dansante de l’« Alexis Zorba »de Nikos Kazantzaki, Antonio Tabucchi invente un autre Dédale, une autre créature confinée, qui a « mal à la tête et à l’univers entier ». En quelques pages d’une belle densité, même lorsqu’elles affectent avoir été couchées à la va-vite sur le papier au détour d’un virage ou sur coin de table d’une « taverne pauvre », c’est un autre abîme qui s’ouvre et un autre univers qui se réinvente ici. On pourra en lire une belle approche possible dans l’article érudit de Malgorzata Kobialka, « Le Minotaure » (Cahiers d’études romanes, 29/2014). Ces 34 pages d’Antonio Tabucchi, qu’il qualifiait in fine de « récit à expansion limitée », ont été traduites par Lise Chapuis et publiées en 2002 dans la collection Lignes Fictives de Cécile Bourguignon, aux éditions Galilée.
Borges et Dürrenmatt soupçonnèrent la mélancolie du Minotaure, mais peut-être ne leur fut-il pas donné de comprendre vraiment à fond sa maladie, le trajet du sang dans les veines et les artères, les marées impondérables de la sérotonine. C’est un état que seuls peuvent comprendre quelques malchanceux privilégiés, ceux qui, comme l’écrivit un poète, connaissent le mal de tête et d’univers.
Le premier à se rendre compte de ces terribles céphalées fut Dédale. Il savait qu’en brisant l’espace en un réseau de mille angles droits comme s’il était organisé par les yeux d’une mouche, on rend vaines les honnêtes intentions d’Euclide et on réduit sa patiente géométrie à un fractal insensé, qui terrorise. En déchiffrant cet espace, le nerf optique, avec la scansion duquel Euclide était parvenu à se mettre en harmonie, envoie au cortex cérébral des messages conflictuels, dont chacun nie le précédent. Un angle conduit à la liberté, un autre à la prison éternelle : mais ils sont égaux et complémentaires, ce sont des siamois de pierre moqueurs pour lesquels tout goniomètre est vain.
Antonio Tabucchi
Antonio Tabucchi, Les céphalées du Minotaure, éditions Galilée
Charybde2
l’acheter ici