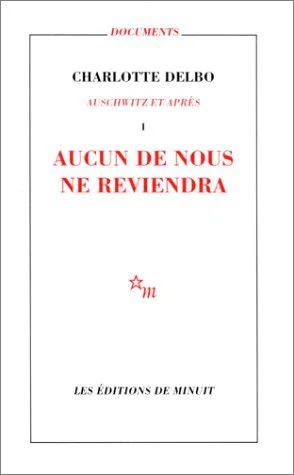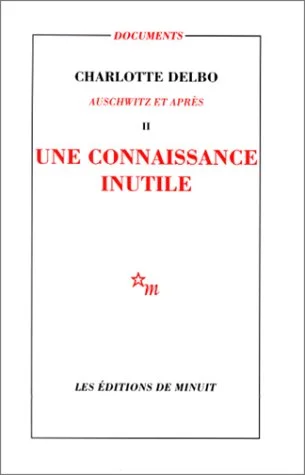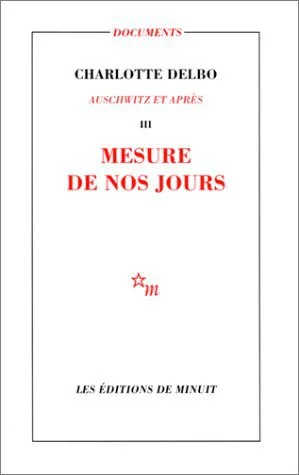Charlotte Delbo a planté ses mots dans l'horreur d'Auschwitz
L'extraordinaire récit à facettes d’une déportation à Auschwitz de 1943 à 1945 et du retour.
O vous qui savez
saviez-vous que la faim fait briller les yeux
que la soif les ternit
O vous qui savez
saviez-vous qu’on peut voir sa mère morte
et rester sans larmes
O vous qui savez
saviez-vous que le matin on veut mourir
que le soir on a peur
O vous qui savez
saviez-vous qu’un jour est plus qu’une année
une minute plus qu’une vie
O vous qui savez
saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux
les nerfs plus durs que les os
le cœur plus solide que l’acier
Saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas
qu’il n’y a qu’un mot pour l’épouvante
qu’un mot pour l’angoisse
Saviez-vous que la souffrance n’a pas de limite
l’horreur pas de frontière
Le saviez-vous
Vous qui savez.
Secrétaire de Louis Jouvet, militante communiste et résistante contre l’occupant nazi, Charlotte Delbo est arrêtée en 1942 en même temps que son mari (qui sera exécuté quelques mois plus tard), emprisonnée à la Santé puis au fort de Romainville, avant d’être déportée à Auschwitz en janvier 1943, avec 230 autres prisonnières politiques, dont elle sera l’une des 49 survivantes à la fin de la guerre. Publiés en 1965, à partir du manuscrit consigné depuis l’immédiat après-guerre par ses soins dans un gros cahier d’écolier dont elle ne se séparait plus, les trois tomes de « Auschwitz et après » constituent le témoignage qu’elle s’était promis, à l’époque, d’écrire un jour – principalement en mémoire de ses compagnes de captivité et d’horreur, mortes alors, assassinées, en Allemagne.
C’est à cette gare qu’ils arrivent, qu’ils viennent de n’importe où.
Ils y arrivent après des jours et après des nuits
ayant traversé des pays entiers
ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devraient pas être du voyage.
Ils ont emporté les enfants parce qu’on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là.
Ceux qui en avaient ont emporté de l’or parce qu’ils croyaient que l’or pouvait être utile.
Tous ont emporté ce qu’ils avaient de plus cher parce qu’il ne faut pas laisser ce qui est cher quand on part au loin.
Tous ont emporté leur vie, c’était surtout sa vie qu’il fallait prendre avec soi.
Et quand ils arrivent
ils croient qu’ils sont arrivés en enfer
possible. Pourtant ils n’y croyaient pas.
Ils ignoraient qu’on prît le train pour l’enfer mais puisqu’ils y sont ils s’arment et se sentent prêts à l’affronter
avec les enfants les femmes les vieux parents
avec les souvenirs de famille et les papiers de famille.
Ils ne savent pas qu’à cette gare-là on n’arrive pas.
Ils attendent le pire – ils n’attendent pas l’inconcevable.
Et quand on leur crie de se ranger par cinq, hommes d’un côté, femmes et enfants de l’autre, dans une langue qu’ils ne comprennent pas, ils comprennent aux coups de bâton et se rangent par cinq puisqu’ils s’attendent à tout.
Les mères gardent les enfants contre elles – elles tremblaient qu’ils leur fussent enlevés – parce que les enfants ont faim et soif et sont chiffonnés de l’insomnie à travers tant de pays. Enfin on arrive, elles vont pouvoir s’occuper d’eux.
Et quand on leur crie de laisser les paquets, les édredons et les souvenirs sur le quai, ils les laissent parce qu’ils doivent s’attendre à tout et ne veulent s’étonner de rien. Ils disent « on verra bien », ils ont déjà tant vu et ils sont fatigués du voyage.
La gare n’est pas une gare. C’est la fin d’un rail. Ils regardent et ils sont éprouvés par la désolation autour d’eux.
Le matin la brume leur cache les marais.
Le soir les réflecteurs éclairent les barbelés blancs dans une netteté de photographie astrale. Ils croient que c’est là qu’on les mène et ils sont effrayés.
Dans une forme évolutive, mutant à chaque page ou presque en fonction du propos, du poème martelé et lancinant au chant funèbre, du récit intimiste à la confidence chuchotée, le premier tome, « Aucun de nous ne reviendra », assène d’emblée l’horreur maximale, lorsque les prisonnières politiques (qui ne sont condamnées à mourir « que » d’épuisement, de maladie et de malnutrition, voire de coups occasionnels – si l’on ose utiliser ici ce « que ») assistent à l’arrivée des convois de Juifs promis, eux, à l’assassinat plus ou moins immédiat par gazage, dans le cadre de la solution finale décidée par les nazis. Parvenant à faire mentir la formule célèbre (et beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît) de Theodor W. Adorno à propos de l’impossibilité d’écrire des poèmes après Auschwitz, Charlotte Delbo use d’une langue rare et mobile pour nous faire partager, cruellement et simplement, l’horreur indicible – à son plus haut degré concevable, sans doute. Écrivant depuis Birkenau (Auschwitz II), encore plus au centre du massacre industriel – si vaillamment décortiqué par le Robert Merle de « La mort est mon métier » (1952) – que le Primo Levi de « Si c’est un homme » (1947) ou l’Elie Wiesel de « La Nuit » (1958), qui racontent l’horreur à partir du camp d’Auschwitz III (Monowitz), consacré au travail pour les industries allemandes de guerre, et non à l’extermination directe, elle parcourt de ses mots d’une terrible et glaçante beauté le froid, la faim, la peur incessante, la maladie qui rôde, les coups qui pleuvent aux moindres prétextes ou même en leur absence, l’ombre permanente du Revier, l’hôpital dont on ne revient pas, et du Block 25, antichambre de la mort par gazage, où sont envoyées les prisonnières politiques trop faibles, trop abîmées pour continuer à produire (aussi aberrante que soit cette production, fruit malade de la techno-bureaucratie nazie, qu’analysait encore récemment et brillamment le Christian Ingrao de « La promesse de l’Est »).
Et au printemps des hommes et des femmes répandent les cendres sur les marais asséchés pour la première fois labourés et fertilisent le sol avec du phosphate humain.
Ils ont un sac attaché sur le ventre et ils plongent la main dans la poussière d’os humains qu’ils jettent à la volée en peinant sur les sillons avec le vent qui leur renvoie la poussière au visage et le soir ils sont tout blancs, des rides marquées par la sueur qui a coulé sur la poussière.
Et qu’on ne craigne pas d’en manquer il arrive des trains et des trains il en arrive tous les jours et toutes les nuits toutes les heures de tous les jours et de toutes les nuits. C’est la plus grande gare du monde pour les arrivées et les départs.
C’est peut-être dans sa description subtile et néanmoins minutieuse des liens de solidarité tissés au quotidien infernal du camp de la mort, conditions essentielles de la survie (en un jugement corroboré par la grande majorité des analyses ultérieures de la survie à Auschwitz ou dans les autres camps d’extermination, avec l’autre facteur crucial : la simple chance), que Charlotte Delbo atteint son maximum de beauté paradoxale et d’efficacité redoutable, une solidarité d’autant plus extraordinaire qu’elle doit être pesée au millimètre, à chaque instant, lorsque le geste de soutien de trop peut signifier en quelques secondes la mort de l’âme charitable. Valentine Goby et son « Kinderzimmer » (2013) situé à Ravensbrück, comme David M. Thomas et son « Nos yeux maudits » (2010) situé à Mauthausen, rendaient d’ailleurs tous deux un hommage appuyé à l’écriture de Charlotte Delbo à ce sujet, lors de leur passage commun à la librairie Charybde en janvier 2014.
L’APPEL
Quand il se prolonge, c’est qu’il y a quelque chose. Erreur de compte ou danger. Quelle sorte de danger ? On ne le sait jamais. Un danger.
Un SS s’approche, que nous reconnaissons tout de suite. Le médecin. Aussitôt, les plus fortes se glissent sur le devant, les plus bleues se pincent les joues. Il vient vers nous, nous regarde. Sait-il ce qui nous étreint sous son regard ?
Il passe. Nous retrouvons notre respiration.
Plus loin, il s’arrête aux rangs des Grecques. Il demande : « Quelles sont les femmes de vingt à trente ans qui ont eu un enfant vivant ? »
Il faut renouveler les cobayes du block d’expériences.
Les Grecques viennent d’arriver.
Nous, nous sommes là depuis trop longtemps. Quelques semaines. Trop maigres ou trop affaiblies pour qu’on nous ouvre le ventre.
Auschwitz
Après nous avoir plongé frontalement dans l’horreur, Charlotte Delbo consacre les deux autres tomes d’ « Auschwitz et après », « Une connaissance inutile » et « Mesure de nos jours », à donner une épaisseur extraordinaire à l’expérience de la survie, en organisant de multiples détours qui fonctionnent à la fois comme autant de subtiles soupapes de sécurité (le séjour dans un camp satellite aux allures de ferme expérimentale, le montage secret du « Malade imaginaire » de Molière au texte reconstitué de mémoire, ou même la tulipe à la fenêtre d’une maison) et de brutaux rappels à la réalité (les angoisses de la fin déliquescente du nazisme à Ravensbrück, où un petit groupe de prisonnières politiques françaises dont faisait partie Charlotte Delbo a été transporté in extremis à l’approche des Soviétiques d’Auschwitz – et sans « marche de la mort » -, le désarroi total du rapatriement et du retour à une vie « normale », enfin, et la montée terrifiante de souvenirs et de vertiges qui va y correspondre).
Au retour, bien avant d’arriver à la maison du lac, nos yeux la guettaient. Elle était là, sur le fond des rideaux blancs. Coupe rose entre les feuilles pâles. Et pendant l’appel, à des camarades qui n’étaient pas avec nous, nous disions : « Nous avons vu une tulipe ».
Nous ne sommes plus retournées à ce fossé. D’autres ont dû l’achever. Le matin, au croisement d’où partait la route du lac, nous avions un moment d’espoir.
Quand nous avons appris que c’était la maison du SS qui commandait la pêcherie, nous avons haï notre souvenir et cette tendresse qu’ils n’avaient pas encore séchée en nous.
Charlotte Delbo, tout au long de ces 550 pages (en petit format aux éditions de Minuit) témoigne d’une rare capacité à entrelacer des vignettes aux formes incisives, à parcourir avec une désarçonnante élégance les champs de la mort, de la folie et de la résistance forcenée à ce qui nous broie, pour nous offrir l’une de ces lectures qui marquent très profondément, dans la chair et dans l’esprit. « Auschwitz et après » est certainement, évidemment, une expérience éprouvante. Mais elle est, curieusement, indispensable et belle.
Auschwitz
Notre ami Claro parlait superbement de « Auschwitz et après » lors de sa venue en libraire d’un soir (la deuxième) chez Charybde en mars 2015, expliquant notamment à quel point, pour elle, « c’est précisément parce que la poésie est impossible après Auschwitz qu’elle est devenue plus que nécessaire ». Dans le même exercice, en janvier 2014, Catherine Dufour nous présentait la biographie consacrée à Charlotte Delbo par Violaine Gelly et Paul Gradvohl. Les images sont ici de Patrick Imbert, dont il faut parcourir l’étonnant « Week-end à Oswiecim ».
LA NUIT
Les pieuvres nous étreignaient de leurs muscles visqueux et nous ne dégagions un bras quepour être étranglées par un tentacule qui s’enroulait autour du cou, serrait les vertèbres, les serrait à les craquer, les vertèbres, la trachée, l’œsophage, le larynx, le pharynx et tous ces conduits qu’il y a dans le cou, les serrait à les briser. Il fallait libérer la gorge et, pour se délivrer de l’étranglement, céder les bras, les jambes, la taille aux tentacules prenants, envahissants qui se multipliaient sans fin, surgissaient de partout, tant innombrables qu’on était tenté d’abandonner la lutte et cette exténuante vigilance. Les tentacules se déroulaient, déroulaient leur menace. La menace restait un long moment suspendue et nous étions là, hypnotisées, incapables de risquer une esquive en face de la bête qui s’abattait, s’entortillait, collait, broyait. Nous étions près de succomber quand nous avions soudain l’impression de nous éveiller. Ce ne sont pas des pieuvres, c’est la boue. Nous nageons dans la boue, une boue visqueuse avec les tentacules inépuisables de ses vagues. C’est une mer de boue dans laquelle nous devons nager, nager à force, nager à épuisement et nous essouffler à garder la tête au-dessus des tourbillons de fange.
Charlotte Delbo - Auschwitz et après (I - Aucun de nous ne reviendra, II- Une connaissance inutile, III- Mesure de nos jours) - éditions de Minuit
Charybde2
Les acheter en cliquant sur les titres de chaque ouvrage