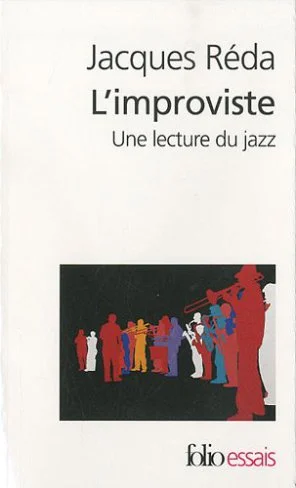L'Improviste : Jacques Réda écrit jazz comme d'autres le jouent
Un parcours historique personnalisé dans le jazz, aux côtés d’un critique fin connaisseur et enthousiasmant poète.
Publié en 1980 chez Gallimard, puis profondément revu en 1990 (et intégrant dans l’édition finale de 2010 l’ouvrage « Jouer le jeu », qui, sur le même modèle, était entièrement consacré aux pianistes), cet essai historique et critique de Jacques Réda s’appuie sur la phénoménale culture du jazz, lisible au fil des années, depuis 1963, dans Jazz Magazine, de ce poète célébré en de nombreuses occasions. La rencontre de son écriture évocatrice, à la fois précise et diaphane, avec l’histoire de ce genre musical et de certaines de ses figures marquantes, offre à la lectrice ou au lecteur une réussite rare.
Sidney Bechet a joué avec le feu. Aussi est-il devenu comme un symbole pour ceux qui, dans le jazz, ont perçu l’effet d’un principe diabolique. On raconte que même Hugues Panassié, d’ailleurs expert en exorcismes (et qui de toute évidence l’admirait), s’était toujours défié de Bechet dont les deux chalumeaux – le saxophone-soprano et la clarinette – sont du dangereux type oxhydrique. A ce « mélange d’hydrogène et d’oxygène dont la combustion dégage une chaleur considérable », de fait il n’ajoute pas qu’une dose de phosphore qui le rend tout à fait incendiaire et déflagrant : on y détecte aussi des traces importantes de soufre. L’éclat fantastique de sa flamme n’arrive pas à cacher on ne sait quelle ténébreuse chimie de son aliment.
Organisé de manière presque chronologique, « L’improviste » nous emmène avec ferveur des fondamentaux indispensables, tels que la notion même de swing ou celle des racines blues, vers, en reprenant quelques titres des chapitres, le feu de Sidney Bechet, l’espérance de King Oliver, la mémoire de Jelly Roll, les bonheurs et tracas du chimiste Fletcher Henderson (Jacques Réda est ici particulièrement à l’aise dans l’art de filer la métaphore savoureuse et significative), le dernier combat de Louis Armstrong, vers Ellington et sa mise en oeuvre, vers le pas du patineur de Benny Carter, les équilibres de Lionel Hampton, le rebond et la glissade de Jimmie Lunceford et de Count Basie, l’impatience de Roy Eldridge, le mot juste de Harry Eddison, le mouvement de Lester Young, la coupure de Charlie Parker, la lueur du crépuscule de Miles Davis, le cri d’Albert Ayler, la boucle et la rupture d’Earl Hines et de Fats Waller, les petites choses de Bill Basie, ou encore vers Duke Ellington en tant que « the piano player of the band », vers le surclassicisme de Teddy Wilson, l’art sans commencement de Thelonious Monk, le double écart d’Erroll Garner, l’oiseau rare que fut Dodo Marmarosa, le passage perpétué de Sir Charles Thompson, la force de Bud Powell, les deux pèlerins de la transparence que furent Hank Jones et Tommy Flanagan, la note de John Lewis, le carillonneur Phineas Newborn, les silences d’Ahmad Jamal, la disparition incarnée par Jimmy Jones, et enfin, vers Oscar Peterson, en tant que « dernier pianiste ».
Benny Carter
[À propos de Benny Carter] Bien que d’autres l’aient précédée, je mentionnerai, comme symbole des étapes franchies dans cette conquête de l’espace, un New street swing gravé le 24 mars 1937 en Hollande avec l’orchestre local des Ramblers. Les pièces enregistrées à Paris, en avril et en août de la même année (publiées sous son nom ou celui de Coleman Hawkins) permettent d’apprécier les véritables dimensions de la patinoire. Rien n’empêche d’imaginer qu’elles aient pu rendre rêveur Einstein. La théorie de la relativité s’y trouve musicalement confirmée, améliorée peut-être : l’espace-temps n’y dépend plus de ses dimensions ni du rôle de la vitesse, et le rythme y joue à sa manière celui de la gravité. L’art de Carter se trouve donc en corrélation très étroite avec la question du swing, qui n’est de nature métaphysique que dans la mesure où la physique s’interdit par déontologie de la poser.
Le récit technique et néanmoins poétique est entremêlé finement de quelques curiosités, qui vont de quatre lettres de Coleman Hawkins, un éloge en vers de Benny Goodman, un dialogue entre Billie Holiday et Lester Young, une ode à Eric Dolphy, une autre à Art Tatum, ou encore un tombeau dédié à Bill Evans.
Sidney Bechet
De quelque façon qu’on l’analyse (la sociologie, la politique et même l’économie ont dit ici leur mot), il semble que le jazz ait toujours voulu être plus ou autre chose que lui-même. En témoignent sa rapidité à exploiter le possible de ses ressources particulières, son besoin impatient d’en repousser les limites et de les abolir. Peut-être faut-il y voir encore le résultat d’une intensification générale des rapports propre au monde moderne, et telle, qu’ayant pu par une convergence d’appoints hétéroclites vite brassés, vite assimilés, déterminer la naissance de cette musique, elle aura de même, par sursaturation de ses capacités d’absorber, compromis son équilibre, entraîné sa dislocation. Ainsi le jazz s’exposait-il à succomber à la violence, en même temps réaction de défense et symptôme d’un épuisement. On pourrait ironiser sur le regain d’attrait qu’il exerce, n’existant pour ainsi dire plus qu’à l’état d’écho ou réitération de ses fastes anciens, si l’essentiel de ce qu’a dégagé son histoire – le swing – n’assurait sa capacité de rester présent, tant par le corpus achevé mais préservé de ses œuvres, que par celles qui maintenant se situent comme rétroactivement dans leur mouvance, là où le swing déjà transcendait les catégories du temporel ; et si la fin des arts affectait ce qu’elles ont à jamais concentré de signification humaine.
En tous points, l’écriture de Jacques Réda fait merveille. Usant très subtilement le plus souvent, et par moments de manière plus flamboyante, d’une poésie métaphorique qui est en soi délectable, il nous fait saisir les nuances musicales et historiques d’une histoire personnelle, particulière, spécifique, du jazz, de l’interaction entre quêtes personnelles et sens d’un collectif disparu et toujours à renaître, avec un sens esthétique qui donne à voir, à entendre et à penser à toute tentative critique, littéraire ou autre.
Dans la vie de quelques grands artistes, et dans celle des plus grands, on croit déceler l’action d’une fatalité draconienne : ils n’ont pas pu faire autrement. Ou bien ils l’imaginent mais ça revient au même : il y a eu quelque part promulgation d’une règle qui ne vaut que pour eux, dont ils sont le seul ressort et l’unique autorité de justice. Or en plus de sa contradiction organique avec la Loi, cette règle sans autre caution que la violence de son arbitraire engendre du trouble et des combats. D’autres cependant donnent l’impression d’avoir eu le loisir de débattre, et puis de peser leur choix, qui va d’ailleurs les engager autant sinon même davantage, puisqu’on les voit s’y tenir ainsi parfois plus de cinquante ans, sans trace de soubresaut ni d’entêtement dans une routine. Plutôt par une sorte d’inflexible et tendre courtoisie envers leur décision. Il en reste néanmoins comme un effet de distance dû à cette première latitude : l’ombre de l’idée qu’on pourrait encore et toujours se résoudre à « faire autrement », mais au prix d’une trahison bien sûr énergiquement refusée. C’est là une vue à la fois réaliste et chevaleresque de l’art, s’opposant aux décrets du sort et à la surenchère lyrique. On ne s’étonne pas alors du goût de Freeman pour la littérature et les auteurs français, qui apporte quelques adoucissements aux rigueurs de son anglomanie ; on l’imagine assis dans le bus à côté de Fargue, ou de Ponge, ou de Larbaud, donc, en 1928, lors de son premier passage à Paris. Et l’on découvre d’autres sens au titre de son livre autobiographique : You don’t look like a musician.
Jacques Réda - L'Improviste, une lecture du jazz , éditions Folio Gallimard
Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.