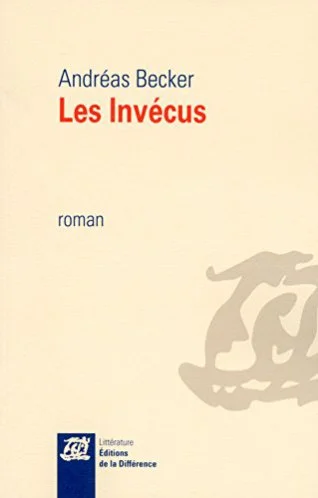Andreas Becker : alternative à une vie accidentée qui aurait pu, éventuellement, être différente si…
Comment, ici, dans ces « Invécus », un tragique accident de voiture, il y a vingt ans, m’a-t-il formé, au sens propre, a-t-il fait de moi, très majoritairement, ce que je suis : un invécu, bloqué dans une étrange stase temporelle qui envahit tout l’espace-temps qui aurait dû être consacré à vivre ?
Publié début avril 2016 aux éditions de La Différence, le quatrième roman d’Andréas Becker poursuit en beauté, en inventant à nouveau le langage ad hoc nécessaire, outil développé dans la douleur et l’entrechoc pour tenter de répondre à la terrible question qui hante ses œuvres : qui suis-je ? Comment puis-je accéder (ou ré-accéder) à l’identité, à une identité authentique, si j’ai été étiqueté, catalogué, schizophrène et martyr (« L’effrayable », 2012), folle (« Nébuleuses », 2013) ou gueule cassée (« Gueules », 2015) ? Comment, ici, dans ces « Invécus », un tragique accident de voiture, il y a vingt ans, m’a-t-il formé, au sens propre, a-t-il fait de moi, très majoritairement, ce que je suis : un invécu, bloqué dans une étrange stase temporelle qui envahit tout l’espace-temps qui aurait dû être consacré à vivre ?
Les tombeaux sortiraient de l’étang. De la forêt monterait la complainte noire des pins recourbés et veufs. Un sifflement mauvais traverserait un monde aux abîmes, baigné dans un sang noirâtre. La poubelle que le vieux venait de sortir virevolterait, s’arrêtant en plein vol dans un ciel trop limpide, trop innocent pour faire voûte au désastre.
Le conducteur sortirait à quatre pattes de la carcasse alors que le corps de l’accidenté percerait la haie de fusains. Coupable et victime deviendraient des invécus, leur accident désormais les unirait, les confondrait dans un magma de métaphores et de mensonges, vie et mort s’entrecroiseraient comme dans un jeu de miroir. Voir clair s’apparenterait à un crime. Naître complètement relèverait de l’impossible.
Peut-être davantage encore que dans les impressionnantes inventions langagières des romans précédents, « Les invécus » construit son ‘écriture comme seule possibilité concrète d’échapper au cauchemar – désormais indiscernable de la réalité – qu’est devenu la vie du narrateur, après qu’il ait un jour, tout jeune conducteur, écrasé un retraité qui sortait ses poubelles devant son pavillon. Acte fondateur devenu unique, tabula rasa qui n’a jamais pu devenir fondatrice, ce choc a construit de facto les limbes ou le purgatoire auxquels le narrateur s’est lui-même condamné. Peut-il, veut-il en sortir ? Seule l’écriture lui offre peut-être, une chance – et « Les invécus » est cette fabuleuse tentative, en 200 pages où le mode conditionnel se fait pied-de-biche, pour imaginer une uchronie personnelle, pour chercher une histoire alternative à une vie accidentée qui aurait pu, éventuellement, être différente si…
Marche à la mort (Hans Baldung, XVIe siècle)
J’ai saigné. Mon bras a saigné, mais il ne saigne plus. Je sors le matin quand je pressens que le bonheur d’un monde frais, fort, inondé de l’encre d’une nuit capricieuse, peut supporter une chose aussi mal vécue que moi. J’ai besoin d’une nouvelle grammaire sinon je n’irai pas plus loin, seul le conditionnel me permettrait de me glisser dans le dicible. J’écrirais des phrases avec des majuscules au début et des points à la fin, avec des mots, des vrais enfin. On me l’aurait conseillé. Quelques os bringuebaleraient pour tenir les abîmes, leur donner squelette encore, autant qu’imaginable. Je finirais en déambulateur, dans un déambulatoire, le moment venu. En attendant l’asile libérateur il faudrait encore tenter, toujours tenter, mal tenter ; la tentation, seule échappatoire des comme nous, des invécus, des pas morts ni vivants.
Comme le note avec grande justesse Anne Vivier sur son blog Racines, Andréas Becker déploie une écriture extrêmement rusée pour parvenir à rendre indiscernables ou presque le rêve et la réalité, pour donner à cette stase bloquée, qui repasse et ressasse inlassablement le drame originel, l’épaisseur d’un vécu, précisément. Chaque notation de réel vient s’insérer impeccablement dans ce rêve éveillé persistant, compliquant sans cesse la tâche d’en sortir éventuellement : collègues au sein d’une équipe de vente, peut-être, commentaires plus ou moins compatissants sur le retour de dépression, souvenirs à vif du moment originel, bouffées de culpabilité prenant toutes les formes possibles ou imaginables, cascades de conséquences familiales délétères et autres enchaînements implacables,… Comme lorsque la DreamMaster 301 de Norman Spinrad (« Le temps du rêve », 2012) se détraque insidieusement, les échappatoires concrètes disparaissent, la prison du cauchemar épaissit sans relâche ses barreaux, la vie ne se vit pas.
Le corps atterrirait dans un joli massif de roses, sa distorsion imprimerait des stigmates asymétriques dans la terre lourde qui bientôt seraient invisibles à l’œil nu. Le massif aurait été remplacé par une large bande de gazon sans ornement, tout comme auraient été rasés les quelques moignons de la haie qui subsisteraient après l’accident, le bouleau à côté du pavillon aurait été abattu. La veuve aurait vendu le pavillon au plus vite, quittant le village de l’oppression mutique, n’emportant qu’une liasse de feuilles comme seul bagage, longue lettre que le jeune conducteur lui aurait adressée ; ruine langagière de laquelle pousseraient quelques fleurs chétives d’un vécu effrayant.
Andréas Becker nous offre ainsi une nouvelle exploration surréelle de la force du langage, outil et arme, dont il faut éprouver à chaque page les possibilités, la puissance et l’impuissance, la contribution insensée à une issue possible, et la persistance terrible du risque de l’échec. Et il nous prouve au passage qu’il est bien l’un des écrivains les plus intéressants que l’on puisse lire à l’heure actuelle.
Les Invécus d'Andréas Becker , éditions de La Différence
Coup de cœur de Charybde2
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.
Andréas Becker