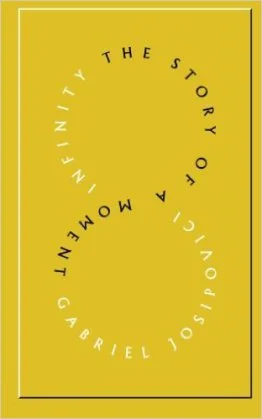Comment le compositeur Giacinto Scelsi a suspendu le temps musical
Arraché aux confidences de son serviteur, le parcours d’un compositeur rageur et obsessionnel, en 150 énormes pages.
Publié en 2012, le dernier en date des romans de Gabriel Josipovici, traduit chez Quidam en janvier 2015 par Bernard Hoepffner, est sans doute son plus curieusement et paradoxalement joyeux, et l’un des plus étonnants. S’appuyant étroitement sur la vie connue du compositeur italien excentrique et d’avant-garde Giacinto Scelsi (1905-1988), à la radicalité et aux outrances fameuses, il en extirpe un fabuleux monologue à épisodes et à éclipses, réputé arraché après sa mort aux confidences réticentes de son fidèle majordome et chauffeur par un interviewer mystérieux. De ce monologue potentiellement apocryphe surgit ainsi, lumineuse et acide, péremptoire et tendre, injuste et guerrière, réactionnaire et exigeante, une vision de l’art, de la vie et du monde, synthétique comme une note longuement méditée avant d’être invoquée, foisonnante comme les sources auxquelles peut et doit s’abreuver l’inspiration qui doit nourrir l’insatiable appétit d’un ogre allant s’éteignant, incomplète comme une pensée qui aurait paradoxalement démarré trop tard.
Roule, Massimo, roule, disait-il. Si nous avons faim, nous nous arrêterons quelque part pour manger un morceau. Parfois il était complètement silencieux, il réfléchissait à sa musique. Il fermait les yeux et s’enfonçait dans son siège. Je le voyais du coin de l’œil. De temps en temps, il faisait un peu de bruit, un bourdonnement ou un aboiement ou quelque chose comme la-la-la. Parfois il passait une main sur son visage ou faisait un mouvement de la main comme s’il essayait de saisir quelque chose. Puis il était de nouveau immobile pendant longtemps. Peut-être s’était-il endormi. C’était difficile à dire. Quand il avait marché toute la nuit il faisait une longue sieste pendant la journée. Il lui arrivait de ne pas s’éveiller avant six ou sept heures du soir. À d’autres moments il aimait parler pendant que je conduisais. Il parlait de tout. De sa voix lente et hypnotique. La voix d’un aristocrate, si vous voyez ce que je veux dire, monsieur. Mais aussi la voix de quelqu’un qui se parle à lui-même plutôt qu’il ne vous parle. Quand nous mourons, Massimo, a-t-il dit, nous devons nous assurer que nous ne laissons pas de chaos derrière nous. Ce ne serait pas juste pour ceux qui viennent après nous.
Le compositeur Giacinto Scelsi
Là où le monologue à échos dialogués de « Tout passe » (2006) semblait impliquer une nostalgie confiante autour de l’art qui n’a pas pu être produit ou analysé, et de la vie qui n’a pas été vécue, là où le faux dialogue déambulatoire de « Moo Pak » (1994) tentait d’établir des passerelles de génie entre des champs artistiques apparemment disjoints et entre des tranches de vie potentiellement chaotiques, là où les polyphonies piégeuses de « Goldberg : Variations » (2002) tentaient de proposer une idée de la beauté artistique et de la vie s’y dédiant telles qu’elles se construisent en toute improbabilité, « Infini » se déploie autour des contrastes, à la fois violents et comiques. Contraste entre l’audace avant-gardiste radicale de la musique et la futilité de la collection de chaussures, de chemises et de cravates de Tancredo Pavone (qui ne s’appelle ainsi certainement pas « le paon » en italien par hasard), contraste entre sa sensibilité exacerbée et insatisfaite et son conservatisme colérique et péremptoire, contraste entre son éther apparent et le prosaïsme sans faille de son serviteur : effets de vertige et effets d’humour dans la marge s’enchaînent à toute allure, scandés par le rappel permanent que ces propos sont rapportés.
D’abord, a-t-il dit, j’ai attaqué tous les pianos à ma portée avec mes poings et mes pieds. J’ai fait claquer les couvercles et j’ai caressé les cordes et j’ai utilisé mes coudes pour étouffer les touches. Le piano a été mon premier amour, a-t-il dit. J’ai compris que je pouvais lui faire exprimer tous les sons que je voulais et beaucoup d’autres dont je n’avais même pas rêvé. Il était heureux, a-t-il dit, que les maisons où nous habitions aient été si grandes parce que, même toutes les portes fermées, je faisais un bruit de tous les diables. Je ne voulais rien avoir à voir avec les sons de salon qu’exprimait le piano quand mes parents invitaient les pianistes et chanteurs célèbres de l’époque à jouer et chanter, a-t-il dit. Je haïssais ces pianistes et chanteurs du fond de mon cœur. Je haïssais les sons qu’ils produisaient et je haïssais les airs qu’ils se donnaient. Il a fallu deux guerres mondiales pour nettoyer le monde de ces sons et de ces chansons. Il faudrait les aligner devant un des murs de leur salon et les fusiller, a-t-il dit, tout comme les pianistes et les chanteurs qu’ils invitent. Le piano est un univers, Massimo, a-t-il dit, ce n’est pas un monde, ce n’est pas un pays, et ce n’est certainement pas un salon, c’est un univers. Examinez un piano s’il vous plaît, Massimo, a-t-il dit, et voyez de quoi il est fait. Regardez la bizarrerie de sa forme et la variété de ses surfaces. Le piano n’est pas un instrument pour jeunes filles, Massimo, a-t-il dit, c’est un instrument pour gorilles. Seul un gorille a la force d’attaquer un piano comme il devrait être attaqué, a-t-il dit, seul un gorille possède une énergie suffisamment sans inhibitions pour défier le piano comme il devrait être défié. C’est quand j’ai réalisé cela, a-t-il dit, que j’ai pris soin d’aller étudier le gorille en Afrique.
Dans les interstices ménagés au récit de ces imprécations conduites à mi-voix par un génie artistique doucement vieillissant, de ces diatribes instantanées envers les musiciens et les compositeurs qui ne comprennent pas – ou trahissent – la seule quête indispensable d’après Pavone, dans les respirations qui échappent au rappel des quêtes mystiques qui furent bientôt les clés de cette vie qui s’achève, Massimo le fidèle et le discret glisse, quasiment à son insu, l’étrange musique d’une amitié qui va bien au-delà du rapport maître-serviteur. C’est sans doute ici que Gabriel Josipovici, prenant une fois de plus sa lectrice ou son lecteur en un joyeux contrepied, insuffle une poésie délicate dans la rusticité toujours plus grossière qu’il ne semble des rapports de force, sociaux ou artistiques. Bâtissant sans rien dire autour de l’adage certifiant qu’ « il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre », il produit mine de rien une singulière économie de la grandeur, une réflexion subtile qui épouse les creux laissés par les outrances verbales, philosophiques et artistiques de Tancredo Pavone, génie savamment ambigu, à la soif insatiable et à la rage homérique, et qui pourtant doit s’éteindre ici.
Je n’ai jamais eu besoin de beaucoup manger ni de beaucoup dormir, a-t-il dit, ce qui est une chance parce que certaines de mes meilleures idées musicales me sont venues la nuit quand je marchais dans les rues de Rome. Il faudrait marcher dans les villes la nuit, a-t-il dit, c’est alors que l’on a conscience de l’âme d’une ville, et Rome est la quintessence d’une ville. Les conversations que l’on a dans une ville la nuit, avec des inconnus qui passent et les gens que l’on rencontre dans les bars ouverts la nuit dépassent toutes les conversations que l’on peut avoir dans la journée. Pendant la journée, tout le monde est occupé, tout le monde vaque à ses affaires, a-t-il dit, mais la nuit c’est comme si la notion d’objectif disparaissait, et chaque moment a sa propre valeur intrinsèque. Toute personne qui marche dans une ville la nuit marche dans le présent, a-t-il dit, alors que toute personne qui marche dans une ville pendant la journée marche dans le passé ou l’avenir.
Gabriel Josipovici, l'auteur
Orchestrant une réflexion paradoxale, menée à travers les éclats tonitruants de son protagoniste, sur le rôle possible de la création authentique en matière de musique classico-contemporaine, Gabriel Josipovici croise ici nécessairement les chemins de Richard Powers (« Orfeo », 2014) et de William H. Gass (« Le musée de l’inhumanité », 2013), en anticipant de plus d’une manière leurs quêtes propres, et en proposant en 150 pages une approche oblique judicieusement économe, jouant à la perfection de son truchement aux allures de « Voix de son maître » pour sabrer gaillardement, l’air de ne pas y toucher, dans la logorrhée inévitable d’une vie artistique bien remplie et pour en extraire ainsi en souriant, sous les excès et les emportements, le génial songe éveillé.
Ma collègue et amie Charybde 7 en parle magnifiquement sur ce même blog, ici. La remarquable lecture (en anglais) de Lee Rourke dans The Guardian est ici. Un passionnant entretien de l’auteur avec Jason Rotstein, à propos de ce livre, est disponible ici.
Infini : L'histoire d'un moment de Gabriel Josipovici aux éditions Quidam
Coup de cœur de Charybde2
Pour acheter le livre, c’est ici.