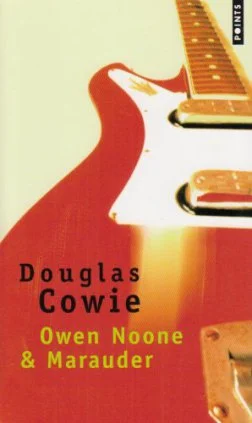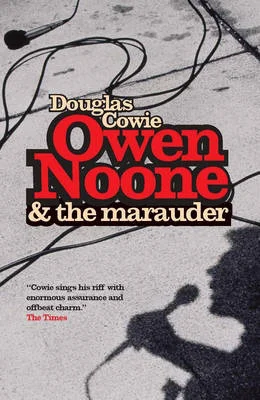Je me souviens de Owen Noone et Marauder
En 1995, la naissance et la gloire du plus beau et du plus improbable groupe fictif d’indie rock américain.
C’est début 2005 qu’une excellente amie, généralement avisée en matière de musique rock au sens large, me recommandait cette alors toute récente parution en anglais, qui devait être traduite quelques mois plus tard par Brice Matthieussent chez Christian Bourgois.
J’étais alors totalement sous le charme du « Haute fidélité » (1995) de Nick Hornby (le roman, aussi bien que le film de Stephen Frears en 2000), et plus encore sans doute, sous ceux du « How Soon Is Never ? » (2003) de Marc Spitz (et un peu plus tard, en 2006, de son « Too Much, Too Late »), malheureusement et inexplicablement (de mon point de vue) jamais traduits chez nous, eux, malgré le talent narratif et la compétence évidente, en matière de rock, de l’auteur de « We Got the Neutron Bomb: The Untold Story of LA Punk » (2001).
M’empressant donc de dévorer cet « Owen Noone et Marauder » (titre français curieusement presque identique au titre original, si l’on excepte la bizarre disparition du « the » de « the Marauder »), j’en avais beaucoup apprécié la subtilité du ressenti indie rock américain, l’ambiance arty des musiciens rôdant sur les campus universitaires et autour des radios dédiées, un an après le suicide de Kurt Cobain, en même temps que l’humour permanent, porté par un sens décisif de l’auto-dérision et de la poésie que n’auraient pas être renié les grands héros et fous de l’histoire du blues.
Tout le monde connaît la fin de l’histoire. Voici le début.
La première fois que je rencontrai Owen Noone, c’était en 1995, j’étais étudiant de première année à Bradley University, dans l’Illinois. J’étudiais l’anglais, je me prenais pour un poète. (…)
Voilà à peu près ce que j’écrivais : des poèmes sans rythme sur des filles à qui je n’avais jamais parlé, à qui je ne parlerais jamais, mais pour qui mon coeur était supposé gémir. Comme personne ne comprenait quel merveilleux poète j’étais, je n’avais pas beaucoup d’amis et je marchais sur le campus, les poings dans les poches, en pensant au jour où je serais célèbre et où tous ces salopards de Bradley prétendraient m’avoir connu autrefois.
Je maudissais aussi tous les gens que je côtoyais parce qu’ils ne comprenaient rien à la musique. Je travaillais comme DJ à WCBU, la station de radio de Bradley, où une fois par semaine j’animais une émission de deux heures consacrée à la scène rock locale. Ils m’ont confié ce créneau horaire parce que j’ai écrit un long projet prétentieux sur des groupes obscurs, en insistant sur le fait que cette musique était vitale pour la communauté tout entière, pas seulement pour quelques étudiants branchés. Ces groupes étaient infiniment plus talentueux, intéressants et, comme ma poésie, voués tôt ou tard à l’immortalité, que les musiciens foireux adulés par les étudiants des fraternités qui sortaient avec les égéries de mes poèmes. Tout passait à la moulinette des radios commerciales – tout -, déplorais-je.
Voilà comment, ou plutôt pourquoi je suis devenu l’ami d’Owen Noone : à cause d’une discussion liée à la musique.
Ces 370 pages qui à l’image du rock peuvent sonner comme une ballade légère, comme une complainte poignante ou comme un assaut tonitruant, racontent une très belle, très drôle et très triste histoire d’amitié et d’instruments, d’amour et de musique, de succès et d’échec, au son de musiques inoubliables issues de nos mémoires comme des joies de l’improvisation.
« As-tu la moindre idée de ce qu’il faut faire ? » demanda Owen.
Soudain je me suis rappelé le bouquin de Lomax. A la fin se trouvait un appendice qui commençait par « Le Style de guitare folk américain ». Il y avait le dessin d’un type qui jouait de la guitare, plus un diagramme qui montrait toute une série d’accords différents, et où il fallait mettre les doigts pour les jouer. J’ai installé le livre, ouvert à la bonne page, sur mon ampli. Mi mineur m’a semblé être le plus facile et nous avons donc joué cet accord en premier. Le son qui sortait de ma guitare paraissait incroyablement réel et propre, il emplissait l’espace minuscule de ma chambre d’une musique que je n’avais jamais entendue, ni en studio ni en live, comme si quelqu’un d’autre l’avait jouée.
Owen s’est penché en avant, pour voir comment on s’y prenait, puis a tapoté les cordes. Avec au final le fracas d’innombrables pianos à queue tombant d’un toit à l’unisson, une émeute sonore qui m’a donné l’impression que ma chambre explosait, avant de se dissoudre en un perçant gémissement de feedback. Owen a plongé en avant pour couper l’ampli, mettant ainsi fin à la torture auditive et s’appuyant aussitôt sur l’ampli pour ne pas tomber.
« Je crois qu’on devrait jouer un tout petit peu moins fort », dit-il.
C’est cette atmosphère rare, authentique, prenante et réjouissante qui m’avait aussi conquis quelques années plus tard à la découverte du son si particulier des « La nuit ne dure pas » (2011) et « Une légende » (2014) d’Olivier Martinelli.
Les règles du jeu de la rubrique « Je me souviens » sur ce blog sont ici.
Douglas Cowie
Owen Noone et Marauder de Douglas Cowie, éd. Point Seuil
Charybde2
L'acheter chez Charybde, ici