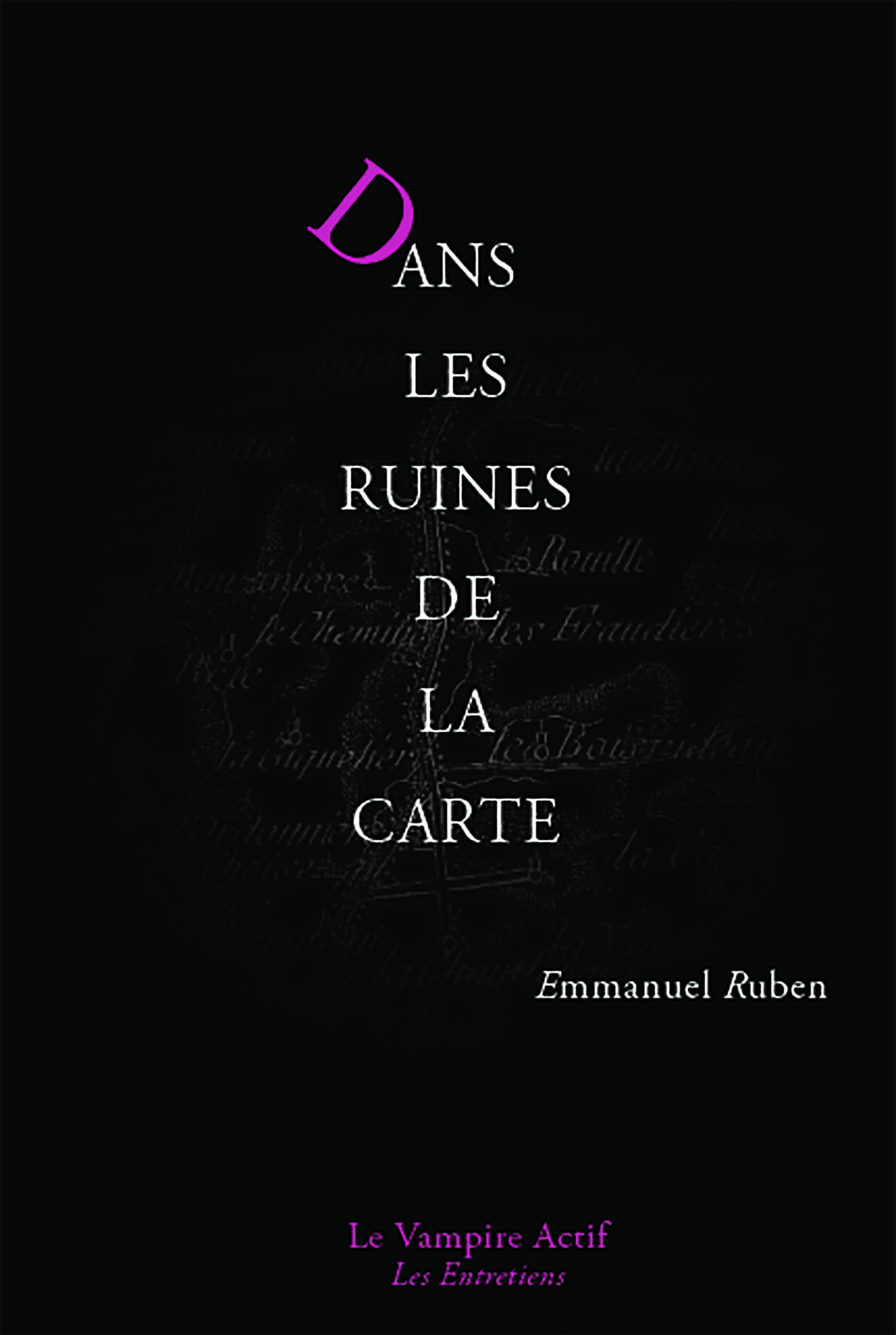Dans les ruines de la carte - Emmanuel Ruben
À l’origine de ce livre, il y aurait une double fascination enfantine et le besoin d’un double retour critique. Retour critique sur la pratique de la géographie, retour critique sur la pratique de la littérature. Fascination d’enfant pour les cartes, les atlas, les planisphères, les mappemondes. Fascination d’enfant pour les œuvres d’art, des mosaïques antiques aux installations contemporaines, qui rappellent les cartes, dans leur agencement, dans la lecture infinie et instantanée qu’elles permettent. Fascination pour les livres – et parmi ces livres, pour ceux, peu importent les genres, qui dessinent en vers ou en prose une cartographie poétique, intellectuelle – et témoignent d’une géographie intime. Un exceptionnel voyage littéraire et artistique à travers ce que la main trace et explore, ici et au loin.
Publié début octobre 2015 au Vampire Actif, cet essai d’Emmanuel Ruben propose de facto une forme de synthèse provisoire et de commentaire imaginatif d’une œuvre romanesque en cours de réalisation, marquée par la confrontation organisée, rationnelle et pourtant soigneusement rêveuse, de la géographie (à laquelle l’auteur fut dûment formé), de la peinture (qu’il pratique) et de la littérature. En jeu, derrière l’usage de la carte (médium ici privilégié d’un usage du monde) et l’immersion dans les géographies imaginaires, ou plutôt dans leurs points de contact avec le monde, rien moins que nos représentations globales et détaillées, et notre mode de relation à ce qu’il est convenu d’appeler le réel contemporain.
À l’origine de ce livre, il y aurait une double fascination enfantine et le besoin d’un double retour critique. Retour critique sur la pratique de la géographie, retour critique sur la pratique de la littérature. Fascination d’enfant pour les cartes, les atlas, les planisphères, les mappemondes. Fascination d’enfant pour les œuvres d’art, des mosaïques antiques aux installations contemporaines, qui rappellent les cartes, dans leur agencement, dans la lecture infinie et instantanée qu’elles permettent. Fascination pour les livres – et parmi ces livres, pour ceux, peu importent les genres, qui dessinent en vers ou en prose une cartographie poétique, intellectuelle – et témoignent d’une géographie intime.
Multipliant les angles d’attaque, en un formidable feu roulant tentant d’abattre l’opacité et l’épaisseur de la représentation figée et convenue, Emmanuel Rubenconvoque ainsi tour à tour, avec une finesse et une intelligence de la toile qui évoquent aisément celles de Daniel Arasse, et notamment celles de son « Le détail – Histoire rapprochée de la peinture » (1992) et de son « On n’y voit rien – Descriptions » (2000), Vermeer et Le Greco, « L’art de la peinture » (1666) et « Vue et plan de Tolède » (1599). Dans la quête ouverte qui est la sienne, l’auteur s’appuie ainsi sur une analyse du statut de la carte et du plan dans l’art pictural, formidable marchepied vers une tentative de compréhension du lien intime et totalement heuristique entre art littéraire et « réel » – la réalité de ce « réel » mythique et encensé se révélant peu à peu comme l’un des enjeux centraux de l’essai .
L’Art de la peinture (Vermeer, ca. 1666)
L’Art de la peinture selon Vermeer serait donc riche d’un quadruple enseignement. Méditation sur l’inachevé, l’infini, le décentrement, le discontinu, ce serait l’art d’une époque inquiète. La Terre explorée et cartographiée s’avère alors un archipel, une Terre-archipel et cette Terre qui tourne peut-être autour du soleil, ne serait plus le centre de l’Univers. Époque post-copernicienne et post-galiléenne, époque de Descartes et de Pascal, époque de Kepler, de Newton et de Spinoza, époque où tous les savants s’interrogent sur les lois de réfraction de la lumière, sur les aberrations de la lumière, comme on disait alors. Or la question de la réfraction de la lumière – question qui fascinait sans doute Vermeer et qui fascine en retour celui qui regarde aujourd’hui ses tableaux -, cette question est inextricablement liée dès l’origine à la question de la triangulation, à la détermination des longitudes, à la recherche d’un point fixe, insituable, où le temps serait aboli.
Explicitant certains des aspects les plus profonds du lien entre géographie, histoire et société, que mettait en scène sa« Ligne des glaces » (2014), dégageant l’alchimie qui unit peinture, géographie et anticipation d’un devenir, qu’explorait son « Icecolor » (2014), feignant de musarder dans les interstices d’un « réel » toujours à interpréter humblement et audacieusement à la fois, comme le propose sa « Jérusalem terrestre », qui paraît simultanément à ce « Dans les ruines de la carte », chez Inculte Dernière Marge, Emmanuel Rubens’attelle, avec Pouchkine, avec Borges, avec Gracq, avec Michaux, à redéfinir la place, essentielle, des « Géographies imaginaires », dans les pas contrastés du Pierre Jourde de l’ouvrage ainsi titré, fondant son esthétique en 1991.
Vue et plan de Tolède (El Greco, 1599)
Car la Terre telle que la représentent nos cartes depuis l’époque de Vermeer n’est pas la Terre, n’est pas non plus un calque ou un miroir de la Terre, ni même une représentation fidèle de celle-ci. La carte topographique, la photographie aérienne ou satellite, qui livrent peu ou prou le même type d’informations et qui sont parfaitement superposables, ces cartes conformes et vraisemblables ne contiennent pas tout le réel, ne décalquent pas le réel – nous permettent à peine de l’approcher. Il faudrait utiliser des cartes thématiques, des cartes par anamorphose, des cartes décentrées, des cartes discontinues, des cartes inachevées, des cartes en réseau, des cartes archipélagiques, des cartes livrées sous forme de puzzle en vrac qui tiendraient compte d’autres métriques que celles auxquelles nous sommes habitués depuis le XVIIe siècle. Il nous faudrait des cartes où les distances seraient exprimées en temps, en coût, en valeurs, en nuances, en degrés d’ombre et de lumière, en potentialités d’émerveillement ou de dépaysement ; des cartes feuilletées où se verraient mieux les menus accidents, les petites catastrophes, la ruine qui nous menace, les strates et les stries de l’espace-temps, tout le chaos des mondes possibles ; il nous faudrait des atlas fractals. Ces atlas fractals existent. Ce sont les livres, que certains croient menacés de disparition. Ce sont les poèmes et les romans, qui n’ont pas attendu l’invention du papier pour exister et qui subsisteront sous d’autres formes que du papier. Ce sont aussi les dessins, les peintures, les partitions, les films, les vidéos.
La fille du capitaine (A.S. Pouchkine, 1836)
C’est en traçant une généalogie différente du voyage littéraire, utilisant toutes les possibilités du tracé, de la carte et de l’invention, qu’Emmanuel Ruben peut questionner radicalement la notion même, si souvent fallacieuse, d’ « écrivain voyageur », cherchant, derrière les manifestes tonitruants, l’effacement reconnu des frontières – dont l’exploration des interstices prouve toutefois chaque jour la résilience -, mais refusant que le seul récit de voyage, prétendu témoignage de « réel », dans sa platitude exotique, se fasse procureur d’un rappel aux ordres plus subtil qu’il n’y paraît.
Revenons un instant à la quadruple image inaugurale : celle de la carte – craquelée chez Vermeer, envolée chez Pouchkine, dépliée chez Le Greco, éparpillée chez Borges. Nous vivons dans les ruines de la carte inutile. Nous vivons dans les ruines de la carte impossible. Nous vivons dans les ruines de toutes les cartes qui ont cru remplacer le monde et décalquer le réel. Nous vivons dans les ruines des mappemondes du XVIe siècle encombrées de lieux imaginaires. Nous vivons dans les ruines des utopies qui ont agité les esprits européens, de Thomas More à Eugène Cabet. Nous vivons dans les ruines de la grande carte totalitaire, orwellienne, du XXe siècle. Nous vivrons bientôt dans les ruines de l’Empire de la vidéosurveillance et de la géolocalisation. Et l’acte de création qui nous préoccupe – écrire ou dessiner – se situe quelque part dans ces déserts de l’Ou/est où gisent les lambeaux de l’impossible. Dans ce nulle-part, cet interstice, cette brèche, cette béance, ce vertige, cet entre-deux où se tutoient le réel et l’imaginaire, le rêve et la mémoire, l’ordinaire et le fabuleux, le proche et le lointain, l’intime et l’ultime. Non pas là où tout est possible – je ne suis pas de ceux qui croient que tout est possible en art, je ne crois pas que l’art soit le domaine de tous les possibles ni que le créateur soit une sorte de démiurge autonome – mais là où tout est improbable.
Improbable, à l’origine, ne signifie pas « ce qui a peu de chances de se produire » mais ce « que l’on ne peut prouver ». Rien ne se prouve en littérature, en peinture, dans le domaine de la création. Rien ne se démontre. Rien ne s’argumente. L’ordre ou plutôt le désordre – pour ne pas dire le chaos – qui règne est celui du hasard, du présage, de la coïncidence, de la découverte. Voyance rimbaldienne. Trouvaille surréaliste. Prémonition kafkaïenne. Hallucinations de Michaux. Prophéties d’Orwell ou de Huxley. Hérésie révolutionnaire prônée par Zamiatine.
Le Rivage des Syrtes (Julien Gracq, 1951)
C’est bien à Pouchkine et à sa « Fille du capitaine », à Gracq et à son« Rivage des Syrtes », surtout, qu’Emmanuel Ruben confie, en un étourdissant rapprochement des imaginations débridées par la steppe sibérienne, réelle et fantasmée, justement, le cœur de la mission capitale de cet essai. Antoine Volodine et son humour du désastre auraient sans doute pu surgir ici entre les lignes (puisque c’est bien, notamment, à une lecture permanente « entre les lignes » que nous appelle l’auteur). Jouant avec les mystificateurs comme avec les arpenteurs de rêves, plaisantant sérieusement avec Cendrars, dévoilant la part dystopique des corps utopiques avec Perec et Foucault, tentant de déchiffrer le paradoxe de l’humilité avec Claude Simon, notant la puissance du collage ne se préoccupant guère de « vérisimilitude » avec Nicolas Bouvier, interrogeant leblanc de la carte et son abîme étincelant avec Philippe Vasset, refusant l’effroi des ténèbres en compagnie de Joseph Conrad, pesant la puissance des noms propres avec Proust, Stendhal et Tolstoï, sublimant le cheminavec Vassili Golovanov, fouillant les topographies avec Sebald, découvrant avec Per Kirkeby une autre parole en archipel que celle de René Char, et dressant in fine les caractéristiques possibles de ces îles-là avec, paradoxalement, Alexandre Soljenytsine et Édouard Glissant, et « Dans les ruines de la carte » nous offre, avec ses lignes, écrites pour mieux refléter le pouvoir de celles qui sont tracées, un somptueux voyage, infiniment plus fort que bien des échappées.
Pourquoi sommes-nous tant fascinés par les atlas, les planisphères, les mappemondes, les portulans, les cartes routières ? Pourquoi sommes-nous tant fascinés par toutes les cartes, qu’elles soient plus ou moins fidèles, plus ou moins précises, plus ou moins fabuleuses ? Et si la carte, espace immense et minuscule, empire des signes et des sens où se rejoignent l’ici et le lointain, le rêve et l’aventure, le visible et l’invisible, l’écriture et le dessin, était la matrice du désir d’écrire et de peindre – la matrice du désir de créer, ou pour reprendre l’image de Pouchkine, le cerf-volant de l’invention ?
Laissons-nous, pieds et mains dans la glaise fertile, porter par Emmanuel Ruben vers des cimes songeuses, conviés au festin pas si secret de cet essai formidablement stimulant, et goûter ainsi une joie authentique de l’invention, des traits et des couleurs, des mots et des sensations.
Pour acheter le livre chez Charybde, c’est ici.